Alors que parait la nouvelle livraison de la revue Laissons Faire, je vous propose ci-dessous un petit dossier consacré à Bertrand de Jouvenel et que je vous ai concocté pour l’occasion.
Bonne lecture !

 « Plus vous étendez la sphère du pouvoir, plus il se trouve de gens qui y aspirent. La vie va où est la vie. »
« Plus vous étendez la sphère du pouvoir, plus il se trouve de gens qui y aspirent. La vie va où est la vie. »
Odilon Barrot
On ne s’aperçoit pas qu’aucune révolution n’aboutit pas à l’appesantissement du Pouvoir. Hélas, dit-on, la Révolution est sortie de son lit naturel. Pitoyable incompréhension ! C’est le terme fatal auquel tout le bouleversement s’acheminait de façon nécessaire.
Les Cromwell ou les Staline ne sont pas conséquences fortuites mais bien le terme fatal des révolutions. Les débuts des révolutions offrent un charme inexplicable : l’événement va tout réparer, tout exaucer et tout accomplir. La Révolution française affranchit les paysans mais les force à porter un fusil, elle supprime les lettres de cachet mais élève la guillotine. Par la révolution de 1917, un pouvoir bien plus étendu que celui du tsar permet de regagner et au-delà le terrain que l’Empire avait perdu. On ne peut citer aucune révolution qui ait renversé un despote véritable (Charles 1er et non Henri VIII, Louis XVI et non Louis XIV, Nicolas II et non Pierre le Grand). Ils sont morts non de leur tyrannie mais de leur faiblesse.
La révolution établit une tyrannie d’autant plus complète que la liquidation aristocratique a été plus poussée. Les populations ne voulaient plus d’intendants royaux mais s’administrer elles-mêmes sur le plan local mais la Constituante détruit les unités historiques qui avaient la capacité et la volonté de gouverner. La Révolution a écrasé les droits qu’elle prétendait exalter. Dès janvier 1790, tout acte des tribunaux tendant à contrarier le mouvement de l’administration est déclaré inconstitutionnel. Ce sont des élections renouvelées pour choisir les juges mais le peuple ne choisit jamais assez au gré du Pouvoir et ses choix sont épurés a posteriori. En l’an VIII, le Pouvoir s’attribue la nomination des juges. Lénine déclare l’État foncièrement mauvais et il édifie un formidable appareil de contrainte en Russie.
Les révolutions ne sont pas des réactions de l’esprit de liberté : on n’en peut citer aucune qui ait renversé un despote véritable. Louis XVI n’a même pas su laisser tirer ses Suisses ; Nicolas II n’osa même pas venger son cher Raspoutine ; Charles Ier, vivotait sans menacer personne. Ils sont morts, ces rois, non de leur tyrannie, mais de leur faiblesse. En 1788, la monarchie est tellement en recul qu’elle devait sacrifier au cri général ses intendants de province, exécutants de la volonté centrale, qui cédaient la place aux assemblées provinciales : c’était le mouvement inverse de toute notre histoire. L’œuvre révolutionnaire, c’est la restauration de la monarchie absolue. La constituante sacrifie d’entrée les intérêts de ces mêmes privilégiés qui avaient réclamé la convocation des Etats. Les biens immenses du Clergé sont aussi rapidement livrés au Pouvoir, et les Parlements reçoivent un congé décisif. Le roi ne devient plus qu’un simple fonctionnaire de la volonté générale : alors pourquoi inamovible ? Les circonstances aidant, on le supprime, et le pouvoir exécutif se réunit au législatif dans les mains de la Convention.
La Constituante reconstruit la Justice sur des bases nouvelles, de façon qu’elle soit « toute-puissante pour secourir tous les droits et tous les individus ». Elle sera parfaitement indépendante du Pouvoir. Mais ce dernier très vite prétend que les juges s’inspirent non pas des lois dignes de ce nom que la Constituante a d’abord formulé, mais de mesures de circonstances, dirigées contre telles ou telles catégories de citoyens, et décorées du nom de lois. Il leur reproche trop de mollesse. Il fallait des tribunaux extraordinaires dont le modèle fut le Tribunal révolutionnaire de Paris. Puis en l’an VIII, le pouvoir s’attribue la nomination des juges et leur avancement. Ainsi la Révolution a enlevé à la Justice la fonction qu’elle exerçait auparavant, de défendre l’individu contre les entreprises du Pouvoir. Cette œuvre fut celle non de la Terreur, mais de la Constituante. Et ces principes sont restés en vigueur.
Les initiateurs de la doctrine démocratique ont pris la liberté de l’homme comme base philosophique. Ils se sont proposés de la retrouver comme résultat politique de leur effort. L’homme entrant en association a par là même accepté certaines règles de conduite nécessaires au maintien de l’association. Mais il n’est obligé d’obéir qu’à elles, n’a de maître et de souverain terrestre que la loi. « Un peuple libre, dit Rousseau, obéit aux lois mais il n’obéit qu’aux lois et c’est par la force des lois qu’il n’obéit pas aux hommes ». Ces postulats justifient immédiatement l’abaissement, la subordination du pouvoir. Il n’a d’autre raison d’être et d’autre droit que d’exécuter la loi. La question capitale est de décider d’où viendra la loi. En Angleterre, les assemblées étaient des congrès de privilégiés. En Face du pouvoir demandeur, les représentants disposaient de mandats impératifs. Mais lorsque la préférence donnée à l’assemblée sur le souverain l’a fait investir, elle seule, de la puissance législative, comme seul représentant de la Nation, on n’a point vu qu’on changeait par là son caractère, et que son attitude devait changer. Au lieu d’être juxtaposition d’intérêts divers, elle devenait représentation totale de la totalité nationale. Le parlement ne trouvait plus, lui, de représentants de la Diversité, de mandataires des intérêts particuliers, dont il eût à tenir compte ! Ce n’est pas le roi qui a disparu : le Pouvoir législateur représentant de l’intérêt national est son successeur ; mais ce qui a disparu, c’est la représentation des intérêts qui sont dans la nation. L’aristocratie parlementaire constitue alors « Le Prince », un prince plus puissant que n’était un roi non maître des lois. Ou bien ce prince réussit à s’affranchir de ses mandants ; il est alors absolu. Ou bien, au contraire, les membres de l’assemblée deviennent les instruments de partis, ou les jouets de mouvements extérieurs à l’assemblée. La bataille s’instaure, dont l’enjeu n’est plus seulement le pouvoir, mais les lois elles-mêmes, qui ne seront plus le reflet de vérités supérieures, mais varieront au gré des fluctuations du combat.
Si l’on institue un corps législateur, il se subordonnera et s’intégrera la puissance législative. Rousseau l’a bien vu, car son système tendait à restreindre le nombre de lois, l’étendue des obligations imposées aux sujets, et des pouvoirs conférés aux magistrats. Il ne lui est pas venu à l’esprit que le peuple pût faire des lois mais il a voulu lui donner le moyen d’en repousser qui parussent injustifiées. Et c’est en effet un rôle négatif et éliminateur que joue en pratique le référendum, traduction libre du principe rousseauiste. Rousseau n’a jamais prétendu que le peuple fût qualifié pour choisir la législation « en progrès » d’une société « en progrès » : il ne croyait pas, on le sait, au progrès. Ce qu’il attendait de la législation populaire, dans les petits Etats, qui seuls l’intéressaient, c’était qu’elle entravât la prolifération des lois et l’habilitation indéfinie du pouvoir. Quel sujet d’étonnement et quelle leçon d’histoire sociale que le retournement prodigieux de la doctrine de Rousseau ! Non plus qu’une loi n’est loi, comme l’avait entendu Rousseau, que par le consentement du peuple, mais tout ce que veut le peuple, ou tout ce qu’on représente comme voulu par lui, est loi. On est revenu, en changeant simplement l’attribut, à l’adage qui révoltait les philosophes : « Ce qui plaît au prince, cela aura vigueur de loi ».
Comme le répète Clemenceau : « … si nous attendions de ces majorités d’un jour l’exercice de la puissance qui fut celle de nos anciens rois, nous n’aurions fait que changer de tyrannie. » Ce qu’on a rêvé, c’est que la garantie de la liberté résidait dans la souveraineté de la règle de droit, de la Loi. On a réclamé de plus en plus bruyamment la mise en œuvre de la souveraineté populaire et son absolutisme. On n’a pas compris que c’était renoncer à la difficile souveraineté des lois et quitter les garanties de la liberté ; qu’enfin on reconstituait un Imperium césarien qui devait dès lors trouver ses Césars.
Il n’y a point d’institutions qui permettent de faire concourir chaque personne à l’exercice du Pouvoir, car le Pouvoir est commandement et tous ne peuvent commander. La souveraineté du peuple n’est donc qu’une fiction qui ne peut être à la longue que destructrice des libertés individuelles. Le pouvoir démocratique se présente comme venant libérer l’homme des contraintes que faisaient peser sur lui l’ancien pouvoir. Cette hostilité à la formation de communautés plus petites ne se concilie pas avec la prétention d’instaurer le gouvernement du peuple par lui-même, puisque manifestement ce gouvernement est d’autant plus une réalité qu’il s’exerce dans des communautés plus petites. Tandis qu’il proclame la souveraineté du peuple, le Pouvoir démocratique la resserre exclusivement au choix de délégués qui en auront l’exercice plénier. Ainsi le prétendu « pouvoir du peuple » n’est relié au peuple que par le cordon ombilical très lâche des élections générales ; il n’est effectivement qu’un « pouvoir sur le peuple ». On a vu les corps représentatifs se développer en dépit de toutes les interdictions et de toutes les poursuites. Cette formation spontanée est un phénomène naturel qui corrige la fausse conception totalitaire de l’intérêt général. Or, faute d’avoir ménagé aux intérêts particuliers des moyens de défense, on les condamne à une activité offensive, qui les mène à l’oppression d’autres intérêts. Et ceux-ci se trouvent excités à stopper, pousser ou conquérir le Pouvoir par des procédés semblables. L’autorité n’est plus alors qu’un enjeu, elle perd toute stabilité, toute considération.
Tant que le peuple assemblé par circonscriptions regarde au mérite personnel et non à l’opinion affichée, l’assemblée est constituée par une élite de personnalités indépendantes. On a donc une assemblée vivante où les opinions toujours libres s’affrontent pour le bien de la patrie et l’instruction du public. Mais dès que l’assemblée représentative dispose du Pouvoir, comme il arrive en démocratie, l’appétit de commandement porte les membres à s’ordonner en fractions permanentes. Le groupe fait triompher des candidats qu’il a choisis moins en raison de leur valeur propre que de l’obéissance qu’ils promettent. Il faut alors arracher par n’importe quel moyen la voix dont l’électeur dispose. Se formeront alors des syndicats d’intérêts et d’ambitions, qui s’ingénieront à capter les suffrages pour investir des députés dociles.
Les initiateurs de la démocratie entendaient que la campagne électorale fût une saison d’éducation populaire par l’exposition complète des thèses opposées. Mais les modernes, en gens avisés, ont compris que former l’esprit des électeurs c’est aussi bien l’ouvrir aux arguments adverses qu’aux leurs propres et donc peine inutile. C’est sur les émotions qu’il faut agir. Loin d’éveiller la capacité citoyenne chez ceux qui ne la possèdent pas encore, on l’éteint chez ceux qui l’ont acquise. On fait vibrer la corde du loyalisme, tant on a transformé les électeurs en soldats, en « militants ». C’est que leurs meneurs sont les conquérants du Pouvoir.
Plus la « machine » est puissante, plus les votes sont disciplinés, et moins la discussion a d’importance : elle n’affecte plus le scrutin. La puissance effective quitte d’ailleurs l’assemblée à mesure que les partis gagnent en consistance et en discipline. Les consultations électorales prenant le caractère de luttes entre « machines », celle qui l’emporte peut mettre son chef au gouvernement et il n’aura presque point à tenir compte de l’assemblée où les whips lui assureront une majorité stable.
Ces compétitions aboutissent à la dictature d’un parti, c’est-à-dire d’une équipe, et d’un homme, son chef. Voilà le totalitarisme. Ils disposent de ressources immenses accumulées dans l’arsenal du Pouvoir. Il n’existe dans la société aucune contre-force capable d’arrêter le Pouvoir. On a tout d’abord pensé la liberté comme fin. Dans ce but, on a proclamé la souveraineté des lois. Ces lois, on les mettait au-dessus de l’homme. Il n’aurait point à trembler devant un particulier plus puissant, devant un groupe menaçant par son nombre, car entre ce puissant et lui, c’est la Justice impassible qui trancherait, selon les lois établies. Il n’aurait rien non plus à redouter des gouvernants, serviteurs des lois. Il fallait que l’on crût au caractère de nécessité des lois, qu’on les regardât comme inscrites dans la nature des choses, et non pas comme un produit de la volonté humaine. Or précisément, on se mettait à considérer les lois comme des règlements toujours susceptibles de critique et de révision. En fait les règles suprêmes de la vie sociale sont devenues l’objet de querelles politiques. Dès lors les volontés particulières se trouvaient déchaînées, puisque capables de faire ou défaire les lois. La loi est devenue l’expression des passions du moment. Comme on ne peut plus conquérir la puissance législative, à laquelle l’exécutive est réunie, que par le moyen d’une faction bien organisée, les factions vont gagnant en cohésion et en violence. L’incertitude en tout cas devient telle, les conditions nécessaires de la vie sociale sont à ce point ruinées, que les peuple enfin, las de l’impuissance d’un Imperium toujours plus disputé, aspirent à stabiliser ce poids écrasant du Pouvoir qui roule au hasard de main en main, et finissent par trouver un honteux soulagement dans la paix du despotisme.
A la faveur du déchirement de l’Eglise, le monarque temporel a prétendu communiquer directement avec le suzerain céleste, et il a justifié ainsi l’assomption d’une certaine puissance législatrice. Ainsi le pouvoir qui avait été auprès des autres pouvoirs et dans le droit, tendait à faire entrer en lui les pouvoirs sociaux et le Droit même. Toutes autres étaient les républiques de l’Antiquité, Rome particulièrement. Les différentes magistratures étant indépendantes, le Pouvoir, l’Imperium n’était concentré nulle part, sinon, quand les circonstances l’exigeaient, chez le dictateur temporaire. Et chaque autorité avait son pouvoir propre, potestas. De sorte que ces pouvoirs pouvaient entrer en conflit et l’un d’eux arrêter l’autre. Même à l’intérieur d’une même autorité la pluralité de ses détenteurs permettait à l’un d’eux de paralyser son collègue ou ses collègues. Qu’est-ce qu’un contre-pouvoir ? Evidemment une puissance sociale, un intérêt fractionnaire constitué. Leur self-defense, pour égoïste qu’en puisse être le principe, contribue à la création d’un équilibre social. Ces corps, Montesquieu les trouvait partout dans la société de son temps : noblesse, Clergé, assemblées d’Etats de provinces, corporations. Le séisme fut politique bien sûr, mais aussi intellectuel (Rousseau, Mably) : contre la souveraineté du roi fut affirmée et triompha la souveraineté du peuple. Le problème de la limitation du pouvoir, pense-t-on, ne se trouvait posé que par la solution vicieuse autrefois donnée au problème de la formation du pouvoir. Si le gouvernement émane d’une source pure, ce n’est plus sa faiblesse mais sa force qui fait la liberté, ce n’est plus son étendue, mais toute borne qu’on voudrait apporter à son action, qui serait antisociale ! Royer-Collard le dit fort bien : « La Révolution n’a laissé debout que les individus. […] La centralisation a pénétré modestement, comme une conséquence, une nécessité. En effet, là où il n’y a que des individus, toutes les affaires qui ne sont pas les leurs sont des affaires publiques, les affaires de l’Etat ». Sans doute l’intention primitive des Constituants avait été restrictive : ils entendaient qu’aucun acte de gouvernement ne pût être fait qu’en vertu d’une loi, et qu’aucune loi ne pût être faite qu’en vertu d’un consensus populi. Mais leur système devait logiquement aboutir à rendre possible n’importe quel acte de gouvernement pourvu qu’une loi l’autorisât et à rendre possible n’importe quelle loi pourvu que le Parlement la votât. Aucun despote ne peut se permettre d’aller aussi loin que ceux qui se réclament de la souveraineté populaire. Citons Constant : « La tyrannie n’aura besoin que de proclamer la toute-puissance de ce peuple en le menaçant, et de parler en son nom en lui imposant silence » (Cours de politique constitutionnelle, ed. 1872).
En Angleterre, l’omnipotence s’était élevée en détruisant au nom de la masse qu’elle prétendait représenter les groupes animés d’une vie réelle. Mais les deux chambres sont l’organe des puissances sociales de fait. De là leur force, qu’elles n’empruntaient à aucune constitution. De là aussi leur prudence. Elles équilibrent bien moins le Pouvoir qu’elles ne le cernent. Mais à chaque fois qu’elles le veulent, les puissances sociales font agir le pouvoir, comme il se voit déjà en 1749 quand elles forcent Walpole à la guerre. Ainsi la « séparation des pouvoirs » qu’on observe en Angleterre est à la vérité le résultat d’un processus de refoulement de l’Imperium royal par les puissances sociales.
Rien de comparable en France où règne la solitude victorieuse de la Centralité. On découpe dans l’Imperium des tranches qu’on répartit entre le Roi, la chambre basse, une chambre haute. Mais chaque tronçon du serpent tend à régénérer le serpent tout entier. Le Roi se tient pour héritier d’un roi qui fut absolu, et l’assemblée d’une assemblée qui fut absolue. Puis en 1848 triomphait la souveraineté populaire. Et l’on vit alors reparaître l’erreur fondamentale de la première révolution, l’illusion qu’un pouvoir formé à partir du bon principe est indéfiniment bénéfique. Opposer, comme l’a fait la Deuxième république, à un président élu par le peuple, une Assemblée élue par le peuple, ce n’est pas organiser un équilibre d’éléments sociaux, mais seulement instaurer une dispute d’hommes investis par la même source.
Si la souveraineté réside dans un roi ou une aristocratie, appartient à un seul ou à quelques-uns, elle ne peut s’étaler exagérément sans choquer les intérêts du grand nombre, et il suffit de fournir à ces intérêts un organe, pour que les forces immenses qui s’expriment par ce moyen distendent peu à peu cet organe. Tandis qu’au contraire un organe de résistance accordé à une minorité contre le pouvoir de la multitude ne peut que s’atrophier progressivement, comme se resserre une tête de pont tenue par une armée très inférieure en nombre. De sorte que le Pouvoir n’éveillerait de résistances assez fortes pour le limiter que s’il est de caractère minoritaire. Tandis qu’étant de caractère majoritaire il peut aller jusqu’à l’absolutisme, dont le règne seul relève le mensonge de son principe et que, se disant Peuple, il n’est toujours que Pouvoir.
Ce que nous appelons de nos vœux est une suprématie par le droit. Un Droit aîné et mentor de l’Etat. Or le doit a perdu son autonomie. Comme le dit le code Justinien : nous avons chacun des droits, subjectifs, qui se situent et se concilient dans un Droit objectif, élaboration d’une règle morale s’imposant à tous, que le Pouvoir doit respecter et faire respecter. N’importe l’origine du pouvoir : il se légitime lorsqu’il s’exerce conformément au droit.
De nos jours, rien de semblable : le droit n’est, nous dit-on, que l’ensemble des règles édictées par l’autorité politique. L’autorité faiseuse de lois est donc toujours juste, par définition. Citons la Métaphysique des mœurs de Kant : « Il n’y a contre le suprême législateur de l’Etat aucune résistance légitime de la part du peuple; car il n’y a d’état juridique possible que grâce à la soumission à la volonté législative pour tous. […] Pour que le peuple fût autorisé à la résistance, il faudrait préalablement une loi publique qui la permit. » Carré de Malberg ajoute : « L’essence de la règle de règle de droit est d’être sanctionnée par des moyens de coercition immédiate […] Il ne peut se concevoir, en fait de droit, que du droit positif. »
Or l’Histoire ne nous montre-t-elle pas un Droit d’une bien autre dignité, fondé sur la Loi Divine et la Coutume ? Mais encore faut-il distinguer le cas de Hobbes, qui imagine un pouvoir total, et celui de Rousseau et Kant, qui se gardent bien de confier cette puissance législative illimitée à un monarque ou à une assemblée. Elle ne saurait appartenir pour eux qu’à tout le peuple. Mais ces grands penseurs, dans l’esprit de leurs temps, ne voyaient d’autre réalité que l’homme. Ils proclamaient sa dignité et les droits qu’il possède en tant qu’homme. Ils n’ont pas assez vu que ces droits pouvaient être en conflit avec la puissance législative illimitée. Cela revient à dire que les Déclarations des droits ont joué en fait le rôle d’un Droit placé au-dessus de la loi.
Ce n’est pas un hasard si l’on a vu s’avancer le Pouvoir à l’époque où la foi catholique a été ébranlée. C’est ainsi qu’on le voit de nouveau s’avancer du fait de l’ébranlement des principes individualistes de 89. Mais c’est Léon Duguit, autre grand constitutionnaliste, qui énonce la vraie doctrine du Droit : « L’activité de l’Etat dans toutes ses manifestations est limités par un droit supérieur à lui […] cette limitation ne s’impose pas seulement à tel ou tel organe, elle s’impose à l’Etat lui-même. »
Le juriste américain Marshall, en 1803, a su faire accepter aux Etats-Unis un système formulant expressément les règles suprêmes du Droit, et instituant une autorité confrontant les lois au Droit et rejetant celles qui l’offensent. Ces droits de la justice ne s’étendent pas seulement aux gestes d’un homme privé à l’égard d’un homme privé, mais aussi aux gestes d’un agent du Pouvoir à l’égard de quiconque. Ces garanties, comme en Angleterre, sont moins efficaces par les sanctions qu’elles comportent que par l’état d’esprit qu’elles entretiennent.
Mais progressivement la « législation judiciaire » anglaise n’a plus été épargnée par le flot des lois nouvelles ; la Cour suprême américaine s’est trouvée en butte au sentiment du public et a dû se mettre en veilleuse : c’est un reflet parmi d’autres du sentiment moderne que peut nulle part souffrir que l’opinion de quelques hommes arrête à elle seule ce que réclame l’opinion de toute la société. Mais il ne s’agit ni d’un côté ni de l’autre d’opinions. On a d’une part une émotion momentanée que des méthodes d’agitation permettent de créer facilement ; de l’autre des vérités juridiques dont le respect s’impose absolument. A rebours, ce dont la Cour suprême a souffert, c’est d’avoir défendu contre l’opportunité politique des principes qui avaient été eux aussi d’opportunité politique.
Les racines aristocratiques de la liberté
La liberté est la souveraineté concrète de l’homme sur soi-même. La liberté n’est pas une invention moderne. Nous concevons à peine qu’une société puisse vivre où chacun est juge et maître de ses actions. Le Romain est libre de tout faire mais il doit en supporter toutes les conséquences. Tout peut se faire mais il faut y mettre les formes, formes d’une extrême rigueur. Le plein droit civil n’a d’abord été le lot que des eupatrides ou patriciens. Puis les familles énergiques de la plèbe accèdent aux magistratures et forment avec le patriciat la nobilitas. La plèbe juridique disparaît mais il y a une plèbe de fait. Les hommes de la masse en viennent à priser moins leur liberté juridique que leur participation à la puissance publique. Le Sénat souffre que les tribuns réunissent la plèbe pour voter des résolutions, plebiscita. Le tribunat accoutume le peuple à l’idée du sauveur. T. Gracchus voulait que tout citoyen redevienne propriétaire. C. Gracchus que chaque citoyen ait sa ration de blé à bas prix (bientôt gratuite). Au lieu que se généralise l’indépendance concrète des membres de la société, ils deviennent les clients de la puissance publique.
Il y a un Pouvoir, un État dès que le divorce des intérêts individuels est assez profond pour qu’il faille un tuteur permanent compensant la faiblesse du grand nombre. En Angleterre, le système de la liberté est progressivement étendu à tous : la plèbe est appelée aux droits de l’aristocratie ou extension à tous d’une Liberté individuelle. En France, le système de l’autorité, la machine construite par la monarchie tombe aux mains du peuple pris en masse ou attribution à tous d’une Souveraineté armée.
Dès que le peuple politique comprend une majorité de personnes qui n’ont rien ou croient ne rien avoir à défendre, le peuple se livre au messianisme du Pouvoir. Trois choses importent au césarisme : perte du crédit moral des membres les plus anciennement libres, élévation d’une classe nouvelle de capitalistes séparée par sa richesse du reste des citoyens, réunion de la force politique avec la faiblesse sociale.
L’objet de la démocratie est de transformer le maître suprême de la Société, l’État, en son serviteur. La liberté n’est qu’un besoin secondaire par rapport au besoin primaire de sécurité. A tout instant, il existe dans n’importe quelle société des individus qui ne se sentent pas assez protégés (sécuritaires), et d’autres qui ne sentent pas assez libres (libertaires). Le roi s’appuyant sur les classes inférieures, il y a versement progressif dans les hautes couches sociales d’éléments puisés en bas, montés par le canal étatique. La dégénérescence intérieure transforme l’aristocratie. Les privilégiés cherchent à être protégés par l’État. N’ayant plus de force propre, ils sont devenus incapables de limiter le pouvoir : les aspirations libertaires résident alors dans la classe moyenne, alliée du pouvoir s’il faut discipliner une aristocratie désordonnée, alliée de l’aristocratie lorsque l’État veut étouffer la liberté. Tous les individus, toutes les classes tâchent d’appuyer leur existence individuelle à l’État et les nouveaux droits de l’Homme contredisent et abrogent ceux qu’avait proclamés le XVIIIe s. : la plénitude de la liberté implique la plénitude du risque. Dès qu’on attend de l’État une protection, une sécurité, il lui suffit de justifier ses envahissements par les nécessités de son protectorat. L’aspiration religieuse est naturelle à l’homme, on a vainement chassé la foi de la scène politique : le Pouvoir revêt un caractère de théocratie.
Une puissance bienfaisante veillera sur chaque homme, depuis le berceau jusqu’à la tombe, dirigeant son développement individuel et l’orientant vers l’emploi le plus approprié de son activité. Le jeu des lois positives laisse beaucoup de place à quantité de misères et de malheurs individuels. Les victimes réclament une intervention providentielle qui corrige ces conséquences. Le trouble social n’est pas imaginaire mais le Pouvoir procède par décisions arbitraires. L’homme concret agit sous l’empire de sentiments et de croyances. Nous sommes dirigés par des images de comportement : nous n’avons qu’à imiter, qu’à répéter. L’harmonie est menacée quand les images de comportement sont troublées. Le faux dogme de l’égalité, flatteur aux faibles, aboutit en réalité à la licence infinie des puissants. Aucun ordre social ne saurait se maintenir ou se rétablir si les dirigeants des groupes des groupes et les aînés des collèges ne remplissent pas leur mission. Le trouble des images de comportement se répand de haut en bas. La cohérence sociale ne peut alors être rétablie que par le Pouvoir, usant des méthodes grossières de la suggestion collective et de la propagande. C’est la solution totalitaire, mal appelé par le mal individualiste. Une métaphysique destructrice n’a voulu voir dans la Société que l’État et l’Individu. Elle a méconnu le rôle des autorités morales et de tous ces pouvoirs sociaux intermédiaires qui encadrent et protègent l’homme de l’intervention du Pouvoir.
 «Une monarchie subit les services des puissants en tant qu’elle demeure sous la tutelle aristocratique; mais elle appelle les services des plébéiens en tant qu’elle veut se rendre absolue.»
«Une monarchie subit les services des puissants en tant qu’elle demeure sous la tutelle aristocratique; mais elle appelle les services des plébéiens en tant qu’elle veut se rendre absolue.»
La nécessité du nivellement
D’où vient que l’Etat ne rencontre aucune limite, aucune résistance syndicale du peuple ? C’est que les représentants des différents éléments de la Nation sont devenus le Pouvoir, et le peuple reste alors sans défenseur. Ceux qui sont l’Etat n’admettent pas d’intérêt de la Nation distinct de l’intérêt de l’Etat. Ils écraseraient comme sédition ce que la monarchie accueillait comme remontrance.
Le pouvoir dans sa puissance a pour victimes prédestinées et pour opposants naturels les puissants, les chefs de file, ceux qui exercent une autorité et possèdent une puissance dans la société. Être niveleur n’est donc nullement un caractère qu’il assume quand il devient démocratique. Le nivellement est dans sa destinée.
Ce qui aide au pouvoir de l’État c’est qu’il lutte contre d’autres maîtres ; et l’on regarde leur abaissement plutôt que son élévation. Ce qui lui est obstacle c’est tout commandement autre que le sien. Ce qui lui est aliment c’est toute force où qu’elle se trouve. Il est niveleur en tant qu’il est État, parce qu’il est État. Magistrature, police et armée font respecter les droits acquis : si on l’examine dans son Être, il est défenseur des privilégiés, mais si on l’examine dans son Devenir, on le trouve agresseur de toutes les formes d’autorité sociale. Il détruit naturellement l’ordre social dont il émane. Les grands sont abaissés tandis que s’élève une statocratie. Les privilégiés ne sont plus en face de l’État, ils sont dans l’État et constitués par lui et l’État est menacé de démembrement : cette construction et destruction de l’État rythme la vie sociale.
Ce sont les possédants qui bénéficient des lois, des décisions de la magistrature, des interventions de la police. Mais l’Etat n’est pas dans sa nature conservateur des droits acquis. Il joue les deux rôles à la fois, garantissant par ses organes les situations établies, et les minant par sa législation. Le processus destructeur des aristocraties s’accompagne d’un processus inverse. Car parallèlement s’élève une statocratie, qui non seulement s’approprie collectivement les forces sociales, mais qui tend aussi à se les approprier individuellement, donc à les distraire du pouvoir.
Dans les temps anciens, le système qui prévalait était celui de la société gentilice : le pouvoir n’était qu’un pacificateur entre groupes disposant d’une totale liberté interne. Le pouvoir ne connaît que les chefs de groupes, entre lesquels il arbitre, auxquels il commande. Son autorité ne pénètre pas dans le groupe même. Le roi est par conséquent contraint à une consultation permanente avec les pairs qui peuvent seuls lui prêter les forces dont il a besoin. Par conséquent, briser le cadre gentilice est la grande affaire des rois. La lutte contre la cellule familiale, depuis le classement des citoyens de Solon et Servius Tullius, s’est poursuivi tout au long de l’histoire. L’Etat a revendiqué comme ses propres ressortissants ceux qui n’étaient auparavant que les sujets du père. L’apparition de la structure féodale, système d’ « hommes de confiance », fait de chaque dominateur local un législateur, un juge, un administrateur d’une sorte de principauté. Mais le pouvoir anéanti se réveille, aiguillonné par ses besoins : il n’est pour ce dernier d’autres ressources que de dérober à la cellule seigneuriale les ressources qu’elle recèle. Les légistes placés entre le seigneur et ses sujets sont donc là pour que le seigneur s’abstienne de « tailler » arbitrairement ses hommes. Par ailleurs le monarque demande de plus en plus fréquemment des « aides », à l’occasion des guerres bien sûr, mais également par le biais de la dépréciation monétaire : le métal précieux, acheté de plus en plus cher par les ateliers monétaires, circule de plus en plus vite. Son rythme suit celui des besoins de l’Etat. L’Etat voit avec faveur la montée des riches qui ne lui paraissent point soustraire quelque chose à son autorité. Mais enfin la démolition de toutes autres dominations sociales a laissé les dominations financières maîtresses du terrain. Alors on les a reconnues formatrices de cellules nouvelles. Le patronat industriel pénètre dans l’atelier, a introduit sa loi, sa police, son règlement d’atelier. Ainsi les anticapitalistes, à rebours, viennent remplir les cadres de l’Etat bourgeois. Socialiste ou non, le pouvoir devient nécessairement l’allié de ceux qui subissent la domination capitaliste.
La statocratie, mariage du Pouvoir et de la plèbe
Si le Pouvoir grandit aux dépens des puissants, la plèbe doit être son éternelle alliée. La passion de l’absolutisme doit nécessairement conspirer avec la passion de l’égalité. Ce qu’a fait César en quelques années, la monarchie capétienne a mis 400 ans à l’accomplir mais c’est la même tâche et la même tactique. Des conseillers plébéiens, des soldats plébéiens, des fonctionnaires plébéiens sont les instruments du pouvoir qui se veut absolu. Quel spectacle cette montée des hommes noirs qui dévorent peu à peu la grandeur féodale. Le Pouvoir monarchique n’a pourtant point atteint sa fin logique, répugnant à détruire la noblesse toujours résistante. Lorsque se lèvera la vague démocratique, elle trouvera en Angleterre un Pouvoir tout investi de tranchées aristocratiques, au lieu qu’en France, elle s’emparera tout d’un coup d’un Pouvoir monarchique sans frein : ce qui explique assez la différence des deux démocraties.
Le terme d’une telle évolution, c’est la destruction de tout commandement au profit du seul commandement étatique. C’est l’atomisation sociale, la rupture de tous liens particuliers entre les hommes, qui ne sont plus tenus ensemble que par leur commun servage envers l’Etat. C’est, à la fois, et par une convergence fatale, l’extrémité de l’individualisme et l’extrémité du socialisme. Est-ce à dire pourtant qu’il n’y ait plus de privilégiés ? Si : mais ils sont dans l’Etat et constitués par lui. Ceux qui occupent les positions clefs de cette grande machine, les potentes, les optimates, s’approprieront alors de nouveaux avantages, et voudront en assurer la transmission à leurs descendants. Ce sera la féodalité. L’Etat sera démembré par la statocratie conçue dans son propre sein. Il s’agit pour lui dès lors de détruire ces molécules sociales ; et le processus de gonflement de l’Etat recommence.
Toujours, l’aristocratie s’oppose à l’élection d’un pouvoir disposant par lui-même de moyens d’action qui le rendent autonome à l’égard de la Société. A l’armée, assemblée de contingents féodaux, le roi leur préfère bientôt une cavalerie mercenaire développée à mesure de ses ressources. Et ce malgré des résultats mitigés.
L’Etat c’est nous ? Non, l’Etat, c’est eux !
« Le terme d’État – et c’est pourquoi nous l’évitons – comporte deux sens fort différents. Il désigne d’abord une société organisée ayant un gouvernement autonome, et, en ce sens, nous sommes tous membres de l’État, l’État c’est nous. Mais il dénote d’autre part l’appareil qui gouverne cette société. En ce sens les membres de l’État, ce sont ceux qui participent au Pouvoir, l’État c’est eux. Si maintenant l’on pose que l’État, entendant l’appareil de commandement, commande à la Société, on ne fait qu’émettre un axiome ; mais si aussitôt l’on glisse subrepticement sous le mot État son autre sens, on trouve que c’est la société qui commande à elle-même, ce qu’il fallait démontrer. Ce n’est là évidemment qu’une fraude intellectuelle inconsciente. Elle n’apparaît pas flagrante parce que précisément dans notre société l’appareil gouvernemental est ou doit être en principe l’expression de la société, un simple système de transmission au moyen de quoi elle se régit elle-même. À supposer qu’il en soit vraiment ainsi – ce qui reste à voir – il est patent qu’il n’en a pas été ainsi toujours et partout, que l’autorité a été exercée par des Pouvoirs nettement distincts de la Société, et que l’obéissance a été obtenue par eux. »
Bertrand de Jouvenel — Du pouvoir (1945)
Il faut écouter les cris de dépit de Saint-Simon contre Mazarin. Il a bien compris qu’au temps de la Fronde une révolution s’était accomplie, non pas celle, tumultueuse, que tentaient les émeutiers, mais celle au contraire invisible, qu’accomplissait le ministre éducateur de Louis XIV : « Il en méprise les lois, le génie, les avantages, il en ignore les règles et les formes, il ne pense qu’à tout subjuguer, à tout confondre, à faire que tout soit peuple ». Une partie de la noblesse alors, durant tout le XVIIIe siècle, plus ou moins déplumée par le pouvoir monarchique, se remplume en s’installant dans le riche appareil d’Etat construit par les commis plébéiens. Et occupant toutes les places, obstruant toutes les avenues du Pouvoir, l’ancienne noblesse l’anémie en empêchant qu’il attire à lui, comme autrefois, les ambitions plébéiennes. Ainsi tout ce qui devait servir l’Etat, s’en trouvant écarté, se « jacobinise ». Sous une opposition parlementaire qui, acceptée, aurait transformé la monarchie absolue en monarchie limitée, s’impatiente une élite plébéienne qui, admise dans l’Etat, aurait poussé toujours plus loin la centralisation monarchique. Elle était si naturellement servante du pouvoir royal qu’elle ne fera que le continuer, sans roi.
Le levier des croyances
Plus les routines et les croyances d’une société sont stables et enracinées, plus les comportements sont prédéterminés, moins le Pouvoir est libre dans son action. Plus nous cherchons à connaître les hommes primitifs, plus nous sommes frappés, non pas de l’extrême liberté de leur conduite, mais au contraire de son caractère étonnamment strict. Cette régularité on l’observe dans les communautés les plus dénuées de gouvernement. Le problème se complique quand la conquête, phénomène assez tardif dans l’histoire humaine, rassemble plusieurs communautés à mœurs distinctes sous un même gouvernement. Le peuple novateur se porte de tous côtés à des actes originaux. Alors intervient une Loi qui lui ouvre les avenues de développement fécondes, tandis que lui sont fermées de toute l’autorité d’un vouloir divin celles qui le mèneraient à sa propre destruction. Ce n’est pas le pouvoir qui légifère mais Dieu par la bouche d’hommes inspirés ou profondément convaincus. Puis les hommes se sont risqués à porter le jugement. Ce qui nous apparaît comme la plus haute expression de l’autorité, dire ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait, distinguer le licite et l’illicite, cela n’a point appartenu au Pouvoir politique avant un stade extrêmement tardif de son développement.
Sans doute les règles du droit romain apparaissent très tôt divorcées de toute connotation religieuse. Mais ces commandements civils, ces institutions civiles sont le décalque exact d’anciens commandements et d’anciennes institutions de caractère sacré.
Il y a deux sortes de lois : la Loi-commandement, reçue d’en haut. Dieu en est l’auteur. Enfreindre cette loi, c’est l’offenser. On en sera puni, que le pouvoir temporel y prête la main ou non. Et les Lois-règlements, faites par les hommes pour discipliner des conduites que les progrès de la complication sociale diversifient sans cesse. Les Romains sont le peuple le moins mystique peut-être que la terre ait porté. Et c’est pourquoi ils ont si tôt séparé du fas, ce qu’exigent les Dieux, le jus, ce qu’aménagent les hommes. Entraînés par la passion ou flattés par la puissance, les hommes commettent de fréquentes et graves violations, nul plus que les princes.
On doit se garder de confondre la Loi divine avec la Coutume. La coutume est une cristallisation de tous les usages. La Loi au contraire, laisse passer les variations favorables : elle agit, si l’on veut, comme un filtre sélectif. Par ailleurs, on ne peut pas dire que le Peuple ou l’assemblée enlève au Pouvoir la capacité de faire seul les lois, car, cette capacité, il ne la possédait point. Le concours du peuple ou d’une assemblée, loin d’entraver une liberté qu’ils n’avaient point, permet au contraire à l’activité gouvernementale de s’étendre. C’est le Pouvoir qui, au Moyen Age, convoque les Parlements d’Angleterre et les Etats généraux de France. On ne fait d’abord que constater la coutume. Puis, très progressivement, on introduit des lois innovatrices mais volontiers présentées comme des retours aux bons usages anciens. C’est la pratique législative qui a peu à peu accrédité la notion qu’on pouvait, par proclamation, non pas constater des droits, un Droit, mais les créer. Les plus grands esprits du XVIIIe l’ont tellement compris qu’ils ont voulu donner au législateur une digue et un incontestable guide : c’est la « religion naturelle » de Rousseau, c’est la « morale naturelle » de Voltaire. Mais ces digues ne pouvaient tenir une fois l’homme déclaré « mesure de toutes choses ». Une fois l’homme déclaré mesure de toutes choses, il n’y a plus ni Vrai, ni Bien, ni Juste, mais seulement des opinions dont le conflit ne peut être tranché que par la force politique. Le siècle du rationalisme est celui des despotes éclairés.
 Le Pouvoir, nous dit Jouvenel, a des origines à la fois magiques et guerrières.
Le Pouvoir, nous dit Jouvenel, a des origines à la fois magiques et guerrières.
Depuis l’Antiquité, les penseurs ont vu dans la famille la société initiale, dans l’autorité paternelle la première forme du commandement. L’agrégation des familles forme la société présidée par le père des pères ou bien les chefs des familles patriarcales s’associent volontairement : on arrive à considérer soit le gouvernement monarchique, soit le gouvernement sénatorial comme naturel. Cette conception classique est jetée à bas dans les années 1860. Les sociétés sauvages n’entrent pas dans la classification tripartite, monarchie, aristocratie, démocratie. Ce ne sont pas les labours et façons culturales qui assurent une bonne récolte mais les rites. Il semble que le pouvoir gérontocratique et ritualiste soit valable pour toutes les sociétés primitives. Le Pouvoir magique exerce un commandement politique, le seul que connaissent les peuples primitifs. Son principe est la crainte, son rôle social la fixation des coutumes. Aujourd’hui, comme il y a dix mille ans, un Pouvoir ne se maintient plus quand il a perdu sa vertu magique.
La guerre cependant produit un profond ébranlement social en bouleversant la hiérarchie établie : l’emporte non le plus chargé de gris-gris mais le plus vaillant et le plus robuste. La gérontocratie était riche par accaparement de la richesse tribale, l’aristocratie l’est aussi, mais par le pillage. L’autorité paternelle est née de la conquête des femmes. La guerre enrichit inégalement. Les gentes s’enrichissent par la polygamie, l’esclavage et le clientélisme.
Il faut un chef pour la guerre qui jouisse d’une autorité absolue et qui a besoin de s’accorder avec les autres chefs de gentes sans lesquels il ne peut rien, le Sénat. La royauté présente un dualisme fondamental : le prêtre (rex) et le chef d’aventure (dux), le noyau mystique et la volonté de puissance. Le roi veut nécessairement enlever aux puissants leur pouvoir, il cherche et obtient l’appui de la poussière plébéienne. Le Pouvoir tend par une logique nécessaire à diminuer l’inégalité sociale et à augmenter et centraliser la puissance publique. Les rassemblements de sociétés diverses par une petite nation conquérante ont chaque fois offert au chef de celle-ci une chance prodigieuse d’absolutisme. Pour qu’une volonté se transmette et s’exécute dans un vaste royaume, il faut tout un système : l’appareil d’État est l’instrument naturel et nécessaire de la monarchie.
Les révolutions liquidatrices de la royauté en Grèce et à Rome tendent à empêcher l’élévation politique du roi et l’élévation sociale de la plèbe. Où les chefs de groupe ont triomphé, la res publica est la société maintenue entre eux pour l’avancement de leurs intérêts communs et qui se manifeste dans leur assemblée qui s’élargit avec le temps. Si le roi l’emporte, il décide et agit pour le peuple. Ainsi se forme la notion complexe d’État. La République c’est nous, l’État c’est ce qui commande souverainement à nous. Le moderne est citoyen uniquement à l’occasion des élections où il agit en souverain et le reste du temps, il est sujet de l’appareil.
Mort à la féodalité !
Il ne faut pas confondre les qualités acquises du Pouvoir avec son essence. Il n’est pas vrai que le pouvoir s’évanouisse lorsqu’il agit à l’encontre de la fonction qui lui est assignée. Il continue de commander et d’être obéi. C’est donc qu’il n’est pas confondu avec la Nation. C’est le Pouvoir pur. L’idée que le commandement ait été voulu par ceux qui obéissent est absurde : elle impliquerait que la collectivité où s’érige un commandement avait des besoins, des sentiments communs; qu’elle était une communauté. Or les communautés étendues n’ont précisément été créées que par l’imposition d’une même force à des groupes disparates. Le pouvoir a l’aînesse sur la Nation.
Ce pouvoir, la « bande de brigands » de Saint Augustin, ne peut se réclamer d’aucune légitimité. Il ne poursuit aucune juste fin; son seul souci est d’exploiter à son profit les vaincus.
Seulement, plus la société maîtresse étend l’aire de sa domination, plus son joug est difficile à maintenir : si bien qu’à l’intérieur de la société maîtresse, un commandement par rapport à elle-même tend à s’affirmer. C’est le pouvoir personnel, royal.
Le Pouvoir pur est un commandement qui existe par soi-même. Il n’est pas l’émanation de la Nation d’une création plus récente. Le principe de formation des vastes agrégats n’est autre que la conquête. L’État résulte essentiellement des succès d’une bande de brigands. Le seul souci de ce Pouvoir est d’exploiter à son profit les vaincus. Le chef de la bande victorieuse peut organiser à son profit une partie des forces latentes dans l’ensemble conquis : la force passe des mains collectives des conquérants aux mains individuelles du roi. Le commandement qui se prend pour fin est amené à veiller sur le bien commun. Le monarque est un élément dominateur parasitaire mais où le plus grand nombre possible des sujets trouvent leur avantage. Les conditions matérielles d’existence d’une Nation sont créés par la conquête mais ce n’est pas encore un Tout : le monarque va constituer le centre de cristallisation du sentiment national.
Le monarque a désormais à son profit une partie des forces latentes, dont il peut user contre ses propres associés. C’est la lutte contre la féodalité. C’est une singulière illusion que la loi de la majorité ne fonctionne qu’en démocratie. Le roi, un homme tout seul, a plus qu’aucun gouvernement besoin que la majeure partie des forces sociales penche en sa faveur.
Ce qui commande, c’est maintenant le roi avec ses serviteurs permanents, ministeriales. Le monarque et son administration dominent, et d’autant mieux qu’ils rendent d’indispensables services.
Le roi commande avec ses serviteurs permanents et dispense les bienfaits de l’ordre, de la justice, de la sécurité, de la prospérité comme si à la nature basique égoïste s’était substitué une nature acquise sociale. En durant, le Pouvoir se socialise, il doit se socialiser pour durer. Ensuite, on chasse l’occupant du palais et on met à sa place des représentants de la Nation.
Dès que le but social n’est pas poursuivi en commun mais qu’un groupe particulier se différencie pour y vaquer de façon permanente, ce groupe responsable forme corps, acquiert une vie et des intérêts propres. Le commandement est une altitude, on y respire un autre air. Le meneur se persuade aisément qu’il ne veut que servir l’ensemble.
La divine surprise de l’intérêt général
Mais en instituant un appareil destiné à la servir, la Société a donné naissance à une petite société se distinguant d’elle. C’est qu’en effet il y a un climat de pouvoir qui altère les hommes. Non que ces derniers soient d’obscurs arrivistes, mais la logique égoïste du Pouvoir pur ne saurait être négligée.
C’est le principe égoïste qui fournit au Pouvoir cette vigueur intime sans laquelle il ne saurait remplir cette fonction : rien dans le règne naturel ne continue de vivre qui ne soit soutenu par un intense et féroce amour de soi-même. Une certaine conviction de supériorité, un caractère impérieux sont convenables aux dirigeants. Il suffit que les dirigeants affectent une grande austérité pour que le vulgaire leur donne quitus de tout égoïsme, comme si les vraies voluptés de l’autoritaire n’étaient point ailleurs. Diriger un peuple, quelle dilatation du Moi ! Là où passent rapidement les occupants du Pouvoir, c’est dans les fonctionnaires que réside l’égoïsme sublimé conservateur du Pouvoir. La croissance extensive du Pouvoir a été davantage commentée que sa croissance intensive : dimensions de l’armée, charge des impôts, nombre des fonctionnaires. La puissance publique n’est qu’un des pouvoirs présents dans la Société avec d’autres, les pouvoirs sociaux, qui sont à la fois ses collaborateurs et ses rivaux. Chaque autorité particulière tend à se grandir, ce qui donne à l’État sa chance principale. La croissance de son autorité apparaît aux individus moins comme une entreprise contre leur liberté que comme un effort destructeur des dominations auxquels ils sont assujettis, cause capitale de la complicité perpétuelle des sujets avec le Pouvoir. S’il n’est pas capable d’une justice expéditive, d’une largesse soudaine, le Pouvoir perd son attrait féerique.
Lorsque le pouvoir demande des ressources pour lui-même, il épuise vite la complaisance des sujets. Pour obtenir des contributions, il faut que le Pouvoir puisse invoquer l’intérêt général. (C’est la Guerre de Cent ans qui a accoutumé le peuple à l’impôt permanent). Par ailleurs, la pensée philosophique utopiste, en imaginant l’ordre dans la simplicité, élargit la fonction du Pouvoir, même si elle en combat parfois les détenteurs. Nos grands bâtisseurs de Paradis (Platon, More, Campanella) ont en réalité construit des tyrannies. Ainsi le philosophe travaille pour le Pouvoir. Se proclamant altruiste et se donnant pour le réalisateur d’un rêve de la pensée, le Pouvoir peut briser tout obstacle à sa marche triomphale.
La course au totalitarisme
On peut observer le progrès du Pouvoir par l’exploitation des ressources que lui offre son domaine national : il change alors le rapport de ses moyens à ceux de ses voisins, s’égale avec un faible fonds à de grandes puissances, et, si ce fonds est ample, se rend capable d’hégémonie. Ainsi aucun Etat ne peut rester indifférent quand l’un d’eux acquiert plus de droits sur son peuple. Il lui faut sur le sien des droits analogues, ou payer bien cher sa négligence. C’est une réelle course au totalitarisme. Les armements ne sont qu’une expression du Pouvoir. Ils croissent parce que le Pouvoir croît. Et les partis les plus persistants à réclamer leur limitation étaient, par une inconséquence inaperçue, les plus ardents à soutenir l’expansion du Pouvoir !
Le développement de la monarchie absolue, tant en France qu’en Angleterre, est lié aux efforts des deux dynasties pour résister à la menace espagnole. Autre exemple, c’est l’envie que Louis XIV inspire à tous les princes qui est le véritable principe de leurs usurpations sur les peuples. Mais la menace de son hégémonie leur fournit le plus honorable des prétextes pour l’imiter.
La conscription est des plus étranger aux sociétés aristocratiques : ainsi apparut l’ère de la chair à canon. La Prusse, inspirée de l’expérience de la Révolution française, applique pour elle-même un système analogue, aggravé, qui prépare les victoires de 1870. Ces succès épouvantant l’Europe, tous les pays continentaux introduisent alors l’obligation militaire. Pendant la Grande Guerre, apparaît la notion de Guerre totale : à présent, dès le temps de paix, l’Etat préparera l’utilisation intégrale des ressources pour la guerre.
La guerre, une activité essentielle des États
Le Pouvoir administre pour conquérir et conquiert pour administrer. Plus les Pouvoirs sont intimement liés aux peuples qu’ils régissent plus ils obtiennent d’eux. Les grands pas dans la militarisation sont liés à de grandes avances du Pouvoir. Le régime social qui donne le moins à la guerre est le régime aristocratique car si la classe dominante est guerrière, elle est seule guerrière. Le développement de la monarchie absolue en Angleterre et en France est liée aux efforts des deux dynasties pour résister à la menace espagnole. Mais l’accroissement des prélèvements étatiques sur la nation ne donne qu’un avantage éphémère et incite les rivaux à des pratiques semblables. Toute la nation devient aux mains de l’État un outil de guerre. La seconde guerre mondiale a été l’occasion du triomphe de l’État. Tout est jeté dans la guerre parce que le Pouvoir dispose de tout. Ceux qui sont l’État n’admettent pas d’intérêt de la Nation distinct de l’intérêt de l’État.
La métaphysique du Pouvoir
 « Dans un pays où l’Etat est le seul employeur, toute opposition signifie mort par inanition. L’ancien principe : qui ne travaille pas, ne mange pas, est remplacé par un nouveau : qui n’obéit pas, ne mange pas. »
« Dans un pays où l’Etat est le seul employeur, toute opposition signifie mort par inanition. L’ancien principe : qui ne travaille pas, ne mange pas, est remplacé par un nouveau : qui n’obéit pas, ne mange pas. »
Léon Trotski, 1937
Fasciné par la croissance ininterrompue du Pouvoir qui rendit possible la guerre totale déclenchée par Hitler, Bertrand de Jouvenel s’est donné pour tâche dans Du pouvoir (Genève, 1945) d’étudier cette croissance. Du pouvoir, Histoire naturelle de sa croissance est selon son auteur Bertrand de Jouvenel un livre de guerre à tous égards (…) une méditation sur la marche historique à la guerre totale.
Lorsque nous remontons à l’époque (XIe-XIIe siècles) où commencent de se former les premiers d’entre les États modernes, la guerre est toute petite car le pouvoir est petit : il ne dispose pas de ces deux leviers essentiels, l’obligation militaire et le droit d’imposer. Mais le pouvoir s’efforce de grandir et au terme de la Guerre de Cent Ans, par la taille et les compagnies d’ordonnance, il n’a plus besoin de mendier mais dispose d’une dotation permanente. Depuis la puissance publique a continué de grandir à un rythme accéléré. Autrefois visible (le Roi), le Pouvoir est à présent masqué par son anonymat : il se prétend instrument de la volonté générale. En ouvrant à toutes les ambitions la perspective du Pouvoir, ce régime facilite beaucoup son extension. La démocratie, telle que nous l’avons pratiquée, centralisatrice, règlementeuse et absolutiste apparaît comme la période d’incubation de la tyrannie. Voici quelle est, pour Jouvenel, la métaphysique du Pouvoir.
L’obéissance civile, un « fait de nature »
L’ordre émané du pouvoir obtient l’obéissance des membres de la communauté. Connaître les causes de l’obéissance, c’est connaître la nature du Pouvoir. Quoi de plus surprenant que la miraculeuse obéissance de milliers ou millions d’hommes se pliant aux règles et aux ordres de quelques-uns ?
S’il n’est pas l’œuvre de la seule force, l’empire du Pouvoir n’est pas non plus l’œuvre de la seule participation, puisqu’on le trouve où la Société ne participe nullement au Pouvoir. Le Pouvoir est pour nous un fait de nature : la suite des gouvernements d’une même société peut être regardé comme un seul gouvernement qui subsiste toujours et s’enrichit continuellement. La pensée humaine a cherché la justification théorique de l’obéissance : soit parce que (un droit exercé par le Pouvoir à la condition d’être légitime) soit en vue de (le but que poursuit le Pouvoir, le Bien Commun). Dans l’obéissance, il entre une part énorme de croyance, de créance, de crédit.
Les théories classiques qui justifient le commandement politique sont les théories de la souveraineté. Une volonté suprême ordonne et régit la communauté humaine : le droit divin d’une part, la souveraineté populaire d’autre part.
Le crépuscule de la souveraineté divine
On prétend que le droit divin, incarné par la « souveraineté divine », a soutenu, pendant les « temps obscurs du Moyen Age », une monarchie arbitraire et illimitée. Tout ceci est faux : le pouvoir médiéval était partagé (Curia Regis), limité (par les seigneurs), et surtout il n’était pas souverain (il n’avait pas la puissance législative, domaine de la lex terrae). On a répété la formule de Saint Paul, que tout pouvoir vient de Dieu, beaucoup moins pour inviter les sujets à l’obéissance envers leur souverain que pour inviter le pouvoir… à l’obéissance envers Dieu. Si le souverain remplissait mal sa mission, l’Eglise disposait à son égard de sanctions (l’Empereur Henri IV vint s’agenouiller devant Grégoire VII dans la neige de Canossa).
Cette souveraineté divine pris fin sous une double attaque : d’une part, le roi, pour briser l’Eglise, eut recours à la tradition juridique romaine (qui attribue la souveraineté… au peuple !, notamment chez Marsile de Padoue) ; d’autre part, la révolution religieuse de Luther permit d’opposer Dieu au peuple cette fois. Pour arguer du Peuple contre Dieu puis arguer de Dieu contre le Peuple, double manœuvre nécessaire à la construction de l’absolutisme, il aura donc fallu une révolution religieuse. Ainsi les princes, rompant avec l’Eglise de Rome, en profitèrent pour s’attribuer comme propriété le droit souverain qui jusqu’alors ne leur avait été reconnu que comme mandat sous contrôle.
L’avènement de la souveraineté populaire
Les jésuites, pourchassés par les princes, affirment que Dieu a voulu l’existence du pouvoir parce qu’il a donné à l’homme une nature sociale. Mais il n’a pas lui-même organisé ce gouvernement. Cela appartient au peuple de cette communauté. (Bellarmin disait : « s’il advient une cause légitime, la multitude peut changer la royauté en aristocratie ou démocratie et à rebours; comme nous lisons qu’il s’est fait à Rome »). C’est l’avènement du concept de souveraineté populaire.
Mais, nous dira-t-on, la souveraineté populaire n’est-elle pas la théorie qui fait le plus obstacle à l’absolutisme ? Là est l’erreur. Hobbes, notamment, déduira de la souveraineté du peuple le droit illimité du pouvoir. L’homme ou l’assemblée à qui ont été remis sans restriction des droits individuels illimités, possède alors un droit collectif illimité. Si l’on suppose l’existence d’un souverain, il faut qu’il ait reçu tous les droits des individus, et l’individu par suite n’en réserve aucun qui ne soit opposable au Souverain.
Comme le dit Rousseau : « s’il restait quelques droits aux particuliers, comme il n’y aurait aucun supérieur commun qui put prononcer entre eux et le public, chacun, étant en quelque point son propre juge, prétendrait bientôt l’être en tous ».
Ce n’est pas de la souveraineté de Dieu que Hobbes déduira le droit illimité du Pouvoir : c’est de la souveraineté du Peuple. Dès lors qu’on postule un droit de commander qui n’a point de bornes, il est moins choquant de supposer ce droit appartenant à tous. Le peuple crée la Souveraineté sans la donner, il en reste perpétuellement investi. Tous les pouvoirs tyranniques qui se sont depuis élevés, ont justifié leurs injures aux droits individuels par la prétention qu’ils s’arrogeaient de représenter le Peuple. Toutes ces théories tendent à faire obéir les sujets en montrant derrière le Pouvoir un principe transcendant et à subordonner le Pouvoir audit principe. Il peut sortir de la souveraineté populaire un despotisme plus poussé que de la souveraineté divine : la volonté générale n’est pas fixe mais mobile et la liberté du Pouvoir s’appelle l’Arbitraire.
Ce prince, il est vrai, commande non en vertu d’un droit souverain, mais il ne fait qu’exercer des pouvoirs qui lui sont conférés. Or ces pouvoirs sont absolus, illimités. Les forces qui, dans la société, peuvent les modérer ou les arrêter, sont inconnues.
La théorie organique du pouvoir, ou la souveraineté nationale
Tant que subsiste dans les esprits l’idée que les hommes sont la réalité et la Société une convention, la notion de Souveraineté n’a donc pu faire les ravages qu’elle cause sitôt que cette philosophie s’affaiblit.
Puis a été développée une théorie organique du pouvoir : la société prit la figure de la Nation. Le roi était un autre que le sujet ; pas la nation, qui est le moi hypostasié, le « nous ». Les droits subjectifs des individus perdent leur valeur, au profit d’une Moralité qui doit se réaliser dans la société.
Hegel décerne à la Nation un brevet d’existence philosophique. Au nom du Bien commun, le Pouvoir pourra justifier n’importe quel accroissement de son étendue. La souveraineté nationale est un Être collectif plus important que les individus. Pour Hegel, la Volonté générale accomplit ce qui doit être accompli, avec ou sans l’assentiment des individus qui n’ont pas conscience du but. Il appartient donc à la partie consciente de vouloir pour le Tout (le prolétariat chez Marx). Spencer au sens biologique, Comte au sens figuré, sont d’accord pour reconnaître dans le Pouvoir un produit de l’évolution, un organe dont le but est la coordination de la diversité sociale et la cohérence des parties. Il est vrai que Spencer, l’un des fondateurs de la théorie organiciste, voulait tout au contraire un amoindrissement du Pouvoir. Certes, disait-il, pour son activité extérieure, qui est la lutte contre les autres sociétés, l’organisme social se mobilise toujours plus complètement. Mais au contraire son activité intérieure (qui se développe au moyen de la diversification des fonctions), ne réclame pas d’unique régulateur central, et élabore au contraire des organes régulateurs distincts et nombreux. Mais sa vision de la société comme organisme va se retourner contre lui, grâce notamment à Durkheim.
Les théories s’étagent donc historiquement de telle sorte qu’elles sont de plus en plus favorables au Pouvoir. Elles peuvent être engendrées dans l’intention de poser des obstacles au Pouvoir ; elles finissent néanmoins par le servir.
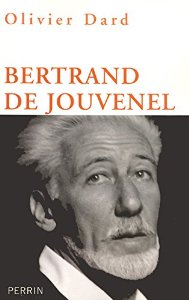 Voici quelques bonnes feuilles de la première biographie consacrée à Bertrand de Jouvenel et rédigée par Olivier Dard, professeur à l’université de Metz (Perrin, 2008). L’enfance particulière et privilégiée de Bertrand de Jouvenel, son adolescence mondaine, grâce au salon de sa mère et à son entregent, sa relation juvénile avec Colette, l’influence de ses deux mentors, Henry, son père, journaliste au Matin, et plus encore Robert, son oncle, rédacteur en chef de L’Œuvre, expliquent à notre sens largement les engagements et passions qui suivront Bertrand tout au long de son existence.
Voici quelques bonnes feuilles de la première biographie consacrée à Bertrand de Jouvenel et rédigée par Olivier Dard, professeur à l’université de Metz (Perrin, 2008). L’enfance particulière et privilégiée de Bertrand de Jouvenel, son adolescence mondaine, grâce au salon de sa mère et à son entregent, sa relation juvénile avec Colette, l’influence de ses deux mentors, Henry, son père, journaliste au Matin, et plus encore Robert, son oncle, rédacteur en chef de L’Œuvre, expliquent à notre sens largement les engagements et passions qui suivront Bertrand tout au long de son existence.
Bertrand de Jouvenel voit le jour le 31 octobre 1903. Il est l’unique enfant d’un couple mondain et politique, né l’année précédente des conséquences de l’affaire Dreyfus. Sarah Claire Boas et Henry de Jouvenel ont fière allure : elle anime un salon, plaque tournante du Paris distingué et cultivé pendant vingt ans, tandis qu’il est un journaliste et homme politique plein d’avenir.
Claire est la fille d’Alfred Boas, famille lointainement originaire des Pays-Bas dont les racines les plus solides se trouvent en Alsace. L’industriel Alfred Boas, juif et franc-maçon, a été un bailleur de fonds pour la révision du procès Dreyfus. SA firme Boas-Rodrigues et Cie fabrique des lampes à acétylène utilisées dans l’industrie automobile naissante. D’où une aisance affichée entre l’hôtel particulier parisien et la villégiature de Montmorency, dotée d’un court de tennis et d’une bibliothèque abondante, deux souvenirs importants pour le jeune Bertrand.
Les relations entre la mère et son fils semblent avoir été délicates, puisqu’il note encore à 66 ans : « Ma mère, ma mère pensée obsédante (…) ? Mes goûts n’étaient pas les siens, j’ai manqué de compréhension et cela m’a hanté bien avant sa mort et depuis ». Sept ans plus tard, il est encore plus abrupt : « Il semble, chose épouvantable, horrible à dire, que je n’aie pas aimé ma mère. Elle m’avait aimé pourtant mais j’ai très peu de souvenirs d’enfance où elle figure. Elle est morte en 1967 à 89 ans. J’avais 64 ans. Et dans cette immensité de durée, ne s’était pas trouvé pour moi le temps de la comprendre. Cela me paraît maintenant inexplicable (…) Ma mère a tout fait pour moi mais je ne l’ai pas senti. » Pourtant, lorsque sa mère décède, le vide est profond : « Je n’appellerai pas Littré 59 04 pour mon salut quotidien (…) Mais combien me manque aujourd’hui ce devoir filial ».
Ses oncles du côté Boas, notamment Robert, officier de cavalerie qui a quitté l’armée après l’affaire Dreyfus pour se lancer dans les affaires (le métro Nord-Sud) entourent aussi l’enfance de Bertrand, qui ne voit alors son père que de loin en loin. Claire Boas est une femme active, aux centres d’intérêts variés. Femme de lettres, elle a écrit deux ouvrages sous le pseudonyme d’Ariel. Le premier est un livre de contes pour enfants préfacé par Anatole France ; le second, intitulé Quelques règles du jeu de la vie, est préfacé de Paul Valéry. Mondaine, Claire reçoit beaucoup à dîner et règne sur son salon du boulevard Saint-Germain. Son fils a insisté sur l’aura de sa mère qualifiée par ses soins d’ « instigatrice efficace » dont il s’est inspiré du comportement pour décrire « l’instigation » dans son essai sur la « Politique pure ». Certaines sources rendent hommage à son « ardeur à organiser ces réunions où Américains et Français, politiques et industriels se rencontraient », au point d’y gagner le sobriquet d’ « insistance publique ». Mais d’autres témoignages sont nettement moins bienveillants. Louise Weiss, liée par cousinage à la famille Boas, a ainsi laissé un tableau acide d’une de ces réceptions : « Le spectacle était d’une fantaisie frisant l’aberration. Les invités arrivaient en surnombre. Les maîtres d’hôtel ne savaient où fourrer leurs assiettes. Claire ne les connaissait ou ne les reconnaissait pas toujours. Tant pis. Ils lui baisaient la main, ravis, dans une surenchère de compliments. Quelquefois, Claire oubliait ses commensaux et n’apparaissait alors que dans l’après-midi, ondulant dans ses boas de plumes, les cheveux fleuris de violettes. Ses hôtes qui s’étaient mis à table sans elle, s’excusaient. En retour, elle s’extasiait sur la beauté des plus laids et l’intelligence des plus sots, principes fondamentaux de sa diplomatie qui l’allait guère plus loin ». Le jugement est excessif ; malgré ses côtés fantasques, Claire Boas entretient des liens solides dans le personnel diplomatique français, à commencer par Philippe Berthelot, secrétaire général du Quai d’Orsay à partir de septembre 1920. Ce dernier lui fait jouer un rôle d’hôtesse officieuse de la diplomatie française.
La question tchécoslovaque que sous-tend l’avenir et la destruction de l’Autriche-Hongrie, agite les milieux intellectuels (où un lobby pro-tchèque est animé par le géographe Ernest Denis depuis le début du 1915) mais aussi les salons parisiens. Celui de Claire accueille, dès 1915, Milan Stefanik, jeune astronome slovaque, engagé volontaire dans l’armée française. En février 1916, Claire facilite un entretien entre Masaryk et Aristide Briand, alors président du Conseil. Son soutien à la cause tchécoslovaque ne se dément pas et, en 1919, elle joue « le rôle d’ambassadrice (…) des volontés des deux ardents patriotes slovaques et tchèques, ses amis Milan Stefanik et Edouard Benes ». Cette atmosphère a profondément marqué le jeune Bertrand. Il n’a cessé de revenir sur l’importance de Stefanik et évoque par la suite la question tchécoslovaque sur un registre où l’affectif domine : « Tchéco… Slovaquie… La première fois que j’entendis ce vocable double, à consonance étrange, c’était pendant la guerre, à la fin de 1915, je crois. Une voix hésitante essayait ces deux mots, s’assurait s’ils rendaient, associés, un son ferme et d’heureux augure. Je regardais l’homme qui parlait. Son visage aux traits prononcés ressemblait, avec un ton blême, creusé par la petite vérole, au moulage de plâtre d’un César. J’avais devant moi le fondateur d’un Etat. Milan Stefanik m’entraîna – Je me souviens encore de la pression brusque et affectueuse de sa main sur mon épaule – vers la carte d’Europe affichée dans ma chambre. – Qu’y a-t-il là ? me demanda-t-il. – L’Empire austro-hongrois. Son doigt fit un tracé. – Ici, dit-il, il y aura la Tchécoslovaquie ». Le salon maternel « a contribué à développer » chez le jeune Bertrand « l’intérêt pour la chose publique et la politique », sur un mode exalté et sentimental bien plus que raisonné, à la différence de ce que lui inculquent son père et surtout son oncle, Robert de Jouvenel.
Claire Boas de Jouvenel est aussi la présidente fondatrice de différentes associations caritatives, parmi lesquelles l’Association de travail et d’assistance, l’Association et la Revue des Messages et surtout « La Bienvenue française ». Cette dernière, reconnue d’utilité publique par un décret du 18 mars 1922, se présente comme une « association créée pour favoriser les échanges intellectuels et moraux entre nations ». Claire Boas de Jouvenel en est le secrétaire général et réunit autour d’elle un conseil d’administration prestigieux : le maréchal Foch est président ; les vice-présidents sont, entre autres, le professeur de droit Joseph Barthélémy, célèbre constitutionnaliste et futur garde des Sceaux de l’Etat français, Henri Cachard, ancien président de la chambre de commerce américaine de Paris ; les fonctions de trésorier sont assurées par le baron Edouard de Rothschild. Parmi les membres les plus éminents, on rencontre des hommes politiques (dont le dirigeant radical Edouard Herriot), mais surtout des industriels (la patron-ingénieur et magnat de l’électricité Ernest Mercier) et des banquiers (Cahen-Fuzier, directeur de la Banque de l’Union parisienne). Le « comité des réceptions » est présidé par la duchesse d’Uzès. La finalité de La Bienvenue française est d’ « inciter nos Alliés et Amis Etrangers à venir en France, soit en Délégation représentant les grands groupements de leur pays, soit individuellement ». Pour ce faire, l’association s’est dotée de fichiers très complets, rassemblés au bureau central de Paris et permettant « aux étrangers recommandés par leur ambassade ou par les grandes institutions de leur pays d’y trouver les renseignements concernant toutes les branches de l’activité intellectuelle, sociale, artistique, scientifique, économique, etc. de la France. » Enfin, l’association entretient des contacts réguliers avec les institutions, publiques ou privées, référencées dans ces fichiers.
Le jeune Bertrand de Jouvenel baigne donc, dès son adolescence, dans des milieux élitaires et cosmopolites. Il s’ennuie souvent dans les atmosphères mondaines qu’affectionne sa mère, en particulier lorsqu’il doit l’accompagner dans ses sorties : « Ce qui faisait son bonheur, c’était la société, et, à la différence de tant d’autres mère qui craignent de faire connaître leur âge en se faisant accompagner d’un fils ou d’une fille, elle aimait m’y entraîner. (…) Les dimanches de ma jeunesse où je me laissais entraîner au golf, je ruminais mon regret de ne pas être assis dans le couloir obscur du boulevard Saint-Germain où les livres de mon père étaient rangés. » Il voyage également dans les principales stations d’Europe, de Vichy à Saint-Moritz. Cette socialisation privilégiée ne présente qu’une partie des atouts dont le jeune garçon dispose : la famille paternelle compte telle aussi dans le Paris de l’avant-guerre.
Les origines des Jouvenel restent confuses jusqu’au XVIIe siècle, époque à laquelle il est établi que la famille occupe un ancien monastère sis à Aubazines, en Corrèze. Au XVIIIe siècle, le titre de baron est accordé à l’une des branches de la famille, mais c’est à partir du XIXe siècle que le nom acquiert une certaine notoriété. L’arrière-grand-père de Bertrand, Léon de Jouvenel (1811-1886), monté à Paris pour y faire fortune, épouse la fille d’un des généraux de Napoléon Ier, Gourlez de la Motte. Notable orléaniste, Léon de Jouvenel achète en 1844 le château de Castel Novel près de Brive. En 1846, il est élu député de la Corrèze, puis réélu en 1852, 1857 et 1870. Son fils Raoul (1843-1910), le grand-père de Bertrand, est sous-préfet sous le Second Empire, puis préfet au lendemain de la guerre de 1870. Le triomphe des républicains et le retrait de Mac-Mahon marquent la fin de sa carrière. Catholique et monarchiste, cet « exilé de l’intérieur » se retire alors sur ses terres à Castel Novel, transformé en gentilhommière. Ses deux fils, Henry (1876-1935), le père de Bertrand, et Robert (1881-1935), ne partagent pas ses réticences à l’égard de la Troisième République.
Henry, instruit dans le giron familial, est monté à Paris en 1893 pour préparer son baccalauréat au collège Stanislas. L’établissement est alors dominé par la figure de Marc Sangnier, le fondateur du Sillon. Henry de Jouvenel y rencontre des personnalités qui comptèrent sa vie durant, à commencer par Anatole de Monzie (futur avocat et ministre) et Louis Gillet (futur historien de l’art et académicien) avec lesquels il se retrouve en 1894-5 en classe de rhétorique supérieure. […] Après le baccalauréat, Henry de Jouvenel entame une licence de philosophie en Sorbonne et fait, en 1896-7, un éphémère passage à l’Ecole libre des sciences politiques. De sensibilité de gauche, Henry de Jouvenel participe en 1896 aux manifestations devant le Sénat, qui vient de renverser le gouvernement de Léon Bourgeois, promoteur du solidarisme. Il est séduit par la figure de Joseph Paul-Boncour, socialiste indépendant et jeune avocat brillant. A la recherche de causes à défendre, il fonde avec Anatole de Monzie un hebdomadaire éphémère, La Défense des colonies. La lecture du « J’Accuse » de Zola (13 janvier 1898), alors qu’il est en garnison à Bellac, l’entraîne dans le camp des dreyfusards. Il rencontre par ce biais son futur beau-père, Alfred Boas, qui lui présente sa fille. Au début du XXe siècle, le destin d’Henry de Jouvenel bascule. Il accède aux fonctions de chef de cabinet du garde des Sceaux en 1902, puis de directeur de cabinet du ministre du commerce en 1906. Surtout, entré en 1905 au Matin, de Maurice Bunau-Varilla, l’un des plus influents quotidiens du temps, il s’y impose rapidement et en devient un des rédacteurs en chef.
Dans Un voyageur dans le siècle, ouvrage dédié à sa mère, Bertrand reprend les détails sur son enfance et son adolescence qui figurent déjà dans son Journal d’août 1943. Il grandit à Paris, au 2, rue de Saint-Simon, tout près du boulevard Saint-Germain. L’immeuble est très cossu et son entrée, imposante : boiseries sculptées, rampe d’escalier surmontée d’une tête de lion. L’appartement, de « style Michel Zévaco, résurrection du XVIe siècle en ce XIXe siècle finissant », est distribué en hautes pièces éclairées de vitraux en losange. Dans ce décor de « sérénité » et de lumière « de cathédrale », l’enfant aurait sans doute coulé des jours merveilleux sans le divorce de ses parents en 1906. Il n’a que trois ans lorsque son père quitte définitivement le foyer. Bertrand de Jouvenel n’est jamais revenu sur les raisons de cette séparation : « Je n’ai jamais cherché à élucider des vies privées. La chose publique toujours ! » En fait, Henry de Jouvenel vient d’entrer au Matin. Sa vie privée et ses nouvelles fonctions sont incompatibles, comme il s’en explique dans une lettre à Anatole de Monzie : « La reprendre (mon épouse), c’est quitter Le Matin pour lequel elle a le sentiment que je l’ai quittée ». Le jeune Bertrand est un enfant solitaire dont la principale compagnie est celle d’un domestique : « Je n’étais heureux que dans la cuisine ou la lingerie auprès de Jeanne l’Ardennaise. C’est une de ces femmes que j’ai le plus aimées. » […] Dans l’immense appartement, l’enfant cherche les traces de son père : dans un bureau aux persiennes closes, il contemple les livres de la bibliothèque restés sur place et se prend d’affection pour un grand fauteuil Henri II et un canapé qui l’ont accompagné au fil des déménagements. Ce père, Bertrand va parfois, accompagné de sa gouvernante, l’embrasser sur la terrasse des Tuileries. Plus tard, il lui rend visite chez lui, rue Cortambert, et y découvre son demi-frère Renaud, né en 1907. Le 19 décembre 1912, Henry de Jouvenel épouse la romancière Colette, directrice littéraire du Matin (elle est divorcée depuis 1910 d’Henri Gauthier-Villars, dit « Willy »). […]
Le tableau familial serait incomplet sans l’évocation de ses liens avec Colette, qu’il rencontre à l’âge de seize ans et demi. Au printemps 1920, les relations entre Claire Boas de Jouvenel et son ex-mari sont explosives : Claire continue d’utiliser le nom de Jouvenel dans ses activités mondaines et politiques, au grand dam d’Henry. Bertrand est envoyé en éclaireur boulevard Suchet. Il y découvre Colette lors d’une « première et tremblante visite », où il se dépeint comme « un enfant effrayé par une femme qui lui a été représentée comme redoutable » : « Elle m’intimidait terriblement, ne ressemblant à personne que j’eusse rencontré. » Il éprouve aussitôt une grande fascination pour cette femme, « petite, ramassée, puissante », dont le visage allie la « majesté » du front, « les triangles parfaits des narines », des « yeux beaux et allongés » et des lèvres « très finement dessinées et spirituelles » : « L’air naturel de Colette était extraordinairement imposant ». Colette, quant à elle, appelle Bertrand « mon fils » dans la dédicace de Chéri, avant de s’inspirer, pour écrire Le Blé en herbe publié en 1923, de lui-même pour le personnage de Phil, de son amie Paméla pour celui de Pam, sans oublier Madame Dalleray, « La Dame Blanche » qui « déniaisait le jeune homme. » De fait, le jeune garçon et la romancière, alors âgée de 47 ans, qui a, selon les termes de Bertrand, décidé de « former » son beau-fils, notamment sur le plan de son « éducation sentimentale », sont devenus rapidement amants. Jusqu’à son mariage avec Marcelle Prat en 1925, Bertrand, qui se décrit comme fidèle, vit dans l’ombre de Colette. […]
Fruit de l’instabilité familiale, la formation scolaire du jeune Bertrand est erratique. Il grandit loin des autres enfants et « n’a aucun souvenir de groupe de son enfance. » Elevé par des gouvernantes britanniques ou allemandes, il garde un souvenir privilégié de Helen Cronin, une irlandaise qui s’est occupé de lui entre 8 et 10 ans. Avec elle, il acquiert une excellente maîtrise de l’anglais et découvre la littérature britannique et les chansons révolutionnaires irlandaises. Des précepteurs le prennent aussi en charge. […] Bertrand de Jouvenel n’a passé, en tout et pour tout, que deux fragments d’années dans des établissements scolaires – quelques mois en internat dans le collège de Normandie à Liancourt en 1915 et une année incomplète à l’école Pascal de Paris –, lorsqu’il fait en septembre 1918 son entrée en première au lycée Hoche de Versailles. […]
On dispose de peu d’informations sur la vie personnelle de Robert, le frère cadet d’Henry. On sait cependant l’intérêt qu’a porté cet oncle à son neveu et l’influence qu’il a eue sur le jeune Bertrand, lui servant de « guide » jusqu’à sa mort brutale en 1924. Comme Henry, Robert de Jouvenel est politiquement engagé dans la mouvance radicale. Orateur phare de la Ligue de la République, il siège même un temps au comité exécutif du parti de la rue de Valois. Robert de Jouvenel est surtout une plume reconnue et acérée. Essayiste en vue lancé en 1914 par un titre volontairement provocateur, La République des camarades, il est aussi un journaliste réputé (L’Opinion, L’Eclair) dont le professionnalisme n’échappe pas à Gustave Téry, directeur-fondateur de L’Œuvre, qui en fait son rédacteur en chef. (…) On l’a comparé à Rivarol – ce qui le mettait hors de lui –, à Chamfort et à Prévost-Paradol, mais lui n’aurait pas rallié l’Empire. Il eût été dans l’opposition. En vérité, Jouvenel n’appartenait à aucun parti et il n’eût pas fait bon imposer des mots d’ordre. Ce vrai gentilhomme qui affectait un républicanisme, mettons, aéré, disait dans une prose succulente mais fluide ce qu’il avait à dire, ni plus, ni moins. Il est mort en 1925, assassiné par un chirurgien célèbre dans des conditions affreuses, mais il avait eu le temps de nous enseigner la désinvolture, que le scepticisme n’exclut pas la passion, qu’il n’est pas interdit de sourire en parlant de choses sérieuses et que l’emphase, l’étalage indiscret des grands sentiments est le fait des gens mal élevés. […] Educateur d’une génération, comment n’aurait-il pas influencé son neveu ? Bertrand de Jouvenel note ainsi dans ses Mémoires que, si « le goût de la politique a pris véritablement le dessus, cette orientation fut, dans une très large mesure, le fait de son oncle Robert de Jouvenel. » […]
Il a raconté dans Notre temps les rencontres qui se tenaient au siège de L’Œuvre et dressé sur son oncle un portrait chaleureux : « Le mardi soir, on trouvait Robert de Jouvenel à son bureau de L’Œuvre. La seule lumière que nous eussions, sa lampe de travail, n’éclairait que du papier bleu chargé d’une écriture lourde : article interrompu par notre arrivée, ou notes préparées pour la discussion. On voyait de lui seulement des mains charnues d’évêque batailleur, qui, dans la zone lumineuse, jetaient des jugements et puis revenaient s’accrocher aux entournures du gilet, cramponnées à l’étoffe consistante. Des faits, donnez-moi des faits, demandait-il. De l’autre côté de son bureau, nous étions dix ou quinze enfants raisonneurs, orgueilleux de formules recueillies à l’Ecole libre des sciences politiques ou à la faculté de droit. De temps à autre, un de nous lançait une théorie que chacun consolidait d’un exemple ou d’une citation. Son visage massif sortait alors de l’ombre, animé d’une puissance malicieuse. A grands coups allègres, il renversait notre théorie, et nous étions si bien entraînés à sa suite que nous montions à la charge comme s’il ne se fût pas agi de nous mettre nous-mêmes en déroute. Il se disait doctrinaire et s’excusait de n’apporter aucune doctrine. On a bien vu des républicains avant qu’il y eût une République ! Ils cherchaient avec foi. Ne valaient-ils pas mieux que ceux d’aujourd’hui qui conservent avec scepticisme ? Il n’appartenait ni au parti radical, ni au parti socialiste, mais enfermé dans un parti abstrait qu’il s’était taillé à lui seul, comme les cadets de jadis se taillaient un royaume ; il en prêtait les idées comme on prêtait des soldats. »
Olivier Dard, Bertrand de Jouvenel, Perrin, 2008, 526 pages.
Bertrand de Jouvenel, L’Ethique de la redistribution, Les Belles Lettres, coll. Bibliothèque classique de la liberté, 144 pages, 17,50€, à paraitre le 23 septembre prochain. Acheter sur Amazon
En 1951, tournant le dos à son itinéraire l’ayant mené du socialisme national jusqu’à la collaboration idéologique avec Vichy, Bertrand de Jouvenel (1903-1987) publie au Royaume-Uni et en anglais The Ethics of Redistribution.
Dans le prolongement de Du pouvoir (1945) qui lui avait valu une renommée internationale de penseur politique, cet opus, inédit en français, développe avec une sobre alacrité une critique de l’extension du « Minotaure » que représente l’institution naissante de l’État-providence par le biais de la redistribution massive des revenus. Sa thèse : un inquiétant transfert des pouvoirs de décision des individus s’accomplit ainsi au profit de l’État, toujours plus omnipotent. Jouvenel met à mal le mythe d’une redistribution ne sollicitant que les plus riches. La logique fiscale conduit nécessairement à ponctionner aussi les classes moyennes. Une analyse singulièrement iconoclaste et prémonitoire.
Bertrand de Jouvenel est un auteur classique toujours intéressant. Et son livre The ethics of redistribution (qui curieusement va tout juste être traduit et publié en français) le prouve en s’attaquant à un des fondements jamais discuté (presque indiscutable) du consensus social-démocrate dans lequel il nous faut vivre. L’ouvrage est court mais dense et aborde avec calme et précision, loin de la polémique gratuite, les bases du sujet, le processus qui a débouché sur une énorme bureaucratie étatique dont la justification serait la redistribution des revenus entre les différentes couches socioéconomiques, selon l’idée générale, qui n’a jamais cessé de prendre de l’importance depuis, de « prendre aux riches pour donner aux pauvres ».
Jouvenel développe son argumentation avec tranquillité et précision, délimitant la question en signalant, par exemple, les différences existant entre la redistribution agraire et les arguments modernes en faveur de la redistribution, teintés d’un socialisme à la recherche d’un utopique homme nouveau. D’un trait de plume, il dévoile l’incohérence socialiste en demandant pourquoi le bien de la société passe par l’augmentation de la richesse mais pas dans le cas des individus et pourquoi l’appétit de la richesse serait mauvais chez les individus, mais pas pour la société.
Plus loin, Bertrand de Jouvenel nous montre que sous l’emphase de la redistribution ne se trouve pas le soucis du sort de ceux qui vivent dans des conditions indignes et humiliantes. Il ne s’agit pas de cela, chose parfaitement acceptable, mais propre de toute société saine ; il s’agit d’imposer l’égalitarisme, où il n’est pas si important de fixer un revenu décent que de limiter les revenus (de fait, signale l’auteur, un grand nombre de défenseurs de la redistribution sont moins satisfaits d’un relèvement général du niveau de vie qui conserve les inégalités, préférant de loin un écrasement de celles-ci vers le bas). L’autre trait de cette théorie moderne de la redistribution qui s’est imposée dans nos sociétés est son exigence de ce que l’agent chargé de mener cette tâche à bien soit l’État.Un État chaque fois plus gros et omniprésent, qui prend chaque fois plus de décisions sur les vie des personnes. Pour être plus précis, plus que l’État, Jouvenel pointe le jugement subjectif de la classe qui dessine les politiques.
Par contre, si l’on analyse, chiffres en main, ce qui reste de l’argumentation primaire et sentimentale à la manière de Robin des Bois – Jouvenel retourne le couteau dans la plaie quand il rappelle que c’est devenu une nouvelle habitude d’appeler juste n’importe quelle chose comprise comme émotionnellement désirable –, la réalité est que les riches ont toujours su échapper à la pression fiscale. Le second pas apparaît évident : il s’agit non pas de prendre aux riches, mais bien aux couches croissantes de ce que l’on a coutume d’appeler la classe moyenne. Pour donner aux pauvres ? Au final, pas grand chose, dès lors que l’énorme machinerie sociale, véritable usine à gaz, que nous avons construit, l’État bureaucratique, absorbe une grande partie des ressources enlevées aux familles de la classe moyenne. Et si l’on analyse encore plus en détail, comme le fait Jouvenel, et si nous désagrégeons en groupes plus compacts cette classe nébuleuse, on peut observer comment la redistribution cesse d’aller du haut vers le bas pour se transformer en flux horizontaux qui bénéficient à certains collectifs, qui parfois peuvent même disposer de revenus supérieurs à ceux à qui ont les a enlevés pour soi-disant les attribuer aux plus pauvres de la société. La réalité ressemble finalement bien peu à la théorie émotionnelle initiale.
Il y a bien d’autres choses encore dans ce petit livre : l’argutie d’argumenter sur la base des satisfactions subjectives et de tenter de mesurer le bonheur ; une solide critique de la théorie marginaliste dans les revenus ; la discrimination créée au nom de l’égalité ; comment l’augmentation de la redistribution conduit toujours à une extension des pouvoirs de l’État : le traitement discriminatoire envers les familles et en faveur des corporations, etc. En définitive, un livre important où la thèse centrale est cruciale : les politiques redistributives ont provoqué un changement de mentalité devant les dépenses publiques, dont le principal bénéficiaire n’est pas la classe au revenu le plus bas face à la classe au revenu supérieur, mais bien l’État face au citoyen.
Cet ouvrage est traduit par Michel Lemosse, qui est professeur émérite de civilisation anglaise à l’Université de Nice.
A lire également :