Alors que parait la nouvelle livraison de la revue Laissons Faire, je vous propose ci-dessous un petit dossier consacré à Bertrand de Jouvenel et que je vous ai concocté pour l’occasion.
Bonne lecture !

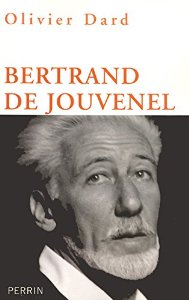 De la souveraineté est un livre de la maturité de Bertrand de Jouvenel, qui gagne à être relu.
De la souveraineté est un livre de la maturité de Bertrand de Jouvenel, qui gagne à être relu.
Dans un Avertissement plein de modestie, l’auteur de Du Pouvoir, dont le présent ouvrage est la suite directe, indique qu’il lui a coûté beaucoup de peines et craint qu’il n’en coûte aussi au lecteur. C’est exact que Bertrand de Jouvenel s’est engagé dans une exploration d’une extrême difficulté (« exploration » est son propre terme), la plus difficile assurément qui puisse de nos jours tenter — ou ne pas tenter — un spécialiste de science politique. Exploration renouvelée à partir de plusieurs points de départ, et non point, comme Du Pouvoir, « la carte bien clairement tracée d’un pays bien connu ». Exploration, enquête (sur l’autorité souveraine), recherche (du bien politique) : en aucune façon un Traité de souveraineté, tel que Jean Bodin en a laissé voici bientôt quatre siècles le magistral monument : mais, pour reprendre une expression du fameux juriste angevin, l’auteur ici a « pris la mire plus haut ».
Si haut que le lecteur moyen, s’il en est à cet ouvrage d’une extrême intensité intellectuelle — et morale — risque d’être plus d’une fois déconcerté, ne serait-ce que par le vocabulaire souvent original par sa rigueur même. Mais où commence et où finit, en pareille matière qui fourmille de fausses évidences, le lecteur moyen ? Je pense donc que la « clef » livrée par l’auteur dans cette étonnante page 23 pour faciliter précisément l’intelligence de son ouvrage sera précieuse à tout lecteur. Bertrand de Jouvenel s’y avoue essentiellement préoccupé des bienfaits que les hommes se procurent mutuellement par la coopération sociale, cette coopération par laquelle, dit-il ailleurs, « l’homme se fait ». En conséquence tout ce qui maintient et tout ce qui enrichit cette coopération — soulignons : enrichit — le trouve attentif. Mais cet enrichissement lui semble dû à l’incessant jaillissement d’initiatives dispersées, tel que l’esprit le plus fort est impuissant à former « une image prévisionnelle épuisant les possibilités futures» de la coopération ; il faut donc écarter l’idée, désormais si chère à tant d’esprits pour des raisons multiples, que cette coopération doive être successivement édifiée à partir d’ « un seul centre organisateur ». Certes, pour que puissent fructifier tous les germes lancés, certaines conditions de stabilité sont nécessaires, et « un immense complexe d’agents de modification et d’agents de régularité », mais l’autorité publique ou souveraine, comme on l’appelle, n’y est qu’un agent « parmi d’autres », le plus puissant mais qui ne doit pas se prendre pour « le seul ». L’auteur préfère la considérer comme le grand complémentaire. Si bien que l’ouvrage, malgré son titre, est beaucoup moins consacré à l’histoire du concept de souveraineté qu’à développer et justifier, étayer cette conception de l’autorité souveraine, simple servante des rapports sociaux, pour le service de l’homme.
La première partie, intitulée « De l’Autorité », développe expressément la conception originale dont il s’agit. La seconde, intitulée « Du Bien politique », et qui correspond spécialement au sous-titre de l’ouvrage, explore le problème de l’emploi légitime du Pouvoir, ou du Bien commun, ou problème du Quoi par opposition au problème du Qui (c’est-à-dire de la source légitime du Pouvoir, lequel a trop éclipsé le premier dans les recherches de la science politique contemporaine). Le même souci la domine de raisonner sur un « réseau social ouvert », où les rapports sociaux sont étendus et diversifiés. La troisième partie, intitulée « Du Souverain », étudie à la lumière de l’histoire, Moyen âge et Ancien régime, le problème d’une bonne régulation de la volonté dominante (c’est ici le reliquat de l’histoire du concept de souveraineté que l’auteur avait eu, pour commencer, dessein d’écrire, avant de s’apercevoir que son étude risquait de faire double emploi avec certains chapitres de Du Pouvoir). Cette bonne régulation, par le jeu de « butoirs sensibles », d’un souverain dont la puissance a pris de plus en plus de plénitude, dont le pouvoir de décision est devenu de plus en plus compréhensif, fait corps avec le souci du bon contenu, de la bonne consistance de la décision revêtue de la forme impérative, autrement dit de « la bonté dans la volonté souveraine », ou Bien politique. Enfin la quatrième partie, « De la Liberté », qui part de Descartes et de Hobbes, qui passe par Rousseau pour aboutir à de fulgurantes considérations sur la liberté d’opinion et la lumière naturelle, don direct de Dieu, semble apporter à deux siècles de distance une vérification singulièrement étoffée à la fameuse phrase de L’Esprit des lois : « II n’y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations, et qui ait frappé les esprits de tant de manières que celui de liberté ». Et ce Montesquieu qui écrivait quelques lignes plus loin qu’il fallait éviter de confondre le pouvoir du peuple avec la liberté du peuple eût reconnu sa pensée, enrichie des résonances de deux siècles tumultueux, dans la cinglante conclusion des pages de Bertrand de Jouvenel consacrées à la liberté comme pouvoir : « Tout cela est important, mais c’est l’histoire de l’impérialisme humain, et non pas l’histoire de la liberté. Et quiconque croit voir la liberté essentiellement dans le pouvoir de l’homme est dénué du vrai sentiment de la liberté ».
Le hasard a voulu que, pendant l’assez long temps où ce livre — qu’il faut lire et relire, quitter et reprendre pour en laisser reposer et fructifier en soi les semences — est resté sur ma table, je fus amené à étudier d’assez près d’une part les saint-simoniens, d’autre part Tocqueville, soit le jour et la nuit ou la nuit et le jour si l’on préfère (je n’entends pas par cette image banale porter un jugement de valeur ! ) Les saint-simoniens, sur les traces de leur maître extraordinaire, prophète de l’industrialisme, furent sans doute les premiers à organiser contre la thèse de « l’incessant jaillissement d’initiatives dispersées », l’idée futurement chère à tant d’esprits de la coopération sociale successivement édifiée à partir « d’un seul centre » producteur et distributeur. Rêve « polytechnicien » selon une expression de Raymond Aron, rêve technocratique, rêve marxiste aussi et apparemment du même fond saint-simonien. Rêve dont il n’y a pas ici à discuter s’il est réalisable ou non et à quelle échelle, s’il a été ou non réalisé et à quel prix. Ce qui nous intéresse est de mettre en regard ce texte étonnant, trop peu connu, de Tocqueville dans La Démocratie en Amérique : « Les hommes mettent la grandeur de l’idée d’unité dans les moyens, Dieu dans la fin : de là vient que cette idée de grandeur nous mène à mille petitesses. Forcer tous les hommes à marcher de la même marche vers le même objet, voilà une idée humaine. Introduire une variété infinie dans les actes, mais les combiner de manière à ce que tous ces actes conduisent par mille voies diverses vers l’accomplissement d’un grand dessein, voilà une idée divine — l’idée humaine de l’unité est presque toujours stérile, celle de Dieu immensément féconde ».
Sur quoi renchérit le distingué commentateur de l’édition M. -Th. Génin de l’ouvrage, André Gain : « C’est bien par la convergence que se réalisent les grandes œuvres, non par l’identité des volontés contraintes ». Voire : l’affirmation mérite une discussion véritablement scientifique, véritablement de science politique. Mais entre ce texte de Tocqueville et la prédication saint-simonienne, voilà le débat remarquablement situé. Que Bertrand de Jouvenel vienne, à plus de cent ans d’intervalle, relayer ici Tocqueville avec la profondeur d’une pensée sûre d’elle-même et l’éclat d’un talent aujourd’hui consacré qui lui permettent de n’être pas écrasé par la comparaison, c’est ce qui saute aux yeux.
Mais la convergence, la combinaison vers un grand dessein à accomplir d’actes infiniment variés ne peuvent résulter d’un miracle. Idée divine, soit, acceptons-en l’hypothèse. Il reste que pour la réaliser Dieu a besoin des hommes. Bertrand de Jouvenel, creusant la notion d’autorité, propose le thème de l’entraîneur, par lui distingué de l’ajusteur : la source chaude, principe de mouvement, distinguée de la source froide, principe d’ordre, la forme essentiellement excitatrice de l’autorité distinguée de sa forme essentiellement calmante. Est libérale une société qui voit d’un œil favorable se déployer les autorités entraîneuses. Mais il reste que c’est l’autorité mainteneuse, et ajusteuse pour maintenir, qui fait le fond de la société. L’autorité entraîneuse n’est à la tête de la société que par intermittences, et sous réserve des ajustements nécessaires pour compenser le trouble croissant apporté par les innovations. A plus forte raison quand la société se fait elle-même entraîneuse, se réserve « le monopole de l’entraînement » afin d’assurer une direction centrale de tous les changements jugés bons : cela introduit une incertitude sociale qui doit être compensée, ajustée d’une façon ou d’une autre, pour que soit réalisé ce que l’auteur appelle le Bien politique. Nous voici loin du rêve grandiose et sommaire, du mythe d’ailleurs puissamment stimulant de l’unité « dans les moyens ». L’auteur prône ardemment, en tant que caractérisant une société progressive, un pullulement de « groupes d’action » très divers en grandeur et en nature ; il admet que « le genre humain progresse par des actions combinées qui exigent l’impulsion d’un entraîneur et la discipline » à laquelle, dux, il préside ; mais il refuse de faire de la société une grande famille, « comme le socialisme sentimental », ou une grande équipe, « comme le socialisme positiviste ». Ces groupes d’action multipliés, il sait bien qu’ils multiplient aussi les frictions et les tensions ; mais que, pour éliminer frictions et tensions, et arbitrages correspondants, la société entière soit « réduite en un seul groupe d’action, à la discipline duquel l’individu est soumis complètement et de façon permanente », c’est ce qu’il rejette absolument. Le rôle de Grand Aligneur que les goûts intellectuels actuellement régnants ou peut-être même une tendance constante de l’esprit humain au nom du « rationnel » assignent volontiers au gouvernement — ce rôle lui paraît le comble de l’irrationnel et du défi à la nature des choses. Rationnelle et naturelle, à ses yeux, est la structure sociale non qui répond au goût de l’esprit mais qui est dans le sens du « travail de la Vie, de l’œuvre de l’homme en tant que cause individuelle », au lieu d’être précisément en conflit avec ce travail et cette œuvre. Foin d’un ordre immédiatement perceptible certes à l’esprit le plus grossier mais dont tout « foyer autonome d’autorité » risquerait de déranger l’ordonnance géométrique, si bien qu’il faudrait empêcher de se former de tels foyers — ce qui est proprement faire « violence aux processus naturels ».
Ce refus et ce réquisitoire, le lecteur averti les reconnaît: il les a lus, à l’état brut, non élaborés, intuitions passionnées, chez Burke, ce relais intellectuel formidable entre Montesquieu et Tocqueville. L’auteur de De la Souveraineté suit en plein XXe siècle, en pleine collectivisation de la politique, la route royale trop désertée de ces trois grands Aînés. En même temps il apporte au néo-libéralisme contemporain une contribution d’une exceptionnelle qualité.
Justice. Liberté, ces mots que l’homme adore…
Bertrand de Jouvenel les soumet — ces mots que l’homme adore — à un traitement sévère, strictement scientifique même quand il fait appel à l’idée divine, et exclusif de toute adoration, de tout romantisme social, de toute « mystification » (comme on dit volontiers de nos jours, et à l’occasion pour mystifier… autrement !)
« II est impossible d’établir un ordre social juste … Rien n’est plus absurde que la défense d’un ordre social existant comme juste… le règne de la justice est impossible, conçu comme la coïncidence établie et continuellement maintenue de l’arrangement social avec une vue de l’esprit » : que de telles propositions soient de nature à scandaliser profondément des lecteurs de 1956, l’auteur s’en rend parfaitement compte ! Elles ne procèdent pourtant ni d’un défi ni d’une bravade. La page qui les rassemble (p. 212) ne fait que tirer paisiblement les conclusions de trente pages serrées et difficiles où la notion même de Justice est, pour citer l’auteur, « péniblement élucidée ». Qu’est-ce que faire justice, sinon appliquer dans une répartition l’ordre sériel pertinent ? Cette notion de pertinence, si rarement dégagée dans les discussions plus passionnées que justes (au double sens du mot) que le mot Justice déchaîne de nos jours, est fondamentale, et B. de Jouvenel l’éclairé par des exemples saisissants. Rien de plus difficile que le choix du critère pertinent, car il est lié à tel ou tel impératif de la fin. Et toute question de fins implique de graves divorces de jugements : fins proches ou fins lointaines, fins d’action ou simplement d’existence, etc. Comment répartir des ressources, qui sont des fruits, sans mettre en mouvement une horde de concepts et d’intérêts ? Il y a une « tension immanente à tout processus de répartition », et cette tension est d’autant plus grave que le processus est plus global : ce pourquoi « il convient que le processus général de répartition soit fragmenté en autant de petits processus autonomes qu’il est possible » (reconnaissons ici sous un nouvel éclairage, celui du Juste, la méfiance de l’auteur vis-à-vis du centre unique et son goût des foyers autonomes !) Apporter une formule de justice distributive globale relève de la présomption, non du bon sens ni de la science (et l’auteur note en passant que cette présomption s’allie trop souvent avec une désarmante indifférence « aux obligations immédiates de la justice commutative »). Etablir un ordre sériel pertinent « à toutes ressources et à tous égards » dépasse les forces de l’esprit humain : un ordre pertinent à l’égard des besoins que les hommes ont à satisfaire ne l’est pas à l’égard des mérites à récompenser ni à l’égard des possibilités à actualiser. Croire que l’autorité juste est celle qui instaure un ordre juste en tous points « est le chemin des plus dangereuses folies ». Se représenter la justice distributive comme le fait d’un suprême dispensateur est d’ailleurs le fait d’une pensée « pauvre et paresseuse ».
B. de Jouvenel nie-t-il donc la Justice, à la suite des vieux Sophistes, de Carnéade, de Hobbes (ramenant tout au Pouvoir), et en un sens de Pascal ? Non point. Ce contre quoi il s’acharne, c’est contre ce qui lui paraît être la conception actuelle de cette Justice, à savoir non plus une vertu des âmes, des hommes qualifiés précisément de « justes » à cause d’une certaine manière d’être, mais un certain arrangement des choses, un certain aménagement collectif, une certaine « configuration de la société, de la géométrie sociale » — coïncidant avec une vue quelconque de l’esprit. Ce qui l’enrage, c’est « l’absurdité d’une société où tout serait juste sans que personne eût à l’être » : et il lui paraît que les illusions nourries de nos jours débouchent logiquement là-dessus. Le règne de la Justice, il le croît possible seulement dans la mesure où « l’esprit de justice préside à toute décision impliquant un partage ». Justice distributive, si chacun opère le partage avec le souci de sa responsabilité et en comparant les co-partageants « sous le rapport pertinent à l’occasion » (cependant que chacun s’applique à rendre l’équivalent de ce qu’il a reçu : justice commutative). Cette justice distributive, bien loin d’être le fait d’un suprême dispensateur est le devoir de chacun, « ne se trouvant aucun être libre qui n’ait à prendre des décisions de partage entre autres ». Si grande que puisse être l’autorité de quelqu’un et si haute sa place dans une société, il n’a jamais à répartir « toutes choses entre tous », mais uniquement certaines choses entre certains à un moment donné : si alors il cherche et applique « l’ordre sériel pertinent à cette occasion », il a agi avec justice, iî a manifesté cette qualité de l’âme — et non des choses — qui est la vertu de justice, il a été « un juste », et c’est tout ce qu’on peut lui demander.
Quant à la Liberté, le seul résumé des soixante pages où l’auteur l’explore patiemment, et passionnément, nous mènerait trop loin. D’autant qu’elles vont loin, ces pages, et provoquent — dans toute la force du verbe — la discussion. Ce mot de Liberté — même s’agissant seulement, comme c’est ici le cas de la liberté de l’homme en société et non du libre-arbitre, bien que le libre-arbitre y soit lié, et qu’un Tocqueville l’y ait lié avec ferveur — ce mot sacré « inscrit sur les étendards de l’Occident », et pas seulement de l’Occident, on a tant joué sur lui, on a tant joué de lui, je serais tenté de dire : on s’est tant joué de lui depuis les Jacobins avec leur « despotisme de la liberté » se réclamant de Rousseau, depuis Hegel avec sa liberté objective ou vraie liberté jusqu’à nos jours ivres de confusion ! Contentons-nous de dire comment B. de Jouvenel prend son sujet, l’un des plus grands et des plus désespérants de la science politique.
Il part de Rousseau, du méconnu Rousseau (méconnu surtout par qui se réclame le plus de lui). « L’homme est né libre et partout il est dans les fers ». Les fers sont une gêne, un obstacle à l’exercice du pouvoir de l’homme : la liberté consiste à les enlever, c’est la liberté comme pouvoir : on sait déjà ce que l’auteur en pense. Les fers sont une honte, une indignité : la liberté consiste à accroître la dignité, c’est la liberté comme dignité. Elle n’exclut pas les obligations, qui dans une certaine mesure sont des fers, mais il y a des obligations dont l’homme est « lui-même l’appréciateur et il en est d’autres qui sont appréciées par un supérieur en puissance » ; et c’est justement dans la dignité d’appréciateur que réside la liberté de l’homme. « On est libre au moment et dans la mesure où l’on juge soi-même ses obligations et où seul on se contraint à les remplir ». Mais alors le conflit entre le jugement propre et le jugement d’autrui, et spécialement le jugement de l’autorité publique, met en péril cette liberté. Or ce conflit est inhérent aux époques (que les saint-simoniens eussent appelées critiques) de dispersion des croyances. Ce pourquoi l’aspiration à la liberté prend alors la forme d’un rêve utopique de retour à l’unité — rêve caressé par d’étroites sectes, d’ailleurs prêtes à tyranniser pour le réaliser contre les résistances.
C’est par ce biais que l’auteur est amené à étudier de façon très serrée et très subtile l’évolution des croyances dans une société. Evolution convergente ou divergente ou alternativement l’une et l’autre ou encore convergente à certains égards et divergente à d’autres. Il dégage un « postulat de convergence » qu’il montre lié à l’idée de lumière naturelle, elle-même liée à la conviction chrétienne de la participation humaine à l’intelligence du Créateur. La lumière naturelle qui éclaire les esprits les défend ou les guérit des opinions erronées, simples « déviations de l’esprit par rapport à la vérité dont il à l’appétit naturel », aberrations sans portée sérieuse. D’où la justification de la décision majoritaire des démocraties par tout autre chose qu’un droit des plus nombreux c’est-à-dire de la force : par son caractère de recherche du vrai et du juste grâce au recours « à la lumière naturelle dans tous les esprits ». Le postulat inverse, celui de divergence, l’auteur le montre fondé sur une philosophie toute différente, matérialiste et relativiste : la raison qui attaque les croyances et normes sociales existantes en tant que coutumières et arbitraires manque de toute règle certaine pour en établir d’autres, « car il n’y en a point de vraies ni justes en soi ». Et de la diversité des situations et des intérêts, plus grande à mesure qu’une société progresse et se complique, naît une diversité toujours plus étendue des jugements. Comment redresser cette divergence sinon par une convergence artificiellement assurée et qui ne peut d’ailleurs porter que sur un utile (toute convergence sur un « juste » étant exclue) ? En éclairant les individus, le plus grand nombre possible d’individus, répondent les libéraux utilitaires du style James Mill. En établissant l’uniformité des situations, répondent les marxistes : tous étant dans la même situation, disons prolétarienne, voudront les mêmes règles.
A quoi l’auteur objecte que le libéralisme utilitaire a été démenti par les faits et le marxisme aussi. Le premier parce qu’on n’a vu dans les démocraties libérales de larges accords que « lorsque des sentiments moraux étaient en jeu », alors que « dans tout ce qui est de l’ordre des intérêts l’accord des esprits n’a jamais pu se faire ». Le second parce que, contrôlant étroitement les situations, il n’en a pas été moins obligé de contrôler étroitement les esprits.
Conclusion qui soulèvera une tempête d’objections, tout comme l’affirmation incidente que le libéralisme moral ne saurait mener à la tolérance : « La confiance montrée dans la sélection naturelle du juste et du vrai (postulat de convergence) tient étroitement à l’idée de lumière naturelle, à l’idée d’une participation humaine à l’essence divine. Laquelle n’étant plus crue, tout l’édifice s’écroule ».
Sur cet avertissement, ou ce constat pessimiste, l’ouvrage s’achève ; on est tenté de dire : tourne court. L’exploration est non pas terminée, mais interrompue. L’explorateur n’est pas à bout de course, mais après ce dur défrichement, ayant tracé quelques avenues lumineuses dans une forêt en partie vierge, il a besoin de reprendre haleine. De faire en quelque sorte le point avec lui-même.
Il nous a obligés à le faire avec nous-mêmes ses lecteurs sur quelques-uns des concepts les plus importants, et parfois les plus faussement clairs, de la science politique. Partis avec lui à la recherche du Bien politique, nous avons participé à ses tâtonnements, à ses lentes et subtiles démarches, nous avons buté avec lui sur mille difficultés méconnues que sa lucidité persuasive nous a forcés de connaître. Nous savons maintenant que le « bien commun se trouve dans la force du nœud social, dans la chaleur de l’amitié entre citoyens, dans la solidité des certitudes qu’ils se donnent, toutes conditions du bien que les hommes peuvent se faire mutuellement par l’existence de la société » ; nous savons que la fonction essentielle des autorités est « l’augmentation de la confiance régnant au sein de l’ensemble ». Mais nous savons également que l’extension des sociétés, l’agrégation de populations disparates, la contagion des cultures, le jaillissement des nouveautés, en somme tout ce qui caractérise précisément le processus de l’histoire, se trouve être en contradiction directe avec les conditions précédemment dégagées. Le Bien commun d’une Grande Société, trop grande pour qu’elle soit vraiment représentée dans les esprits et chérie par les cœurs, et pour qu’elle n’apparaisse pas « comme quelque chose de lourd et de confus, sans forme et sans visage ». Comment éviter que la plus large partie des membres de cette Société ne s’en désintéressent ? Nous savons aussi bien d’autres choses que nos réflexions en ces pages ont dû négliger mais dont le lecteur de l’ouvrage s’enrichira. Celle-ci notamment : que parler des rapports de l’Individu et de la Société est une façon commode de parler, mais qui amène à sous-estimer dangereusement « les assemblages fondamentaux » ; si chaque personne est unique, aucune n’est capable d’existence séparée ; les ensembles ne résultent pas, à titre de phénomènes secondaires, de synthèse d’individus, ce sont des phénomènes primaires de l’existence humaine ; inversement la Société en tant qu’extension et complexité maxima d’assemblage humain n’existe pas nécessairement ; le vrai point de départ d’une étude scientifique est donc dans les formations sociales élémentaires, à savoir l’unité domestique (le « feu » ) , le milieu d’existence, l’équipe d’action. Rétrécir à l’individu, distendre à la Société (qualifiée de « grande famille » ou de « grande équipe » abusivement, comme on a vu) égarent également l’esprit, substituent des vues de l’esprit à l’analyse exacte du réel observable, conduisent à une fausse science politique, au plus grand dam et de la science… et de la politique.
 « Plus vous étendez la sphère du pouvoir, plus il se trouve de gens qui y aspirent. La vie va où est la vie. »
« Plus vous étendez la sphère du pouvoir, plus il se trouve de gens qui y aspirent. La vie va où est la vie. »
Odilon Barrot
On ne s’aperçoit pas qu’aucune révolution n’aboutit pas à l’appesantissement du Pouvoir. Hélas, dit-on, la Révolution est sortie de son lit naturel. Pitoyable incompréhension ! C’est le terme fatal auquel tout le bouleversement s’acheminait de façon nécessaire.
Les Cromwell ou les Staline ne sont pas conséquences fortuites mais bien le terme fatal des révolutions. Les débuts des révolutions offrent un charme inexplicable : l’événement va tout réparer, tout exaucer et tout accomplir. La Révolution française affranchit les paysans mais les force à porter un fusil, elle supprime les lettres de cachet mais élève la guillotine. Par la révolution de 1917, un pouvoir bien plus étendu que celui du tsar permet de regagner et au-delà le terrain que l’Empire avait perdu. On ne peut citer aucune révolution qui ait renversé un despote véritable (Charles 1er et non Henri VIII, Louis XVI et non Louis XIV, Nicolas II et non Pierre le Grand). Ils sont morts non de leur tyrannie mais de leur faiblesse.
La révolution établit une tyrannie d’autant plus complète que la liquidation aristocratique a été plus poussée. Les populations ne voulaient plus d’intendants royaux mais s’administrer elles-mêmes sur le plan local mais la Constituante détruit les unités historiques qui avaient la capacité et la volonté de gouverner. La Révolution a écrasé les droits qu’elle prétendait exalter. Dès janvier 1790, tout acte des tribunaux tendant à contrarier le mouvement de l’administration est déclaré inconstitutionnel. Ce sont des élections renouvelées pour choisir les juges mais le peuple ne choisit jamais assez au gré du Pouvoir et ses choix sont épurés a posteriori. En l’an VIII, le Pouvoir s’attribue la nomination des juges. Lénine déclare l’État foncièrement mauvais et il édifie un formidable appareil de contrainte en Russie.
Les révolutions ne sont pas des réactions de l’esprit de liberté : on n’en peut citer aucune qui ait renversé un despote véritable. Louis XVI n’a même pas su laisser tirer ses Suisses ; Nicolas II n’osa même pas venger son cher Raspoutine ; Charles Ier, vivotait sans menacer personne. Ils sont morts, ces rois, non de leur tyrannie, mais de leur faiblesse. En 1788, la monarchie est tellement en recul qu’elle devait sacrifier au cri général ses intendants de province, exécutants de la volonté centrale, qui cédaient la place aux assemblées provinciales : c’était le mouvement inverse de toute notre histoire. L’œuvre révolutionnaire, c’est la restauration de la monarchie absolue. La constituante sacrifie d’entrée les intérêts de ces mêmes privilégiés qui avaient réclamé la convocation des Etats. Les biens immenses du Clergé sont aussi rapidement livrés au Pouvoir, et les Parlements reçoivent un congé décisif. Le roi ne devient plus qu’un simple fonctionnaire de la volonté générale : alors pourquoi inamovible ? Les circonstances aidant, on le supprime, et le pouvoir exécutif se réunit au législatif dans les mains de la Convention.
La Constituante reconstruit la Justice sur des bases nouvelles, de façon qu’elle soit « toute-puissante pour secourir tous les droits et tous les individus ». Elle sera parfaitement indépendante du Pouvoir. Mais ce dernier très vite prétend que les juges s’inspirent non pas des lois dignes de ce nom que la Constituante a d’abord formulé, mais de mesures de circonstances, dirigées contre telles ou telles catégories de citoyens, et décorées du nom de lois. Il leur reproche trop de mollesse. Il fallait des tribunaux extraordinaires dont le modèle fut le Tribunal révolutionnaire de Paris. Puis en l’an VIII, le pouvoir s’attribue la nomination des juges et leur avancement. Ainsi la Révolution a enlevé à la Justice la fonction qu’elle exerçait auparavant, de défendre l’individu contre les entreprises du Pouvoir. Cette œuvre fut celle non de la Terreur, mais de la Constituante. Et ces principes sont restés en vigueur.
Les initiateurs de la doctrine démocratique ont pris la liberté de l’homme comme base philosophique. Ils se sont proposés de la retrouver comme résultat politique de leur effort. L’homme entrant en association a par là même accepté certaines règles de conduite nécessaires au maintien de l’association. Mais il n’est obligé d’obéir qu’à elles, n’a de maître et de souverain terrestre que la loi. « Un peuple libre, dit Rousseau, obéit aux lois mais il n’obéit qu’aux lois et c’est par la force des lois qu’il n’obéit pas aux hommes ». Ces postulats justifient immédiatement l’abaissement, la subordination du pouvoir. Il n’a d’autre raison d’être et d’autre droit que d’exécuter la loi. La question capitale est de décider d’où viendra la loi. En Angleterre, les assemblées étaient des congrès de privilégiés. En Face du pouvoir demandeur, les représentants disposaient de mandats impératifs. Mais lorsque la préférence donnée à l’assemblée sur le souverain l’a fait investir, elle seule, de la puissance législative, comme seul représentant de la Nation, on n’a point vu qu’on changeait par là son caractère, et que son attitude devait changer. Au lieu d’être juxtaposition d’intérêts divers, elle devenait représentation totale de la totalité nationale. Le parlement ne trouvait plus, lui, de représentants de la Diversité, de mandataires des intérêts particuliers, dont il eût à tenir compte ! Ce n’est pas le roi qui a disparu : le Pouvoir législateur représentant de l’intérêt national est son successeur ; mais ce qui a disparu, c’est la représentation des intérêts qui sont dans la nation. L’aristocratie parlementaire constitue alors « Le Prince », un prince plus puissant que n’était un roi non maître des lois. Ou bien ce prince réussit à s’affranchir de ses mandants ; il est alors absolu. Ou bien, au contraire, les membres de l’assemblée deviennent les instruments de partis, ou les jouets de mouvements extérieurs à l’assemblée. La bataille s’instaure, dont l’enjeu n’est plus seulement le pouvoir, mais les lois elles-mêmes, qui ne seront plus le reflet de vérités supérieures, mais varieront au gré des fluctuations du combat.
Si l’on institue un corps législateur, il se subordonnera et s’intégrera la puissance législative. Rousseau l’a bien vu, car son système tendait à restreindre le nombre de lois, l’étendue des obligations imposées aux sujets, et des pouvoirs conférés aux magistrats. Il ne lui est pas venu à l’esprit que le peuple pût faire des lois mais il a voulu lui donner le moyen d’en repousser qui parussent injustifiées. Et c’est en effet un rôle négatif et éliminateur que joue en pratique le référendum, traduction libre du principe rousseauiste. Rousseau n’a jamais prétendu que le peuple fût qualifié pour choisir la législation « en progrès » d’une société « en progrès » : il ne croyait pas, on le sait, au progrès. Ce qu’il attendait de la législation populaire, dans les petits Etats, qui seuls l’intéressaient, c’était qu’elle entravât la prolifération des lois et l’habilitation indéfinie du pouvoir. Quel sujet d’étonnement et quelle leçon d’histoire sociale que le retournement prodigieux de la doctrine de Rousseau ! Non plus qu’une loi n’est loi, comme l’avait entendu Rousseau, que par le consentement du peuple, mais tout ce que veut le peuple, ou tout ce qu’on représente comme voulu par lui, est loi. On est revenu, en changeant simplement l’attribut, à l’adage qui révoltait les philosophes : « Ce qui plaît au prince, cela aura vigueur de loi ».
Comme le répète Clemenceau : « … si nous attendions de ces majorités d’un jour l’exercice de la puissance qui fut celle de nos anciens rois, nous n’aurions fait que changer de tyrannie. » Ce qu’on a rêvé, c’est que la garantie de la liberté résidait dans la souveraineté de la règle de droit, de la Loi. On a réclamé de plus en plus bruyamment la mise en œuvre de la souveraineté populaire et son absolutisme. On n’a pas compris que c’était renoncer à la difficile souveraineté des lois et quitter les garanties de la liberté ; qu’enfin on reconstituait un Imperium césarien qui devait dès lors trouver ses Césars.
Il n’y a point d’institutions qui permettent de faire concourir chaque personne à l’exercice du Pouvoir, car le Pouvoir est commandement et tous ne peuvent commander. La souveraineté du peuple n’est donc qu’une fiction qui ne peut être à la longue que destructrice des libertés individuelles. Le pouvoir démocratique se présente comme venant libérer l’homme des contraintes que faisaient peser sur lui l’ancien pouvoir. Cette hostilité à la formation de communautés plus petites ne se concilie pas avec la prétention d’instaurer le gouvernement du peuple par lui-même, puisque manifestement ce gouvernement est d’autant plus une réalité qu’il s’exerce dans des communautés plus petites. Tandis qu’il proclame la souveraineté du peuple, le Pouvoir démocratique la resserre exclusivement au choix de délégués qui en auront l’exercice plénier. Ainsi le prétendu « pouvoir du peuple » n’est relié au peuple que par le cordon ombilical très lâche des élections générales ; il n’est effectivement qu’un « pouvoir sur le peuple ». On a vu les corps représentatifs se développer en dépit de toutes les interdictions et de toutes les poursuites. Cette formation spontanée est un phénomène naturel qui corrige la fausse conception totalitaire de l’intérêt général. Or, faute d’avoir ménagé aux intérêts particuliers des moyens de défense, on les condamne à une activité offensive, qui les mène à l’oppression d’autres intérêts. Et ceux-ci se trouvent excités à stopper, pousser ou conquérir le Pouvoir par des procédés semblables. L’autorité n’est plus alors qu’un enjeu, elle perd toute stabilité, toute considération.
Tant que le peuple assemblé par circonscriptions regarde au mérite personnel et non à l’opinion affichée, l’assemblée est constituée par une élite de personnalités indépendantes. On a donc une assemblée vivante où les opinions toujours libres s’affrontent pour le bien de la patrie et l’instruction du public. Mais dès que l’assemblée représentative dispose du Pouvoir, comme il arrive en démocratie, l’appétit de commandement porte les membres à s’ordonner en fractions permanentes. Le groupe fait triompher des candidats qu’il a choisis moins en raison de leur valeur propre que de l’obéissance qu’ils promettent. Il faut alors arracher par n’importe quel moyen la voix dont l’électeur dispose. Se formeront alors des syndicats d’intérêts et d’ambitions, qui s’ingénieront à capter les suffrages pour investir des députés dociles.
Les initiateurs de la démocratie entendaient que la campagne électorale fût une saison d’éducation populaire par l’exposition complète des thèses opposées. Mais les modernes, en gens avisés, ont compris que former l’esprit des électeurs c’est aussi bien l’ouvrir aux arguments adverses qu’aux leurs propres et donc peine inutile. C’est sur les émotions qu’il faut agir. Loin d’éveiller la capacité citoyenne chez ceux qui ne la possèdent pas encore, on l’éteint chez ceux qui l’ont acquise. On fait vibrer la corde du loyalisme, tant on a transformé les électeurs en soldats, en « militants ». C’est que leurs meneurs sont les conquérants du Pouvoir.
Plus la « machine » est puissante, plus les votes sont disciplinés, et moins la discussion a d’importance : elle n’affecte plus le scrutin. La puissance effective quitte d’ailleurs l’assemblée à mesure que les partis gagnent en consistance et en discipline. Les consultations électorales prenant le caractère de luttes entre « machines », celle qui l’emporte peut mettre son chef au gouvernement et il n’aura presque point à tenir compte de l’assemblée où les whips lui assureront une majorité stable.
Ces compétitions aboutissent à la dictature d’un parti, c’est-à-dire d’une équipe, et d’un homme, son chef. Voilà le totalitarisme. Ils disposent de ressources immenses accumulées dans l’arsenal du Pouvoir. Il n’existe dans la société aucune contre-force capable d’arrêter le Pouvoir. On a tout d’abord pensé la liberté comme fin. Dans ce but, on a proclamé la souveraineté des lois. Ces lois, on les mettait au-dessus de l’homme. Il n’aurait point à trembler devant un particulier plus puissant, devant un groupe menaçant par son nombre, car entre ce puissant et lui, c’est la Justice impassible qui trancherait, selon les lois établies. Il n’aurait rien non plus à redouter des gouvernants, serviteurs des lois. Il fallait que l’on crût au caractère de nécessité des lois, qu’on les regardât comme inscrites dans la nature des choses, et non pas comme un produit de la volonté humaine. Or précisément, on se mettait à considérer les lois comme des règlements toujours susceptibles de critique et de révision. En fait les règles suprêmes de la vie sociale sont devenues l’objet de querelles politiques. Dès lors les volontés particulières se trouvaient déchaînées, puisque capables de faire ou défaire les lois. La loi est devenue l’expression des passions du moment. Comme on ne peut plus conquérir la puissance législative, à laquelle l’exécutive est réunie, que par le moyen d’une faction bien organisée, les factions vont gagnant en cohésion et en violence. L’incertitude en tout cas devient telle, les conditions nécessaires de la vie sociale sont à ce point ruinées, que les peuple enfin, las de l’impuissance d’un Imperium toujours plus disputé, aspirent à stabiliser ce poids écrasant du Pouvoir qui roule au hasard de main en main, et finissent par trouver un honteux soulagement dans la paix du despotisme.
A la faveur du déchirement de l’Eglise, le monarque temporel a prétendu communiquer directement avec le suzerain céleste, et il a justifié ainsi l’assomption d’une certaine puissance législatrice. Ainsi le pouvoir qui avait été auprès des autres pouvoirs et dans le droit, tendait à faire entrer en lui les pouvoirs sociaux et le Droit même. Toutes autres étaient les républiques de l’Antiquité, Rome particulièrement. Les différentes magistratures étant indépendantes, le Pouvoir, l’Imperium n’était concentré nulle part, sinon, quand les circonstances l’exigeaient, chez le dictateur temporaire. Et chaque autorité avait son pouvoir propre, potestas. De sorte que ces pouvoirs pouvaient entrer en conflit et l’un d’eux arrêter l’autre. Même à l’intérieur d’une même autorité la pluralité de ses détenteurs permettait à l’un d’eux de paralyser son collègue ou ses collègues. Qu’est-ce qu’un contre-pouvoir ? Evidemment une puissance sociale, un intérêt fractionnaire constitué. Leur self-defense, pour égoïste qu’en puisse être le principe, contribue à la création d’un équilibre social. Ces corps, Montesquieu les trouvait partout dans la société de son temps : noblesse, Clergé, assemblées d’Etats de provinces, corporations. Le séisme fut politique bien sûr, mais aussi intellectuel (Rousseau, Mably) : contre la souveraineté du roi fut affirmée et triompha la souveraineté du peuple. Le problème de la limitation du pouvoir, pense-t-on, ne se trouvait posé que par la solution vicieuse autrefois donnée au problème de la formation du pouvoir. Si le gouvernement émane d’une source pure, ce n’est plus sa faiblesse mais sa force qui fait la liberté, ce n’est plus son étendue, mais toute borne qu’on voudrait apporter à son action, qui serait antisociale ! Royer-Collard le dit fort bien : « La Révolution n’a laissé debout que les individus. […] La centralisation a pénétré modestement, comme une conséquence, une nécessité. En effet, là où il n’y a que des individus, toutes les affaires qui ne sont pas les leurs sont des affaires publiques, les affaires de l’Etat ». Sans doute l’intention primitive des Constituants avait été restrictive : ils entendaient qu’aucun acte de gouvernement ne pût être fait qu’en vertu d’une loi, et qu’aucune loi ne pût être faite qu’en vertu d’un consensus populi. Mais leur système devait logiquement aboutir à rendre possible n’importe quel acte de gouvernement pourvu qu’une loi l’autorisât et à rendre possible n’importe quelle loi pourvu que le Parlement la votât. Aucun despote ne peut se permettre d’aller aussi loin que ceux qui se réclament de la souveraineté populaire. Citons Constant : « La tyrannie n’aura besoin que de proclamer la toute-puissance de ce peuple en le menaçant, et de parler en son nom en lui imposant silence » (Cours de politique constitutionnelle, ed. 1872).
En Angleterre, l’omnipotence s’était élevée en détruisant au nom de la masse qu’elle prétendait représenter les groupes animés d’une vie réelle. Mais les deux chambres sont l’organe des puissances sociales de fait. De là leur force, qu’elles n’empruntaient à aucune constitution. De là aussi leur prudence. Elles équilibrent bien moins le Pouvoir qu’elles ne le cernent. Mais à chaque fois qu’elles le veulent, les puissances sociales font agir le pouvoir, comme il se voit déjà en 1749 quand elles forcent Walpole à la guerre. Ainsi la « séparation des pouvoirs » qu’on observe en Angleterre est à la vérité le résultat d’un processus de refoulement de l’Imperium royal par les puissances sociales.
Rien de comparable en France où règne la solitude victorieuse de la Centralité. On découpe dans l’Imperium des tranches qu’on répartit entre le Roi, la chambre basse, une chambre haute. Mais chaque tronçon du serpent tend à régénérer le serpent tout entier. Le Roi se tient pour héritier d’un roi qui fut absolu, et l’assemblée d’une assemblée qui fut absolue. Puis en 1848 triomphait la souveraineté populaire. Et l’on vit alors reparaître l’erreur fondamentale de la première révolution, l’illusion qu’un pouvoir formé à partir du bon principe est indéfiniment bénéfique. Opposer, comme l’a fait la Deuxième république, à un président élu par le peuple, une Assemblée élue par le peuple, ce n’est pas organiser un équilibre d’éléments sociaux, mais seulement instaurer une dispute d’hommes investis par la même source.
Si la souveraineté réside dans un roi ou une aristocratie, appartient à un seul ou à quelques-uns, elle ne peut s’étaler exagérément sans choquer les intérêts du grand nombre, et il suffit de fournir à ces intérêts un organe, pour que les forces immenses qui s’expriment par ce moyen distendent peu à peu cet organe. Tandis qu’au contraire un organe de résistance accordé à une minorité contre le pouvoir de la multitude ne peut que s’atrophier progressivement, comme se resserre une tête de pont tenue par une armée très inférieure en nombre. De sorte que le Pouvoir n’éveillerait de résistances assez fortes pour le limiter que s’il est de caractère minoritaire. Tandis qu’étant de caractère majoritaire il peut aller jusqu’à l’absolutisme, dont le règne seul relève le mensonge de son principe et que, se disant Peuple, il n’est toujours que Pouvoir.
Ce que nous appelons de nos vœux est une suprématie par le droit. Un Droit aîné et mentor de l’Etat. Or le doit a perdu son autonomie. Comme le dit le code Justinien : nous avons chacun des droits, subjectifs, qui se situent et se concilient dans un Droit objectif, élaboration d’une règle morale s’imposant à tous, que le Pouvoir doit respecter et faire respecter. N’importe l’origine du pouvoir : il se légitime lorsqu’il s’exerce conformément au droit.
De nos jours, rien de semblable : le droit n’est, nous dit-on, que l’ensemble des règles édictées par l’autorité politique. L’autorité faiseuse de lois est donc toujours juste, par définition. Citons la Métaphysique des mœurs de Kant : « Il n’y a contre le suprême législateur de l’Etat aucune résistance légitime de la part du peuple; car il n’y a d’état juridique possible que grâce à la soumission à la volonté législative pour tous. […] Pour que le peuple fût autorisé à la résistance, il faudrait préalablement une loi publique qui la permit. » Carré de Malberg ajoute : « L’essence de la règle de règle de droit est d’être sanctionnée par des moyens de coercition immédiate […] Il ne peut se concevoir, en fait de droit, que du droit positif. »
Or l’Histoire ne nous montre-t-elle pas un Droit d’une bien autre dignité, fondé sur la Loi Divine et la Coutume ? Mais encore faut-il distinguer le cas de Hobbes, qui imagine un pouvoir total, et celui de Rousseau et Kant, qui se gardent bien de confier cette puissance législative illimitée à un monarque ou à une assemblée. Elle ne saurait appartenir pour eux qu’à tout le peuple. Mais ces grands penseurs, dans l’esprit de leurs temps, ne voyaient d’autre réalité que l’homme. Ils proclamaient sa dignité et les droits qu’il possède en tant qu’homme. Ils n’ont pas assez vu que ces droits pouvaient être en conflit avec la puissance législative illimitée. Cela revient à dire que les Déclarations des droits ont joué en fait le rôle d’un Droit placé au-dessus de la loi.
Ce n’est pas un hasard si l’on a vu s’avancer le Pouvoir à l’époque où la foi catholique a été ébranlée. C’est ainsi qu’on le voit de nouveau s’avancer du fait de l’ébranlement des principes individualistes de 89. Mais c’est Léon Duguit, autre grand constitutionnaliste, qui énonce la vraie doctrine du Droit : « L’activité de l’Etat dans toutes ses manifestations est limités par un droit supérieur à lui […] cette limitation ne s’impose pas seulement à tel ou tel organe, elle s’impose à l’Etat lui-même. »
Le juriste américain Marshall, en 1803, a su faire accepter aux Etats-Unis un système formulant expressément les règles suprêmes du Droit, et instituant une autorité confrontant les lois au Droit et rejetant celles qui l’offensent. Ces droits de la justice ne s’étendent pas seulement aux gestes d’un homme privé à l’égard d’un homme privé, mais aussi aux gestes d’un agent du Pouvoir à l’égard de quiconque. Ces garanties, comme en Angleterre, sont moins efficaces par les sanctions qu’elles comportent que par l’état d’esprit qu’elles entretiennent.
Mais progressivement la « législation judiciaire » anglaise n’a plus été épargnée par le flot des lois nouvelles ; la Cour suprême américaine s’est trouvée en butte au sentiment du public et a dû se mettre en veilleuse : c’est un reflet parmi d’autres du sentiment moderne que peut nulle part souffrir que l’opinion de quelques hommes arrête à elle seule ce que réclame l’opinion de toute la société. Mais il ne s’agit ni d’un côté ni de l’autre d’opinions. On a d’une part une émotion momentanée que des méthodes d’agitation permettent de créer facilement ; de l’autre des vérités juridiques dont le respect s’impose absolument. A rebours, ce dont la Cour suprême a souffert, c’est d’avoir défendu contre l’opportunité politique des principes qui avaient été eux aussi d’opportunité politique.
Les racines aristocratiques de la liberté
La liberté est la souveraineté concrète de l’homme sur soi-même. La liberté n’est pas une invention moderne. Nous concevons à peine qu’une société puisse vivre où chacun est juge et maître de ses actions. Le Romain est libre de tout faire mais il doit en supporter toutes les conséquences. Tout peut se faire mais il faut y mettre les formes, formes d’une extrême rigueur. Le plein droit civil n’a d’abord été le lot que des eupatrides ou patriciens. Puis les familles énergiques de la plèbe accèdent aux magistratures et forment avec le patriciat la nobilitas. La plèbe juridique disparaît mais il y a une plèbe de fait. Les hommes de la masse en viennent à priser moins leur liberté juridique que leur participation à la puissance publique. Le Sénat souffre que les tribuns réunissent la plèbe pour voter des résolutions, plebiscita. Le tribunat accoutume le peuple à l’idée du sauveur. T. Gracchus voulait que tout citoyen redevienne propriétaire. C. Gracchus que chaque citoyen ait sa ration de blé à bas prix (bientôt gratuite). Au lieu que se généralise l’indépendance concrète des membres de la société, ils deviennent les clients de la puissance publique.
Il y a un Pouvoir, un État dès que le divorce des intérêts individuels est assez profond pour qu’il faille un tuteur permanent compensant la faiblesse du grand nombre. En Angleterre, le système de la liberté est progressivement étendu à tous : la plèbe est appelée aux droits de l’aristocratie ou extension à tous d’une Liberté individuelle. En France, le système de l’autorité, la machine construite par la monarchie tombe aux mains du peuple pris en masse ou attribution à tous d’une Souveraineté armée.
Dès que le peuple politique comprend une majorité de personnes qui n’ont rien ou croient ne rien avoir à défendre, le peuple se livre au messianisme du Pouvoir. Trois choses importent au césarisme : perte du crédit moral des membres les plus anciennement libres, élévation d’une classe nouvelle de capitalistes séparée par sa richesse du reste des citoyens, réunion de la force politique avec la faiblesse sociale.
L’objet de la démocratie est de transformer le maître suprême de la Société, l’État, en son serviteur. La liberté n’est qu’un besoin secondaire par rapport au besoin primaire de sécurité. A tout instant, il existe dans n’importe quelle société des individus qui ne se sentent pas assez protégés (sécuritaires), et d’autres qui ne sentent pas assez libres (libertaires). Le roi s’appuyant sur les classes inférieures, il y a versement progressif dans les hautes couches sociales d’éléments puisés en bas, montés par le canal étatique. La dégénérescence intérieure transforme l’aristocratie. Les privilégiés cherchent à être protégés par l’État. N’ayant plus de force propre, ils sont devenus incapables de limiter le pouvoir : les aspirations libertaires résident alors dans la classe moyenne, alliée du pouvoir s’il faut discipliner une aristocratie désordonnée, alliée de l’aristocratie lorsque l’État veut étouffer la liberté. Tous les individus, toutes les classes tâchent d’appuyer leur existence individuelle à l’État et les nouveaux droits de l’Homme contredisent et abrogent ceux qu’avait proclamés le XVIIIe s. : la plénitude de la liberté implique la plénitude du risque. Dès qu’on attend de l’État une protection, une sécurité, il lui suffit de justifier ses envahissements par les nécessités de son protectorat. L’aspiration religieuse est naturelle à l’homme, on a vainement chassé la foi de la scène politique : le Pouvoir revêt un caractère de théocratie.
Une puissance bienfaisante veillera sur chaque homme, depuis le berceau jusqu’à la tombe, dirigeant son développement individuel et l’orientant vers l’emploi le plus approprié de son activité. Le jeu des lois positives laisse beaucoup de place à quantité de misères et de malheurs individuels. Les victimes réclament une intervention providentielle qui corrige ces conséquences. Le trouble social n’est pas imaginaire mais le Pouvoir procède par décisions arbitraires. L’homme concret agit sous l’empire de sentiments et de croyances. Nous sommes dirigés par des images de comportement : nous n’avons qu’à imiter, qu’à répéter. L’harmonie est menacée quand les images de comportement sont troublées. Le faux dogme de l’égalité, flatteur aux faibles, aboutit en réalité à la licence infinie des puissants. Aucun ordre social ne saurait se maintenir ou se rétablir si les dirigeants des groupes des groupes et les aînés des collèges ne remplissent pas leur mission. Le trouble des images de comportement se répand de haut en bas. La cohérence sociale ne peut alors être rétablie que par le Pouvoir, usant des méthodes grossières de la suggestion collective et de la propagande. C’est la solution totalitaire, mal appelé par le mal individualiste. Une métaphysique destructrice n’a voulu voir dans la Société que l’État et l’Individu. Elle a méconnu le rôle des autorités morales et de tous ces pouvoirs sociaux intermédiaires qui encadrent et protègent l’homme de l’intervention du Pouvoir.
 «Une monarchie subit les services des puissants en tant qu’elle demeure sous la tutelle aristocratique; mais elle appelle les services des plébéiens en tant qu’elle veut se rendre absolue.»
«Une monarchie subit les services des puissants en tant qu’elle demeure sous la tutelle aristocratique; mais elle appelle les services des plébéiens en tant qu’elle veut se rendre absolue.»
La nécessité du nivellement
D’où vient que l’Etat ne rencontre aucune limite, aucune résistance syndicale du peuple ? C’est que les représentants des différents éléments de la Nation sont devenus le Pouvoir, et le peuple reste alors sans défenseur. Ceux qui sont l’Etat n’admettent pas d’intérêt de la Nation distinct de l’intérêt de l’Etat. Ils écraseraient comme sédition ce que la monarchie accueillait comme remontrance.
Le pouvoir dans sa puissance a pour victimes prédestinées et pour opposants naturels les puissants, les chefs de file, ceux qui exercent une autorité et possèdent une puissance dans la société. Être niveleur n’est donc nullement un caractère qu’il assume quand il devient démocratique. Le nivellement est dans sa destinée.
Ce qui aide au pouvoir de l’État c’est qu’il lutte contre d’autres maîtres ; et l’on regarde leur abaissement plutôt que son élévation. Ce qui lui est obstacle c’est tout commandement autre que le sien. Ce qui lui est aliment c’est toute force où qu’elle se trouve. Il est niveleur en tant qu’il est État, parce qu’il est État. Magistrature, police et armée font respecter les droits acquis : si on l’examine dans son Être, il est défenseur des privilégiés, mais si on l’examine dans son Devenir, on le trouve agresseur de toutes les formes d’autorité sociale. Il détruit naturellement l’ordre social dont il émane. Les grands sont abaissés tandis que s’élève une statocratie. Les privilégiés ne sont plus en face de l’État, ils sont dans l’État et constitués par lui et l’État est menacé de démembrement : cette construction et destruction de l’État rythme la vie sociale.
Ce sont les possédants qui bénéficient des lois, des décisions de la magistrature, des interventions de la police. Mais l’Etat n’est pas dans sa nature conservateur des droits acquis. Il joue les deux rôles à la fois, garantissant par ses organes les situations établies, et les minant par sa législation. Le processus destructeur des aristocraties s’accompagne d’un processus inverse. Car parallèlement s’élève une statocratie, qui non seulement s’approprie collectivement les forces sociales, mais qui tend aussi à se les approprier individuellement, donc à les distraire du pouvoir.
Dans les temps anciens, le système qui prévalait était celui de la société gentilice : le pouvoir n’était qu’un pacificateur entre groupes disposant d’une totale liberté interne. Le pouvoir ne connaît que les chefs de groupes, entre lesquels il arbitre, auxquels il commande. Son autorité ne pénètre pas dans le groupe même. Le roi est par conséquent contraint à une consultation permanente avec les pairs qui peuvent seuls lui prêter les forces dont il a besoin. Par conséquent, briser le cadre gentilice est la grande affaire des rois. La lutte contre la cellule familiale, depuis le classement des citoyens de Solon et Servius Tullius, s’est poursuivi tout au long de l’histoire. L’Etat a revendiqué comme ses propres ressortissants ceux qui n’étaient auparavant que les sujets du père. L’apparition de la structure féodale, système d’ « hommes de confiance », fait de chaque dominateur local un législateur, un juge, un administrateur d’une sorte de principauté. Mais le pouvoir anéanti se réveille, aiguillonné par ses besoins : il n’est pour ce dernier d’autres ressources que de dérober à la cellule seigneuriale les ressources qu’elle recèle. Les légistes placés entre le seigneur et ses sujets sont donc là pour que le seigneur s’abstienne de « tailler » arbitrairement ses hommes. Par ailleurs le monarque demande de plus en plus fréquemment des « aides », à l’occasion des guerres bien sûr, mais également par le biais de la dépréciation monétaire : le métal précieux, acheté de plus en plus cher par les ateliers monétaires, circule de plus en plus vite. Son rythme suit celui des besoins de l’Etat. L’Etat voit avec faveur la montée des riches qui ne lui paraissent point soustraire quelque chose à son autorité. Mais enfin la démolition de toutes autres dominations sociales a laissé les dominations financières maîtresses du terrain. Alors on les a reconnues formatrices de cellules nouvelles. Le patronat industriel pénètre dans l’atelier, a introduit sa loi, sa police, son règlement d’atelier. Ainsi les anticapitalistes, à rebours, viennent remplir les cadres de l’Etat bourgeois. Socialiste ou non, le pouvoir devient nécessairement l’allié de ceux qui subissent la domination capitaliste.
La statocratie, mariage du Pouvoir et de la plèbe
Si le Pouvoir grandit aux dépens des puissants, la plèbe doit être son éternelle alliée. La passion de l’absolutisme doit nécessairement conspirer avec la passion de l’égalité. Ce qu’a fait César en quelques années, la monarchie capétienne a mis 400 ans à l’accomplir mais c’est la même tâche et la même tactique. Des conseillers plébéiens, des soldats plébéiens, des fonctionnaires plébéiens sont les instruments du pouvoir qui se veut absolu. Quel spectacle cette montée des hommes noirs qui dévorent peu à peu la grandeur féodale. Le Pouvoir monarchique n’a pourtant point atteint sa fin logique, répugnant à détruire la noblesse toujours résistante. Lorsque se lèvera la vague démocratique, elle trouvera en Angleterre un Pouvoir tout investi de tranchées aristocratiques, au lieu qu’en France, elle s’emparera tout d’un coup d’un Pouvoir monarchique sans frein : ce qui explique assez la différence des deux démocraties.
Le terme d’une telle évolution, c’est la destruction de tout commandement au profit du seul commandement étatique. C’est l’atomisation sociale, la rupture de tous liens particuliers entre les hommes, qui ne sont plus tenus ensemble que par leur commun servage envers l’Etat. C’est, à la fois, et par une convergence fatale, l’extrémité de l’individualisme et l’extrémité du socialisme. Est-ce à dire pourtant qu’il n’y ait plus de privilégiés ? Si : mais ils sont dans l’Etat et constitués par lui. Ceux qui occupent les positions clefs de cette grande machine, les potentes, les optimates, s’approprieront alors de nouveaux avantages, et voudront en assurer la transmission à leurs descendants. Ce sera la féodalité. L’Etat sera démembré par la statocratie conçue dans son propre sein. Il s’agit pour lui dès lors de détruire ces molécules sociales ; et le processus de gonflement de l’Etat recommence.
Toujours, l’aristocratie s’oppose à l’élection d’un pouvoir disposant par lui-même de moyens d’action qui le rendent autonome à l’égard de la Société. A l’armée, assemblée de contingents féodaux, le roi leur préfère bientôt une cavalerie mercenaire développée à mesure de ses ressources. Et ce malgré des résultats mitigés.
L’Etat c’est nous ? Non, l’Etat, c’est eux !
« Le terme d’État – et c’est pourquoi nous l’évitons – comporte deux sens fort différents. Il désigne d’abord une société organisée ayant un gouvernement autonome, et, en ce sens, nous sommes tous membres de l’État, l’État c’est nous. Mais il dénote d’autre part l’appareil qui gouverne cette société. En ce sens les membres de l’État, ce sont ceux qui participent au Pouvoir, l’État c’est eux. Si maintenant l’on pose que l’État, entendant l’appareil de commandement, commande à la Société, on ne fait qu’émettre un axiome ; mais si aussitôt l’on glisse subrepticement sous le mot État son autre sens, on trouve que c’est la société qui commande à elle-même, ce qu’il fallait démontrer. Ce n’est là évidemment qu’une fraude intellectuelle inconsciente. Elle n’apparaît pas flagrante parce que précisément dans notre société l’appareil gouvernemental est ou doit être en principe l’expression de la société, un simple système de transmission au moyen de quoi elle se régit elle-même. À supposer qu’il en soit vraiment ainsi – ce qui reste à voir – il est patent qu’il n’en a pas été ainsi toujours et partout, que l’autorité a été exercée par des Pouvoirs nettement distincts de la Société, et que l’obéissance a été obtenue par eux. »
Bertrand de Jouvenel — Du pouvoir (1945)
Il faut écouter les cris de dépit de Saint-Simon contre Mazarin. Il a bien compris qu’au temps de la Fronde une révolution s’était accomplie, non pas celle, tumultueuse, que tentaient les émeutiers, mais celle au contraire invisible, qu’accomplissait le ministre éducateur de Louis XIV : « Il en méprise les lois, le génie, les avantages, il en ignore les règles et les formes, il ne pense qu’à tout subjuguer, à tout confondre, à faire que tout soit peuple ». Une partie de la noblesse alors, durant tout le XVIIIe siècle, plus ou moins déplumée par le pouvoir monarchique, se remplume en s’installant dans le riche appareil d’Etat construit par les commis plébéiens. Et occupant toutes les places, obstruant toutes les avenues du Pouvoir, l’ancienne noblesse l’anémie en empêchant qu’il attire à lui, comme autrefois, les ambitions plébéiennes. Ainsi tout ce qui devait servir l’Etat, s’en trouvant écarté, se « jacobinise ». Sous une opposition parlementaire qui, acceptée, aurait transformé la monarchie absolue en monarchie limitée, s’impatiente une élite plébéienne qui, admise dans l’Etat, aurait poussé toujours plus loin la centralisation monarchique. Elle était si naturellement servante du pouvoir royal qu’elle ne fera que le continuer, sans roi.
Le levier des croyances
Plus les routines et les croyances d’une société sont stables et enracinées, plus les comportements sont prédéterminés, moins le Pouvoir est libre dans son action. Plus nous cherchons à connaître les hommes primitifs, plus nous sommes frappés, non pas de l’extrême liberté de leur conduite, mais au contraire de son caractère étonnamment strict. Cette régularité on l’observe dans les communautés les plus dénuées de gouvernement. Le problème se complique quand la conquête, phénomène assez tardif dans l’histoire humaine, rassemble plusieurs communautés à mœurs distinctes sous un même gouvernement. Le peuple novateur se porte de tous côtés à des actes originaux. Alors intervient une Loi qui lui ouvre les avenues de développement fécondes, tandis que lui sont fermées de toute l’autorité d’un vouloir divin celles qui le mèneraient à sa propre destruction. Ce n’est pas le pouvoir qui légifère mais Dieu par la bouche d’hommes inspirés ou profondément convaincus. Puis les hommes se sont risqués à porter le jugement. Ce qui nous apparaît comme la plus haute expression de l’autorité, dire ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait, distinguer le licite et l’illicite, cela n’a point appartenu au Pouvoir politique avant un stade extrêmement tardif de son développement.
Sans doute les règles du droit romain apparaissent très tôt divorcées de toute connotation religieuse. Mais ces commandements civils, ces institutions civiles sont le décalque exact d’anciens commandements et d’anciennes institutions de caractère sacré.
Il y a deux sortes de lois : la Loi-commandement, reçue d’en haut. Dieu en est l’auteur. Enfreindre cette loi, c’est l’offenser. On en sera puni, que le pouvoir temporel y prête la main ou non. Et les Lois-règlements, faites par les hommes pour discipliner des conduites que les progrès de la complication sociale diversifient sans cesse. Les Romains sont le peuple le moins mystique peut-être que la terre ait porté. Et c’est pourquoi ils ont si tôt séparé du fas, ce qu’exigent les Dieux, le jus, ce qu’aménagent les hommes. Entraînés par la passion ou flattés par la puissance, les hommes commettent de fréquentes et graves violations, nul plus que les princes.
On doit se garder de confondre la Loi divine avec la Coutume. La coutume est une cristallisation de tous les usages. La Loi au contraire, laisse passer les variations favorables : elle agit, si l’on veut, comme un filtre sélectif. Par ailleurs, on ne peut pas dire que le Peuple ou l’assemblée enlève au Pouvoir la capacité de faire seul les lois, car, cette capacité, il ne la possédait point. Le concours du peuple ou d’une assemblée, loin d’entraver une liberté qu’ils n’avaient point, permet au contraire à l’activité gouvernementale de s’étendre. C’est le Pouvoir qui, au Moyen Age, convoque les Parlements d’Angleterre et les Etats généraux de France. On ne fait d’abord que constater la coutume. Puis, très progressivement, on introduit des lois innovatrices mais volontiers présentées comme des retours aux bons usages anciens. C’est la pratique législative qui a peu à peu accrédité la notion qu’on pouvait, par proclamation, non pas constater des droits, un Droit, mais les créer. Les plus grands esprits du XVIIIe l’ont tellement compris qu’ils ont voulu donner au législateur une digue et un incontestable guide : c’est la « religion naturelle » de Rousseau, c’est la « morale naturelle » de Voltaire. Mais ces digues ne pouvaient tenir une fois l’homme déclaré « mesure de toutes choses ». Une fois l’homme déclaré mesure de toutes choses, il n’y a plus ni Vrai, ni Bien, ni Juste, mais seulement des opinions dont le conflit ne peut être tranché que par la force politique. Le siècle du rationalisme est celui des despotes éclairés.
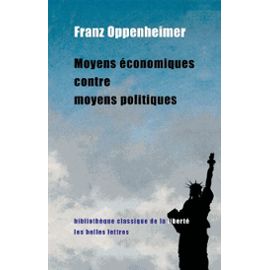
En librairie le 21 novembre 2013 (35,50€, 558 pages). Edités par les Belles Lettres, ces textes, choisis et présentés par Vincent Valentin, constituent une des très rares publications du sociologue allemand Franz Oppenheimer en français. Ceci fait suite à l’édition ebook commise par votre serviteur l’an dernier, et disponible ici en version epub et là en version mobipocket (Kindle).
Vincent Valentin est maître de conférences en droit à l’université de Paris 1 et enseignant à Sciences Po Paris. C’est un spécialiste du néo-libéralisme (le courant qui voulut rénover le libéralisme dans les années 1930), du libéralisme et du libertarianisme contemporain. Il collabore régulièrement à Philosophie Magazine. Il est docteur en droit, avec une thèse consacrée au libéralisme contemporain sous l’angle de la philosophie du droit et de l’histoire des idées. Il a écrit avec Alain Laurent une anthologie des textes libéraux, parue en 2012 aux Belles Lettres (Les Penseurs libéraux)
Sous un titre fédérateur unique, cet ouvrage associe et réédite pour la première fois depuis un siècle les traductions françaises de larges extraits des deux principaux opus d’Oppenheimer qui primitivement étaient prévus comme les deux parties d’un seul livre titré « Le Socialisme libéral comme système de sociologie » : en premier lieu L’Etat (édition originale 1908, traduit en 1913 en français), et en second lieu L’Economie pure et l’économie politique (édition originale 1910 ; traduit en 1914 en français). Le dénominateur commun de ces deux textes est une critique de l’Etat, aussi bien dans sa version capitaliste conservatrice que socialiste : l’Etat est considéré comme héritier des guerres de conquêtes et recourant à la violence des « moyens politiques » génératrices de luttes de classes destructrices. Cette critique est accompagnée par la proposition positive d’une société sans rapports de forces ni classes, sans exploitation et presque sans Etat, fondée, et c’est là sa forte originalité, sur la coopération volontaire d’individus égaux pratiquant le libre échange des « moyens économiques » : c’est le « socialisme libéral », dans le vocabulaire d’Oppenheimer.
Après avoir étudié la médecine puis la physique à Berlin, Franz Oppenheimer (1864-1943) se tourne vers les questions sociologiques, sociopolitiques et économiques. Il inaugure la première chaire de sociologie en Allemagne (1919). Avant d’émigrer définitivement aux Etats-Unis en 1938 pour fuir le nazisme et y finir sa vie, cet influent sociologue allemand a été professeur aux universités de Berlin et de Francfort, où il eut notamment parmi ses étudiants l’économiste ordo-libéral Wilhelm Röpke et le futur chancelier Ludwig Erhard. Ayant déclaré « toutes mes idées ont leur racine dans Adam Smith », il est paradoxalement mais significativement aussi apprécié par les libertariens américains pour son antiétatisme que par certains solidaristes français pour avoir le premier prôné un « socialisme libéral ».
Je vous joins ci-dessous ma préface à l’édition électronique de L’Etat, ses origines, son évolution et son avenir, qui contient mes annotations et traductions de l’ouvrage majeur de ce merveilleux sociologue.
Franz Oppenheimer, né le 30 mars 1864 à Berlin et mort le 30 septembre 1943 à Los Angeles, était un sociologue et économiste politique allemand. Il est pour l’essentiel connu pour le présent ouvrage Der Staat, paru en 1908, dans lequel il développe des théories majeures sur l’origine de l’État, et qui bénéficieront d’une longue postérité.
Oppenheimer étudie la médecine à Fribourg-en-Brisgau et à Berlin. Il pratique ensuite à Berlin entre 1886 et 1895. Il s’intéresse progressivement à l’économie politique et à la sociologie. Il devient à partir de 1895 rédacteur en chef de Die Welt am Morgen.
En 1909, il obtient un doctorat en économie à l’université de Kiel, avec une thèse sur David Ricardo, dont les idées exercèrent une grande influence sur lui. Entre 1909 et 1917, il est Privatdozent (professeur non rémunéré) à l’université de Berlin, puis occupe une chaire entre 1917 et 1919. Cette année, il part à l’université Goethe de Francfort sur le Main, occuper la première chaire de sociologie ouverte dans le pays. Il y dirigera en particulier la thèse de Ludwig Erhard, soutenue en 1925. Il eut aussi le célèbre ordo-libéral Wilhelm Röpke comme élève.
Juif, il part en 1934-1935 enseigner en Palestine. L’année suivante, il est fait membre honoraire de la société américaine de sociologie. En 1938, il émigre définitivement, au Japon puis aux Etats-Unis, s’y installant sur la côte Ouest. Il participe entre autres au lancement de l’American Journal of Economics and Sociology. Il enseigna également à l’université de Kobe.
« Moyen économique » et « moyen politique »
Pour Oppenheimer, il y a deux manières, exclusives l’une de l’autre, d’acquérir de la richesse ; la première est la production et l’échange volontaire avec les autres – la méthode du marché libre« la voie économique »èé èéthode de confiscation unilatérale, du vol de la propriétéé« la voie politique » écrit Murray Rothbard dans , il devrait êénergie dans la production est la voie « naturelle » : ce sont les conditions de sa survie et de sa prospérité sur cette terre. Il devrait être également clair que le moyen coercitif et exploiteur est le contraire de la loi naturelle à la production, il en soustrait. « La voie politique » ; et ceci réduit non seulement le nombre des producteurs, mais abaisse éà produire au-delà de sa propre subsistance. En fin de compte, le voleur détruit même sa propre subsistance en réduisant ou en éliminant la source de son propre approvisionnement.
Etat-ours et Etat-apiculteur
Oppenheimer retrace l’histoire universelle de la constitution de l’Etat, indépendamment des races, des époques, des ethnies, des religions, des croyances, des latitudes. Il observe un cheminement qui, plus ou moins lent, plus ou moins systématique, est le lot de toutes les civilisations et de toutes les époques. La première étape de l’Etat, c’est le vol, le rapt, le meurtre lors de combats frontaliers, échauffourées sans fin, que ni paix ni armistice ne peuvent faire cesser.
Peu à peu, le paysan, victime principale de ces hordes barbares, accepte son sort et cesse toute résistance. C’est alors que le berger sauvage, nomade et hostile, prend conscience qu’un paysan assassiné ne peut plus labourer, et qu’un arbre fruitier abattu ne peut plus rien porter. Dans son propre intérêt, donc, partout où c’est possible, il permet au paysan de vivre et épargne ses vergers. La tribu de nomades perd peu à peu toute intention de pratiquer le vol et l’appropriation violente.
Les pilleurs ne brûlent et ne tuent plus dans la stricte mesure du « nécessaire », pour faire valoir un respect qu’ils estiment salutaire, ou pour briser une résistance isolée. Mais en général, le berger ne s’approprie désormais que l’excédent du paysan. Il laisse au paysan sa maison, son équipement et ses provisions jusqu’à la prochaine récolte.
Dans une métaphore saisissante, Oppenheimer démontre que le berger nomade, qui était jadis comme l’ours, qui, pour voler la ruche, la détruit, devient progressivement, dans un second temps, comme l’apiculteur, qui laisse aux abeilles suffisamment de miel pour les mener jusqu’à l’hiver. Alors que le butin accaparé par la tribu de bergers nomades n’était qu’une pure et simple spoliation, où peu importait les conséquences, où les nomades détruisaient la source de la richesse future pour la jouissance de l’instant, désormais, a contrario, l’acquisition devient rentable, parce que toute l’économie est basée sur la retenue face à la jouissance de l’instant en raison des besoins de l’avenir. Le berger a appris à « capitaliser ». La société est passée de l’ « Etat-Ours » à l’ « Etat-apiculteur ».
La conception libérale de la lutte des classes
Par ailleurs, Oppenheimer montre que l’histoire de toutes les civilisations est celle du combat entre les classes spoliatrices et les classes productives. Il inscrit son analyse de la formation de l’Etat dans le cadre de cette théorie libérale de la lutte des classes.
Cette théorie fut d’abord l’œuvre de Charles Comte au XIXe siècle, l’auteur du journal Le Censeur Européen et l’un des maîtres de Bastiat. Selon Comte, l’homme a le choix entre deux alternatives fondamentales : il peut piller la richesse produite par d’autres ou il peut travailler pour produire lui-même des richesses. On retrouve cette idée chez Bastiat aussi : « Il y a donc dans le monde deux espèces d’hommes, savoir : les fonctionnaires de toute sorte qui forment l’État, et les travailleurs de tout genre qui composent la société. Cela posé, sont-ce les fonctionnaires qui font vivre les travailleurs, ou les travailleurs qui font vivre les fonctionnaires ? En d’autres termes, l’État fait-il vivre la société, ou la société fait-elle vivre l’État ? ». Comme l’a fait justement remarquer Ralph Raico, la similarité entre cette analyse et celle d’Oppenheimer dans L’Etat est frappante. Sa genèse de l’Etat s’oppose frontalement à celle du gentil-Etat-protecteur, dans la tradition du contractualisme des Lumières, et inspirera Max Weber (« L’Etat, c’est le monopole de la violence physique légitime »).
De plus, L’Etat d’Oppenheimer est un excellent complément au livre de Bertrand de Jouvenel, Du pouvoir, Histoire naturelle de sa croissance (1945). Là où écrit, en effet : « Qu’est-ce, alors, que l’Etat comme concept sociologique ? L’Etat, dans sa genèse (…) est une institution sociale, imposée par un groupe victorieux d’hommes sur un groupe défait, avec le but unique de régler la domination du groupe victorieux sur le groupe défait, et de se protéger contre la révolte intérieure et les attaques de l’étranger. Téléologiquement, cette domination n’a eu aucun autre but que l’exploitation économique du vaincu par les vainqueurs. », Bertrand de Jouvenel ajoute : « l’Etat est essentiellement le résultat des succès réalisés par une bande des brigands, qui se superpose à de petites et distinctes sociétés. ».
La postérité de L’Etat
Parmi les auteurs grandement inspirés par Franz Oppenheimer, on trouve indubitablement Murray Rothbard. Dans L’Ethique de la liberté, il considère qu’Oppenheimer définit « brillamment l’Etat comme « l’organisation des moyens politiques ». C’est que l’Etat est d’une essence criminelle. »
Plus encore, sa définition de l’Etat n’est qu’un prolongement des écrits d’Oppenheimer. « L’État, selon les mots d’Oppenheimer, est l’ « organisation de la voie politique » ; c’est la systématisation du processus prédateur sur un territoire donné. Le crime, au mieux, est sporadique et incertain ; le parasitisme est éphémère, et la ligne de conduite coercitive et parasitaire peut être contestée à tout moment par la résistance des victimes. L’État fournit un canal légal, ordonné et systématique, pour la prédation de la propriété privée ; il rend certain, sécurisé et relativement « paisible » la vie de la caste parasitaire de la société ».
De plus, Oppenheimer pointe du doigt une idée reprise et confirmée par nombre d’auteurs : comme la production doit toujours précéder la prédation, le marché libre est antérieur à l’état. L’État n’a été jamais créé par un « contrat social » ; il est toujours né par la conquête et par l’exploitation. Une tribu de conquérants, qui pille et assassine les tribus conquises, et décide de faire une pause, car elle se rend compte que le temps de pillage sera plus long et plus sûr, et la situation plus plaisante, si les tribus conquises étaient autorisées à vivre et à produire, les conquérants se contentant d’exiger comme règle en retour un tribut régulier.
Carl Schmitt ajoute : « Alors que la conception de l’Etat propre au XIXe siècle allemand, systématisé par Hegel, avait abouti à la construction intellectuelle d’un Etat situé loin au-dessus du règne animal de la société égoïste, et où régnaient la moralité et la raison objectives, [chez Oppenheimer] la hiérarchie des valeurs se trouvent à présent inversée, et la société, sphère de la justice pacifique, se place infiniment plus haut que l’Etat, dégradé en zone d’immoralité et de violence ».
D’autre part, la distinction sociologique entre ceux qui vivent du pillage (spoliation) et ceux qui vivent de la production marquera aussi profondément les premiers intellectuels américains de la Old Right au XXe siècle : Albert Jay Nock et Frank Chodorov.
Enfin, il est indéniable qu’Oppenheimer exerça une influence majeure sur nombre de libéraux allemands et américains, comme Ludwig Erhard, père du miracle économique allemand, Benjamin Tucker, Kevin Carson ou Albert Jay Nock. Si ces personnalités ont des idées si éloignées, c’est non seulement à cause des thèses éclairantes de l’auteur, mais aussi parce que l’on peut tirer deux conclusions de celles-ci : soit que l’Etat est une organisation aux fondements injustes et dont on doit se débarrasser ou limiter (perspective minarchiste ou libertarienne), soit que l’on doit lutter contre ces injustices, y compris par l’utilisation de l’État et la modification des attributs de ce dernier. C’est la voie choisie par Oppenheimer, pour qui les libéraux doivent accepter une phase de transition durant laquelle le pouvoir politique rétablirait une situation juste. En particulier, pour Oppenheimer, c’est la répartition de la propriété foncière qui est injuste, répartition dont est responsable le pouvoir politique. Il convient d’y remédier en luttant contre les excès du pouvoir politique, qui maintient une société de classes. Pour cela, l’Etat doit être transformé, de moyen de conservation des privilèges et des monopoles à l’adversaire de ces derniers. Ainsi serait possible la transition entre un régime capitaliste non libéral et une vraie économie de marché, dans laquelle l’intérêt général serait atteint par la liberté économique.
Mais surtout, de cette lutte ancestrale entre le moyen politique et le moyen économique, le vainqueur apparaît clairement aux yeux d’Oppenheimer. Et c’est bien cela le plus important de sa pensée. En effet, si la tendance de l’évolution de l’Etat se révèle comme la lutte constante et victorieuse du moyen économique contre le moyen politique, le droit du moyen économique, le droit d’égalité et de paix, héritage des conditions sociales préhistoriques, était à l’origine borné au cercle étroit de la horde familiale. Autour de cet îlot de paix l’océan du moyen politique et de son droit faisait rage.
Or, peu à peu, ce cercle s’est de plus en plus étendu : le droit de paix a chassé l’adversaire, il a progressé partout à la mesure du progrès économique, de l’échange équivalent entre les groupes. D’abord peut-être par l’échange du feu, puis par l’échange de femmes et enfin par l’échange de marchandises, le territoire du droit de paix s’étend de plus en plus. C’est ce droit qui protège les marchés, puis les routes y conduisant, enfin les marchands qui circulent sur ces routes. L’Etat, ensuite, a absorbé ces organisations pacifiques qu’il développe. Elles refoulent de plus en plus dans son territoire même le droit de la violence. Le droit du marchand devient le droit urbain. La ville industrielle, le moyen économique organisé, sape par son économie industrielle et monétaire les forces de l’Etat Féodal, du moyen politique organisé : et la population urbaine anéantit finalement en guerre ouverte les débris politiques de l’Etat Féodal, reconquérant pour la population entière avec la liberté le droit d’égalité. Le droit urbain devient droit public et enfin droit international.
De là découle la conclusion optimiste du présent ouvrage : « Nous sommes enfin mûrs pour une culture aussi supérieure à celle de l’époque de Périclès que la population, la puissance et la richesse de nos empires sont supérieures à celles du minuscule Etat de l’Attique.
Athènes a péri, elle devait périr, entraînée à l’abîme par l’économie esclavagiste, par le moyen politique. Tout chemin partant de là ne peut aboutir qu’à la mort des peuples. Notre chemin conduit à la vie ! »
Et nous pouvons dès lors faire nôtres les dernières phrases de L’Etat :
« L’examen historico-philosophique étudiant la tendance de l’évolution politique et l’examen économique étudiant la tendance de l’évolution économique aboutissent au même résultat : le moyen économique triomphe sur toute la ligne, le moyen politique disparaît de la vie sociale en même temps que sa plus ancienne, sa plus tenace création. Avec la grande propriété foncière, avec la rente foncière, périt le capitalisme.
C’est là la voie douloureuse et la rédemption de l’humanité, sa Passion et sa Résurrection à la vie éternelle : de la guerre à la paix, de la dissémination hostile des hordes à l’unification pacifique du genre humain, de la bestialité à l’humanité, de l’Etat de brigands à la Fédération libre. »
« La soif de dominer est celle qui s’éteint la dernière dans le cœur de l’homme », Machiavel, Le Prince, 1532.
Considérer que Nicolas Machiavel (1469-1527) aurait d’une quelconque manière des atomes crochus avec le libéralisme peut paraître de prime abord incongru. On fait volontiers de lui le grand penseur de l’arbitraire du pouvoir, de la brutalité politique, fondée sur un cynisme de tous les instants. On pourrait se délecter à l’infini des aphorismes, nombreux et percutants, de ce Florentin ascète et pisse-froid, intrigant comme Mazarin ou Richelieu, ses illustres descendants. Il laisse dans l’esprit commun autant de sympathie que son quasi contemporain, le funeste et méchant roi de France Louis XI, fort justement nommé « universelle araigne ». Machiavel n’a-t-il pas écrit, dans Le Prince, son opuscule majeur, paru en 1532 et dédié à Laurent de Médicis, les sentences suivantes : « En politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal »; « Jamais les hommes ne font le bien que par nécessité » ; « Une guerre est juste quand elle est nécessaire », et tant d’autres formules du même acabit ?
Tout cela est vrai. Mais, un peu comme Bernard Mandeville le fera dans La Fable des abeilles (1714), Machiavel a l’immense mérite de nous montrer que la politique n’est jamais fondée sur de bons sentiments. Machiavel, c’est avant l’heure l’anti-Rousseau. Lequel, à l’inverse, glorifie la scène politique et ceux qui l’incarnent. Il n’hésite pas à leur confier jusqu’à l’exercice de la liberté individuelle de chacun, muée par le contrat social en liberté politique. Machiavel, lui, montre que la politique est fondée sur le mal, que le Prince ne suit que son intérêt bien compris, qu’il peut user de fourberie, ourdir des complots, s’entourer d’aigrefins et cent fois renier sa parole. Qu’il le doit, même, s’il veut se maintenir sur son trône. En un sens, l’Ecole de Virginie et les tenants du Public Choice, Tullock, Buchanan et les autres, n’ont rien inventé et se sont « contentés » de « moderniser » la pensée de Machiavel. Qui est encore d’une confondante actualité.
Voici bien le premier enseignement de Machiavel pour un libéral : il fait tomber le Prince, le politique et les hommes de l’Etat de leur piédestal. Ceux qui réussissent en politique sont loin d’être les meilleurs ; ce sont les plus fourbes, les plus malhonnêtes, les plus vicieux. L’Histoire recèle d’innombrables exemples, lointains ou contemporains, qui donnent a posteriori raison au penseur florentin.
En second lieu, Machiavel a, selon le mot de Pierre Manent, fait tomber le mur théologico-politique.
Que faut-il entendre par cette assertion ?
Depuis Aristote, on considère que le bien commun s’incarne dans la Cité. Que la Cité, la sphère politique, est le seul lieu dans lequel l’animal rationnel qu’est l’homme peut accomplir ses vertus, inséparablement civiques et morales. Que c’est dans la Cité que l’homme peut manifester son excellence.
Saint Thomas d’Aquin, en « redécouvrant » Aristote quinze siècles plus tard, fait de la pensée antique le bras armé de Dieu. Thomas prolonge Aristote. Si la Cité incarne le bien commun, dit-il, alors le bien qu’apporte l’Eglise est d’une nature supérieure, vient se surajouter et s’imposer à la Cité. Le bien « civil » de la Cité est en quelque sorte subordonné au bien ontologique de l’Eglise.
D’autres auteurs, par exemple Dante ou Marsile de Padoue, redécouvrent également, et à la même époque, Aristote, mais dans un sens qui cherche, lui, à contenir le pouvoir régulier. Ils objectent à l’Eglise l’existence d’une nature, qui dispose de droits opposables au bien civil et religieux. Certes. Mais l’objection est bien timide, et ne tient pas un instant face à la toute-puissance de l’Eglise, qui a, grâce au thomisme triomphant, et aussi au plenitudo potestatis des Papes, recouvert d’un voile épais l’ensemble du champ du religieux et du politique. Elle dispose des glaives spirituel et temporel. Innocent III en est le héraut.
Machiavel est le premier à s’opposer frontalement à cette doctrine. Il ambitionne d’opposer à la monarchie pontificale des droits profanes, qu’il puise dans la nature.
Pour y parvenir, Machiavel se fait l’anti-Aristote, comme Nietzsche se voudra plus tard l’antéchrist. Loin de considérer la Cité selon sa finalité, la recherche du bien commun, Machiavel la regarde telle qu’elle est, sans ambages, ni fioritures. Il braque la lumière crue des lampes des flics des vieux polars sur les révolutions, les changements de régime, les mensonges, les complots, les manipulations, les intrigues. Il fait perdre au lecteur toute innocence.
Il ne cherche par à faire tomber la distinction entre le bien et le mal, à imaginer un au-delà au bien et au mal, là encore comme le tentera Nietzsche trois siècles plus tard. Il n’efface pas du tout la distinction entre le bien et le mal. Il la préserve au contraire. Car son propos se veut bien plus scandaleux : le bien, pour le Prince, n’a rien à voir avec le bien collectif ou l’intérêt général. Non, le bien, pour le Prince, est le fruit du mal. Et exclusivement le fruit du mal.
Par conséquent, dit Machiavel, il est parfaitement absurde de chercher à améliorer ou à perfectionner le « bien » de la Cité. C’est tout à fait impossible. Qu’il s’agisse de faire appel à un bien supérieur que la religion se chargerait d’apporter, ou qu’il s’agisse de faire appel à un quelconque contrat social, comme ce sera le cas quelques années après la mort de Machiavel, avec Hobbes, puis Rousseau. Rechercher le bien dans la Cité, et a fortiori au-delà, voilà de sympathiques chimères. En réalité, dit-il, le bien public, compris comme le bien du Prince, n’advient que sous le haut pouvoir de la violence et de la peur.
Deux conséquences découlent de ce bond révolutionnaire : d’une part, la politique tombe d’un coup de son piédestal et perd à tout jamais son prestige quasi surnaturel. D’autre part, en affirmant la fécondité et la nécessité du mal, Machiavel montre ainsi l’autosuffisance de l’ordre terrestre, profane, sur l’ordre religieux.
Voici le premier coup, et en réalité le coup fatal, porté à l’absolutisme pontifical. Le joug du Pape sur le pouvoir temporel ne s’en remettra jamais. Philippe le Bel prend sa revanche sur Boniface. Machiavel dissout dans l’acide l’abstraction soi-disant parfaite du pouvoir. Il n’en reste qu’une réalité peu ragoûtante.
Machiavel occupe volontairement une position extérieure à la Cité pour, de là, attaquer ce qui fonde à la fois la consistance autonome de l’Eglise et son droit d’intervention dans la cité : l’idée de bien. Une fois que le corps politique a été interprété comme une totalité close advenue grâce à la violence fondatrice et préservatrice, il est établi que le « bien » apporté par l’Eglise tend à détruire plutôt qu’à perfectionner la cité. Que le bien n’a pas de support dans la nature des choses humaines. Que l’Eglise n’a donc rien à faire et à voir avec les choses de la Cité, et qu’elle doit se contenter de régir l’ordre régulier et l’ordre séculier.
Enfin, on peut tirer encore une dernière grande idée du Florentin. Le peuple ne veut pas être opprimé, les grands veulent l’opprimer. Aucun de ces deux groupes, maîtres et esclaves, n’a une fin à la fois positive et bonne. Aucun de ces deux groupes ne vise un bien. Certes le désir du peuple est tout à fait innocent : il ne désire pas être opprimé. Machiavel va même jusqu’à louer son « honnêteté », au moins relative. Le désir du peuple est sans conteste plus honnête que celui des grands. Mais c’est d’une bonté toute passive ou négative qu’il s’agit.
En affirmant cela, Machiavel, qui dévalorise radicalement les prétentions des grands à la « vertu » et qui fait du peuple le support de la seule « honnêteté » que l’on puisse trouver dans la cité, est le premier penseur démocratique. Ses développement n’ont évidemment rien à voir avec l’absolutisme démocratique qui a cours de nos jours. Ils signifient simplement que chaque individu est plus apte que ses dirigeants à se gouverner lui-même. Et qu’il ne souhaite subir la coercition de personne. Cette définition de la démocratie est bien celle des libéraux modernes, et n’est pas sans rappeler le sens que Hayek donne à la liberté et à la démocratie.