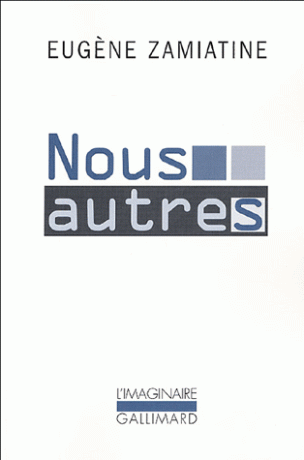Henri Mendras, dans la première édition de ses Eléments de sociologie, met Marx et Tocqueville sur un pied d’égalité et reconnaît pleinement la place de Tocqueville dans les grands maîtres de la sociologie. Raymond Aron, dans son Essai sur les libertés paru deux ans plus tôt, consacre un passage à l’analyse comparée de ces deux penseurs. Revenons un peu sur ces développements.
Dans la majorité des cas, Tocqueville désigne par le terme de démocratie un état de la société et non une forme de gouvernement. La démocratie s’oppose à l’aristocratie. Dans le monde de l’industrie, il y a certes des riches, mais la classe des riches n’existe pas. Car ces riches n’ont pas d’esprit ni d’objets communs, de traditions ni d’espérances communes. Il y a donc des membres, mais pas de corps. Au demeurant, richesse et pouvoir tendent à se dissocier. Le travail devient l’activité honorable, normale, de tous et de chacun. Les artistocrates méprisent le travail en vue d’un profit. Dans les sociétés démocratiques, les deux idées de travail et de gain ne se séparent plus. Tocqueville n’en reste pas moins conscient de l’écart entre la définition de la démocratie comme un état de la société et la définition traditionnelle de la démocratie, comme d’un type de régime.
Contre l’abus du terme démocratie par les porte-parole d’un régime despotique, Tocqueville rappelle que la société à laquelle aspiraient les constituants aurait été libre en même temps que démocratique, « non une société militaire mais une société civile ». Mais si, même despotiques, les sociétés modernes conservent certains traits démocratiques, l’inspiration profonde de la Révolution française comme de la société américaine tend à joindre démocratie et libéralisme, égalité et liberté. C’est ainsi que la liberté moderne apporte à chaque homme naissant « un droit égal et imprescriptible à vivre indépendant de ses semblables, en tout ce qui n’a rapport qu’à lui-même, et à régler comme il l’entend sa propre destinée » (1) Par conséquent cette liberté est négative (elle a pour expression l’indépendance, le choix par chacun de sa destinée), indéterminée (il reste à savoir jusqu’où va ce qui, pour chacun, n’a rapport qu’à lui-même), mais aussi positive (liberté-indépendance, freedom to par opposition à freedom from). Cette liberté-indépendance, celle que Montesquieu aurait appelée sécurité ou absence d’arbitraire, ne s’accomplit authentiquement que dans la liberté proprement politique, c’est-à-dire la participation des citoyens à l’administration des affaires locales et à la gestion de la chose publique.
Il est vrai qu’il existe aussi une liberté-privilège, celle des aristocrates de l’Ancien Régime. Elle suscita des génies fiers et audacieux, mais elle était en elle-même « déréglée et malsaine, elle préparait les Français à renverser le despotisme, mais elle les rendait moins propres qu’aucun autre peuple, peut-être, à fonder à sa place l’empire paisible et libre des lois ». Tout au contraire, en Amérique, les institutions libres sont nées avec la société elle-même et elles eurent pour fondement non l’esprit de privilège et d’orgueil aristocratique, mais l’esprit religieux. Soumis aux lois, le citoyen obéit à un pouvoir qu’il respecte, quel qu’en soit le détenteur provisoire. Obéissant par opportunisme à un régime sans légitimité, le citoyen se dégrade en sujet. Ou encore, comme nous dirions aujourd’hui, il est consommateur, inquiet pour son bien-être, non citoyen, soucieux et responsable de la chose publique. L’obéissance devient servitude dès lors que le pouvoir, illégitime et méprisé, ne conserve d’autre principe (2), que la peur ou le conformisme.
Ainsi se dégage la théorie de la démocratie libérale, à bien des égards différente de la République antique, que Montesquieu avait prise pour modèle de la démocratie. Le travail, le commerce, l’industrie, le désir de gain et de bien-être, la poursuite du bonheur ne contredisent plus le principe de la démocratie. « Les Américains ne forment pas un peuple vertueux, et cependant ils sont libres. Ceci ne prouve pas absolument que la vertu, comme le pensait Montesquieu, n’est pas essentielle à l’existence de la République. Il ne faut pas prendre l’idée de Montesquieu dans un sens étroit. Ce qu’a voulu dire ce grand homme, c’est que les Républiques ne pouvaient subsister que par l’action de la société sur elle-même. Ce qu’il entend par vertu, c’est le pouvoir moral qu’exerce chaque individu sur lui-même et qui l’empêche de violer le droit des autres. Quand le triomphe de l’homme sur les tentations est le résultat de la faiblesse de la tentation et d’un calcul d’intérêt personnel, il ne constitue pas la vertu aux yeux du moraliste ; mais il rentre dans l’idée de Montesquieu qui parlait de l’effet bien plus que de sa cause. En Amérique, ce n’est pas la vertu qui est grande, c’est la tentation qui est petite, ce qui revient au même. Ce n’est pas le désintéressement qui est grand, c’est l’intérêt qui est bien entendu, ce qui revient encore presque au même. Montesquieu avait donc raison quoiqu’il parlât de la vertu antique et ce qu’il dit des Grecs et des Romains s’applique aux Américains ». (3)
Ce faisant, Tocqueville présente une triple originalité. En premier lieu, il définit la société moderne non par l’industrie à la manière de Comte, non par le capitalisme à la manière de Marx, mais par l’égalité des conditions, c’est-à-dire par la démocratie au sens social du terme. Ensuite, il adopte à l’égard de l’histoire et de l’avenir une perspective probabiliste. Il n’annonce pas un mouvement irrésistible vers un régime, positiviste ou socialiste. Il n’y a pas détermination adéquate, pour parler comme Max Weber, du régime politique par l’état démocratique de la société. Enfin, il se refuse à subordonner la politique à l’économie, à prophétiser à la manière des saint-simoniens que l’administration des choses remplacera le gouvernement des personnes, ou bien, à la manière de Marx, à confondre la classe socialement privilégiée avec la classe politiquement dirigeante. Pour Tocqueville, c’est l’Ancien régime plutôt que la société moderne qui apparaît divisé en classes. La société de bien être, de classe moyenne connaît à coup sûr une stratification : est-elle divisée en classes comme semblait l’être la société capitaliste que Marx observait au début du siècle dernier et dans laquelle les inégalités de fonctions économiques et de revenus reproduisaient, en les accentuant, les discriminations des antiques états ?
Ce qui frappe d’emblée dans la pensée de Marx, c’est l’éclatant démenti que l’histoire lui a opposé, dans la mesure où elle niait l’influence des idées. Marx part de l’idée de démocratie : elle est, « à un certain point de vue, à toutes les autres formes politiques comme le christianisme à toutes les autres religions. Le christianisme est l’essence de la religion, l’homme déifié sous forme de religion particulière. De même la démocratie est l’essence de toute constitution politique, l’homme socialisé, comme constitution politique particulière ». La démocratie, selon Marx, révèle la vérité secrète, l’énigme résolue de toutes les constitutions parce que le peuple est l’origine, le créateur de toutes les superstructures politiques et que l’homme n’arrive à la vérité de lui-même qu’en se reconnaissant maître et possesseur de toutes les institutions dans lesquelles il s’est, à travers les siècles, aliéné. L’homme de la société civile ne sort pas de sa particularité. Citoyen, il participe à l’universalité de l’Etat, mais cette particularité demeure en marge de la vie privée, concrète du travailleur. Ainsi la dualité du privé et du public, comme la dualité du profane et du sacré, ont pour origine le non-accomplissement par l’homme de son humanité. Une révolution purement politique, qui ne modifie pas l’infrastructure sociale, ne permet pas à l’homme de s’accomplir, puisqu’elle ne libère pas l’homme véritable. La société civile des travailleurs ne pourra se réconcilier avec le ciel de la politique aussi longtemps qu’elle sera abandonnée à l’arbitraire des désirs, à l’anarchie des égoïsmes, à la luttre de tous contre tous. De même, la dualité du profane et du sacré, de la société et de la religion durera aussi longtemps que l’homme, faute de réaliser son essence, la projettera dans un transcendant illusoire. Libérer l’homme de l’illusion religieuse, libérer l’homme de la séparation entre le travailleur et le citoyen, cette double libération est impossible aussi longtemps que l' »arme de la critique » et la « critique des armes » n’iront pas jusqu’aux racines, c’est-à-dire jusqu’à l’économie. C’est la raison pour laquelle la révolution de Marx est une révolution économique et sociale. Comme il le dit lui-même : « Le communisme se différencie de tous les mouvements passés en ce qu’il bouleverse la base de toutes les anciennes conditions de production et de commerce et, pour la première fois, traite sciemment toutes les présuppositions naturelles comme des créations des hommes passés, les dépouille de leur caractère naturel et les soumet à la puissance des individus unis. » (4) Ce qui est inédit, ce n’est pas tant l’idée d’un bouleversement des conditions économiques, du mode de la production et des échanges que le refus de tenir aucune des données de l’ordre social comme une fatalité, échappant à la maîtrise des hommes. C’est par l’orgueil prométhéen, par la confiance dans la capacité des hommes unis de devenir maîtres de la nature et maîtres de la société que l’inspiration marxiste diffère en essence de l’inspiration libérale. Au point de départ, Marx ne veut pas revenir sur les conquètes de la Révolution française, il veut les achever. Mais concrètement, que signifie l’insertion de l’idéal démocratique dans la société civile ou, en termes plus compréhensibles, comment le travailleur pourrait-il atteindre à une liberté comparable à la liberté formelle du citoyen ? Une première interprétation, banale, avance que le travailleur est privé de liberté parce qu’il obéit à un entrepreneur, asservi au marché. En ce cas, c’est par la suppression de la propriété privée des instruments de production que la société civile sera « démocratisée », soumise à la volonté des producteurs associés. Selon une deuxième interprétation, la condition première de la libération, c’est le développement des forces de production, la mise à la disposition de chacun des ressources nécessaires à une existence décente, enfin la diminution de la durée du travail. Un texte fameux du tome III du Capital rappelle que le travail sera toujours le domaine de la nécessité. C’est en dehors, au-delà du travail que commence le règne de la liberté.
Ces deux interprétations méconnaissent certains éléments essentiels de la pensée de Marx. Par quelles institutions de fait société civile et société politique, activité économique et activité politique pourraient-elles être confondues ? Le jour où le travailleur est directement au service de la collectivité et non plus au service d’un possesseur de moyens de production, il devient citoyen à la manière du fonctionnaire. Si l’on entend par liberté la marge de choix et d’autonomie réservée à l’individu, ce que Marx nomme émancipation se dégrade en servitude.
La classification marxiste des régimes économiques se fonde sur un critère unique, à ses yeux décisifs : la relation entre les hommes au travail, déterminant la mode de prélèvement et de répartition de la plus-value. L’exploitation s’achève en se camouflant, pour ainsi dire : le salaire ne représente que l’équivalent des marchandises nécessaires à la vie du travailleur et de sa famille. Le reste – c’est-à-dire la plus-value – appartient au détenteur des moyens de production.
Ainsi, en apparence, Tocqueville laissait aux hommes la responsabilité du choix, à l’intérieur d’un monde démocratique, entre la liberté et le despotisme, cependant que Marx les condamnait soit à subir passivement la dialectique soit à tenter vainement de s’y opposer soit, enfin, à en accélérer le déroulement.
En réalité, le dialogue des deux hommes est inverse de ce qu’il apparaît. Marx a invoqué un déterminisme historique non comme un alibi à une lâche résignation mais comme une justification et une dissimulation à la fois d’une volonté proprement démiurgique. Aussi quand Lénine et les bolchevicks firent confiance au parti pour se substituer à la dialectique, ils trahirent à coup sûr la doctrine marxiste, mais ils en retrouvèrent un élément originel et vital : la foi dans la capacité des hommes unis de liquider les survivances des siècles écoulés et d’édifier souverainement, à partir de fondements nouveaux, un ordre social.
La relation Tocqueville-Marx est à bien des égards symétrique : l’un, par conservatisme social, s’est fait, contre ses préférences intimes, le théoricien de la démocratie libérale, c’est-à-dire de la démocratie bourgeoise ; l’autre a voulu être, en toute conscience, le doctrinaire en même temps que le dirigeant de la classe ouvrière organisée. L’un mettait au-dessus de tout, explicitement, la sauvegarde des libertés personnelles et politiques, mais la démocratie libérale lui semblait aussi la protection la plus efficace de la hiérarchie sociale et des inégalités économiques. L’autre jugeait dérisoires toutes les réformes qui laisseraient subsister, avec la propriété privée des instruments de production, la cause ultime des contradictions sociales et du malheur ouvrier. L’un abandonnait à eux-mêmes industrie et commerce, spontanément exercés par les individus sous le contrôle des lois, et craignait que l’individu ne fût privé tout à la fois de la liberté-indépendance et de la liberté-participation. L’autre tenait la libre activité de chacun dans l’industrie et le commerce pour la cause de l’asservissement de tous. Ainsi la condition majeure de la liberté était pour l’un le régime représentatif et pour l’autre une révolution économique.
Il est loisible de prétendre que Tocqueville s’assurait quelque confort intellectuel en prévoyant que la société de l’avenir serait dominée par la classe moyenne. Mais cela dit, sa vision, à long terme, n’en était pas moins juste et celle de Marx fause, sans que pour autant, la vision à court terme de ce dernier fût juste puisque, dès le milieu du siècle dernier, il escomptait, d’année en année, le bouleversement salvateur.
On peut déjà observer, à ce niveau d’analyse, la supériorité de l’observation naïve et de l’expérience historique sur les raisonnements, imparfait et unilatéraux, des spécialistes.
Mais pourquoi Marx tire-t-il d’un modèle d’économie dynamique, à forte accumulation de capital, la conclusion d’un appauvrissement des masses en dépit d’une productivité croissante ? Si, grâce à l’élévation de la productivité, les heures de travail nécessaires pour produire les marchandises représentant la valeur du salaire diminuent, il aurait dû reconnaître que la même part de la journée étant consacrée à produire une valeur équivalente à celle du salaire et la productivité ayant augmenté, le niveau de vie devait tendre à s’élever ou la pauvreté à s’atténuer. Pour éviter cette conclusion, Marx a fait intervenir, non pas, comme plusieurs économistes de son temps, l’effet sur le taux de natalité, donc sur l’offre de travail, d’une élévation des salaires, mais l’armée de résèrve industrielle, autrement dit la pression qu’exerce en permanence sur les taux des salaires l’offre des travailleurs sans emploi du fait des transformations techniques. Si Marx avait abordé l’étude de l’économie en pur observateur sans savoir à l’avance ce qu’il voulait démonter, il n’aurait pas affirmé avec autant de force la paupérisation absolue.
On ne peut pas ne pas attribuer à Marx une erreur cardinale : la prévision qu’en régime de propriété privée et de marché la condition des masses s’aggraverait fatalement, et que le capitalisme périrait. Tocqueville était tout au contraire un penseur probabiliste : il laissait deux voies ouvertes à l’avenir de l’humanité ; démocratie libérale ou démocratie despotique. L’erreur majeure de Marx a été de croire que seule une révolution radicale permettrait de libérer le travailleur, au double sens d’amélioration du niveau de vie et de participation à la vie collective. L’autre erreur cardinale, non de Marx mais des marxistes, a été de tirer d’une critique juste une conséquence fausse. Les libertés personnelles ou les droits subjectifs (politiques) auxquels Tocqueville était passionnément attaché ne suffisent pas à donner un sentiment de liberté. Cette critique est juste mais la conséquence – les libertés formelles, luxe de privilégiés – est fausse. Car l’expérience soviétique montre avec éclat que les « producteurs associés », sous la direction du prolétariat constitué en classe dirigeante, peuvent être ressentis par les individus non comme les artisans d’une libération totale mais comme les responsables d’une servitude totale.
Le jour où, sous prétexte de liberté réelle, l’autorité de l’Etat s’étend à l’ensemble de la société et tend à ne plus reconnaître de sphère privée, ce sont les libertés formelles que revendiquent les intellectuels et les masses elles-mêmes. un bon exemple en est le cas hongrois de 1956. Même en Union soviétique, ce qui est constamment en question, c’est la liberté (formelle) qu’il convient de laisser aux intellectuels. Mais si l’art n’est plus au service du parti et de l’édification socialiste, si l’idéologie ne commande plus à l’existence sociale tout entière, l’unité d’une société sans classes, la confusion de cette société sans antagonismes et d’un Etat qui se veut l’expression de la totalité sont à leur tour compromises. Une dissociation s’esquisse entre la sphère publique et les sphère privées. Mais, ce jour-là, sur quoi se fondera le monopole du parti ? Comment justifiera-t-il sa prétention au pouvoir absolu ?
Une doctrine d’action comme celle de Marx est comptable non de ses seules intentions (comme beaucoup le prétendent), mais aussi de ses implications, même contraires à ses valeurs et à ses buts. Le prolétariat, c’est-à-dire des millions de travailleurs, ne peut exercer lui-même la dictature. Dès lors on peut comprendre que le marxisme ait abouti à un asservissement total de tous à un parti, voire à un homme.
A l’inverse, ce qui caractérise les régimes occidentaux, c’est le pluralisme – pluralité des sphères (privées et publique), pluralité des groupes sociaux (dont certains s’érigent en classes), pluralité des partis en compétition. Selon les pays et les circonstances, ce sont les libertés formelles – ainsi à l’époque du maccartysme – ou les libertés réelles – ainsi aux yeux des ouvriers acquis à la doctrine marxiste-léniniste – qui semblent en péril et constituent l’enjeu des conflits. Tantôt c’est la société qui apparaît tyrannique plutôt que l’Etat (aux yeux des Noirs américains par exemple), tantôt c’est l’Etat qui semble soustrait à la volonté de ceux qui en doivent être les inspirateurs sinon les gestionnaires.
Ainsi nous pouvons dire que là où un parti unique maintient un régime despotique et interdit aux intellectuels d’oeuvrer selon leur génie, la revendication de liberté formelle retrouve sa fraîcheur et sa virulence passée. Quant aux masses, elles ne semblent pas, même insatisfaites, mettre en question les dogmes du régime. Mais au moins mettent-elles en question le parti unique. En d’autres termes, les griefs économiques et sociaux, de l’autre côté du rideau de fer (5), ne s’organisent pas en une idéologie de remplacement, alors que, dans la sphère politique, l’idéologie ou même les institutions de remplacement paraissent disponibles. A l’Ouest, les principes des libertés formelles et de la démocratie libérale ne sont plus sérieusement discutés. Quant aux revendications ou aux insatisfactions sociales et économiques, elles sont également multiples et diverses, mais, pas plus que de l’autre côté du rideau de fer, elles ne s’organisent aisément en un système ou en une doctrine de substitution. Tout se passe comme si l’insatisfaction était incapable de susciter une volonté révolutionnaire, parce que les causes en sont si nombreuses et si obscures que nulle théorie globale ne peut les saisir, nulle action les éliminer d’un coup. L’insatisfaction occidentale se refuse au désespoir comme à l’espérance.
Les sociétés industrielles d’aujourd’hui sont-elles les héritières du libéralisme, ou de l’ambition prométhéenne des marxistes ?
Pour une part, toutes les sociétés industrielles sont héritières de l’ambition prométhéenne en ce sens qu’elles font toutes une telle confiance à la maîtrise acquise grâce à la technique sur la nature et grâce à l’organisation sur les phénomènes sociaux qu’aucun gouvernement, aucun théoricien n’admettrait plus comme fatales certaines formes de misère. Comme le résume la charte de l’Atlantique, « aucune condition sociale ne doit plus être tenue pour indépendante de la volonté rationnelle des hommes. » La formule est presque textuellement marxiste, mais elle exprime la foi commune ou l’illusion universelle des sociétés modernes. Mais bien sûr, les sociétés industrielles de type occidental demeurent des démocraties libérales. Il n’est donc pas question de suggérer une quelconque contradiction ; mais comment méconnaître que la crainte de l’arbitraire et l’orgueil prométhéen appartiennt à deux univers spirituels, expriment deux attitudes tout autres à l’égard de la société ? Ainsi a contrario, dans les pays nouveaux, c’est l’ambition de construire ou de reconstruire l’ordre social à partir de ses fondements, l’orgueil marxiste et non la modestie libérale, qui répond aux sentiments des élites plus encore que des masses. Les libertés des libéraux exigent la discrimination des sphères et le respect des formes. Par impatience et peut-être par illusion d’efficacité, les partis uniques qui se multiplient à travers la planète, même sans se référer à Marx ou au marxisme-léninisme, nient les libertés individuelles dans l’espoir que les « producteurs associés » construiront d’abord un ordre social neuf pour libérer les hommes du besoin, sinon de la peur.
Les sociétés occidentales, la société américaine témoignent que non seulement libertés formelles et libertés réelles ne sont pas incompatibles mais que, à notre époque, c’est dans les mêmes sociétés que les unes et les autres sont le moins imparfaitement réalisées.
Ce que nous voulons dégager, c’est que la société industrielle dans laquelle nous vivons et que pressentaient les penseurs du siècle dernier, est démocratique par essence. Elle est normalement, sinon nécessairement, démocratique, si l’on veut dire qu’elle n’exclut personne de la citoyenneté et tend à diffuser le bien-être. En revanche, elle n’est libérale que par tradition ou survivance, si, par libéralisme, on entend le respect des droits individuels, des libertés personnelles, des procédures constitutionnelles.
1 : A. de Tocqueville, Oeuvres complètes, t. II, 1, p. 62. 2 : Au sens de Montesquieu, c’est-à-dire le sentiment grâce auquel un certain régime est susceptible de prospérer. 3 : Ce fragment, retrouvé dans les notes de Tocqueville, a été publié par J-P Mayer dans la NRF du 1/4/1959 et dans la Revue internationale de philosophie (1959), n°49, fasc.3. 4 : Marx, Die deutsche Ideologie, Marx-Engels Werke, Dietz Verlag, tome III, p. 70. 5 : L’Essai sur les libertés a été rédigé en 1963.