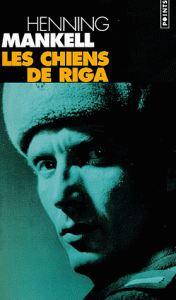« Dans l’état socialiste idéal, le pouvoir n’attirera pas les fanatiques du pouvoir. Les gens qui prennent les décisions n’auront pas la moindre tendance à favoriser leurs intérêts personnels. Il n’y aura pas moyen, pour un homme habile, de détourner les institutions pour les mettre au service de ses propres fins. Et on verra les crocodiles voler. »
 David D. Friedman, né en 1945, est un écrivain libertarien, professeur d’université et promoteur de l’anarcho-capitalisme.
David D. Friedman, né en 1945, est un écrivain libertarien, professeur d’université et promoteur de l’anarcho-capitalisme.
Docteur en physique diplômé de l’université de Chicago, il est davantage connu pour ses travaux d’économie politique. Il a exposé en particulier la théorie anarcho-capitaliste dans son œuvre majeure Vers une société sans État (The Machinery of Freedom).
Il a commencé par enseigner l’économie puis le droit à l’université de Santa Clara, reprenant l’idée d’Hayek selon laquelle il est impossible d’être économiste en se cantonnant à l’économie. Il est issu d’une famille d’intellectuels : son père, Milton Friedman, a reçu le Prix Nobel d’économie, et sa mère est l’économiste Rose Friedman. Son oncle Aaron Director est professeur de droit, tandis que son fils Patri Friedman est également un libertarien connu.
Grand amateur d’histoire, David Friedman fait partie de la Société d’Anachronisme créatif (Society for Creative Anachronism), association qui organise la reproduction de scènes historiques avec plusieurs milliers d’acteurs bénévoles. Il a organisé le plus grand tableau, the Pennsic War. Adepte de la science fiction, il a écrit une nouvelle de fantasy, Harald , publiée en 2006. Friedman est également chroniqueur pour Liberty magazine.
Une approche utilitariste du libéralisme
Alors que la plupart des libertariens adoptent un point de vue déontologique en termes de droit naturel, voire une approche aprioriste comme Rothbard, Friedman est quant à lui utilitariste, et s’attache à montrer que les conséquences de l’anarcho-capitalisme sont bénéfiques pour tout le monde, y compris les pauvres. Sa vision du passage à une société anarcho-capitaliste n’est pas ontologique mais au contraire pragmatique et graduelle : par exemple, il préconise, prolongeant ainsi les travaux de son père, les bons scolaires (education vouchers) comme un prélude à la privatisation du système éducatif, et la décentralisation de la police comme une étape vers une défense totalement privée.
Le droit de propriété est indépassable
Friedman fonde l’essentiel de son argumentation sur le caractère crucial du droit de propriété et de ses implications économiques. Il montre en particulier comment celui-ci est bafoué par les nombreuses politiques menées par la gauche comme par la droite. Il s’attaque notamment aux législations anti-trust, dont il démontre magistralement l’inanité, aux politiques d’aide sociale – qui favorisent surtout les classes moyennes – et, plus généralement, démontre qu’à travers l’appareil d’Etat, tout le monde en vient à voler tout le monde et donc que chacun y perd.
La propriété privée, pour David Friedman, ce n’est pas n’importe quoi. C’est d’abord le droit sur sa propre personne, puis le droit sur sa propre production et, enfin, le droit sur ce qu’on échange volontairement avec les autres.
Sujet très important, et corollaire au droit de propriété, la « question sociale » n’est pas esquivée. Friedman montre de façon très convaincante que tout le monde serait gagnant dans une société libre. Il souligne le fait qu’un des problèmes que nous rencontrons quand nous jugeons les sociétés d’antan est la difficulté de faire la séparation entre les conséquences de la pauvreté et celles des institutions politiques. Ainsi les sociétés américaines et britanniques du XIXe siècle sont souvent décrites comme repoussantes par ceux qui les comparent aux sociétés du XXe siècle. Ce faisant, la plupart des historiens ignorent que nos sociétés contemporaines sont la résultante des progrès des sociétés du siècle précédent.
Un problème similaire existe dans l’analyse du féodalisme. Le féodalisme semble repoussant pour une large partie car les hommes étaient alors beaucoup plus pauvres qu’aujourd’hui. D’un autre côté, le féodalisme fut un système politique décentralisé dans lequel les armées combinées des barons surpassaient l’armée du roi. En plus, ce fut un système dans lequel les frontières – non entre les royaumes mais entre les baronnies – étaient très proches, ainsi les seigneurs locaux devaient tenir compte du fait que s’ils maltraitaient leurs sujets, ces derniers pouvaient s’installer chez le seigneur voisin.
Le passage du féodalisme à la monarchie absolue marqua donc, pour Friedman, une régression – les monarques du XVIe et du XVIIe siècles purent donc davantage opprimer leurs sujets que ne le purent les seigneurs féodaux du XIIIe siècle.
Enfin, il expose des arguments très forts pour prouver que les crises économiques, notamment la grande crise de 1929, sont dues aux interventions intempestives et surtout incompétentes des hommes de l’Etat. Il poursuit et confirme en cela les travaux de Murray Rothbard.
L’anarchie n’est pas le chaos
Friedman entreprend donc de détricoter l’Etat, cette construction monstrueuse qui nous opprime, menace nos libertés, nous rançonne, qui prétend monopoliser l’usage de la violence pour notre propre bien et qui finira par diriger chacun des actes de notre vie si nous le laissons faire. L’Etat qui fait tout pour penser à notre place, ce mythe, cette fiction qui est la principale cause des guerres du XXe siècle.
L’Etat ? Ou plutôt les hommes de l’Etat, car l’Etat comme entité abstraite n’existe pas, alors que les présidents de la république, les gouvernements, les fonctionnaires, les ministres et autres parasites de toutes sortes, eux, existent bien. L’Etat n’existe pas réellement, c’est une fiction légale qui prend sa substance du fait que des hommes collectent des impôts, paient des impôts, font respecter les lois édictées par les gouvernements, obéissent à ces lois.
La société anarcho-capitaliste est possible
Dans son classique Vers une Société sans Etat, David Friedman expose avec clarté et humour sa conception du libertarianisme.
Il démontre non seulement la désirabilité, mais aussi la faisabilité pratique d’une société fonctionnant sans le moindre État, lequel est défini comme une agence de type gouvernementale bénéficiant d’un monopole de la violence légale et parfois de divers autres droits exclusifs.
Dans la deuxième partie de son ouvrage, « La Hotte du père Noël libertarien ou Comment vendre l’Etat par petits morceaux », il donne des exemples pratiques de la théorie libertarienne (enseignement, éducation, routes, immigration, santé, etc.) Il se situe clairement du côté des partisans de l’immigration libre.
Il fournit donc une illustration concrète de ce que serait le démantèlement progressif de l’Etat. Contrairement à ce que l’on croit souvent, il a existé et il existe encore de nombreux « services publics » aux Etats-Unis. David Friedman passe en revue certains d’entre eux et propose de les privatiser. Il commence par les écoles et les universités et poursuit avec les rues, la Poste et le programme spatial.
Il fournit aussi quelques réflexions sur la véritable fonction des réglementations étatiques, la démocratie, etc. « Imaginez cent personnes assises en cercle, écrit-il, chacune ayant sa poche pleine de pièces de un cent. Un politicien marche à l’extérieur du cercle, prenant un cent à chacun. Personne n’y prête attention : qui se soucie d’un cent ? Lorsqu’il a fini le tour du cercle, le politicien jette 50 cents devant une personne, qui est ravie de cette aubaine inattendue. On recommence le processus, en terminant avec une personne différente. Au bout de cent tours, chacun se retrouve plus pauvre de 100 cents ; plus riche de 50 cents, et heureux. »
Friedman présente, enfin, une courte étude sur la société islandaise médiévale qui, telle l’Irlande décrite par Rothbard – connut une période libertarienne.
La police et la juste privées
Friedman décrit les institutions qui seraient viables dans un cadre libertarien. Il détaille longuement le cas de la sécurité et de la justice, pour illustrer le changement de perspective auquel il faut parvenir pour constituer une société anarcho-capitaliste. Comment assurer sa sécurité, faire appel à la justice et définir le droit dans une société libre ? Par le marché et la concurrence, répond-il, toujours dans le respect de la propriété privée légitime bien sûr.
Si des boulangeries privées et concurrentes produisent un pain en général d’excellente qualité, pourquoi des entreprises privées et concurrentes de protection individuelle ne produiraient-elles pas une sécurité d’excellente qualité et pourquoi des tribunaux privés et concurrents ne produiraient-ils pas un droit d’excellente qualité ? Comment, sans gouvernement, pourrions-nous régler les conflits qui sont actuellement réglés dans les tribunaux ? Comment pourrions-nous alors nous protéger contre les criminels ?
Considérons d’abord, dit Friedman, le cas le plus facile, la résolution des conflits impliquant des contrats entre des sociétés bien établies. Une grande partie de tels litiges sont maintenant réglés non pas par des tribunaux d’Etat mais par l’arbitrage privé. Les sociétés, quand elles élaborent un contrat, indiquent la procédure d’arbitrage pour n’importe quel conflit qui peut surgir. Ainsi elles évitent les dépenses et les délais de la justice.
L’arbitre n’a aucune force de police. Sa fonction est de rendre des décisions, pas de les faire respecter. Les décisions arbitrées sont habituellement exécutoires, mais c’est un développement récent ; historiquement, l’exécution venait du désir d’une entreprise de maintenir sa réputation. Si on refuse le jugement d’un arbitre, il est difficile de persuader quelqu’un de signer un contrat qui indique un arbitrage ; personne ne veut jouer au jeu de « pile tu gagnes, face je perds ».
L’arbitrage, par lui-même, ne fournit aucune solution pour la personne dont la voiture est abîmée par un conducteur négligent, encore moins pour la victime d’un vol ; dans les deux cas, le plaignant et le défendeur, ayant des intérêts différents et aucun accord préalable, sont peu susceptibles de trouver un arbitre qui leur convienne mutuellement. Le défendeur n’a aucune raison d’accepter un arbitrage quel qu’il soit ; il a tout à y perdre – ce qui nous amène au problème d’empêcher la coercition.
Or, la protection contre la coercition est un bien économique. Elle est actuellement vendue dans une variété de formes – gardiennage, serrures, alarmes. Pendant que l’efficacité de la police étatique diminue, le marché fournit des produits de remplacement pour la police, comme pour les tribunaux.
Supposons, poursuit David Friedman, qu’un jour il n’y ait plus aucune police étatique, mais des agences de protection privées à la place. Ces agences vendent un service qui consiste à protéger leurs clients contre le crime. Peut-être vont-elles jusqu’à offrir une garantie de résultats en assurant leurs clients contre des pertes résultant d’actes criminels.
Comment de telles agences de protection pourraient-elles nous protéger ? Ce serait sur la base d’une décision économique, selon les coûts et l’efficacité des différentes solutions possibles. A une extrémité, elles pourraient se limiter à la défense passive, installant des serrures et des alarmes sophistiquées. Ou bien elles ne prendraient aucune mesure préventive, mais feraient de grands efforts pour retrouver les criminels coupables de délits contre leurs clients. Elles pourraient maintenir des patrouilles ou les voitures en faction, comme la police étatique actuelle, ou elles pourraient se reposer sur des substituts électroniques. De toute façon, elles vendraient un service à leurs clients, et auraient une incitation véritable à fournir une qualité de service aussi élevée que possible, au coût le plus bas. Il est raisonnable de supposer, dit Friedman, que la qualité de service serait plus élevée et le coût plus bas qu’avec le système étatique actuel.
Qui ferait les lois ? Sur quelle base l’arbitre privé déciderait-il quels actes sont criminels et comment ils devraient être punis ? La réponse est que des systèmes juridiques seraient produits dans le commerce sur le marché libre, exactement comme des livres et des soutiens-gorge sont produits aujourd’hui. Il pourrait y avoir concurrence parmi différentes marques juridiques, juste comme il y a concurrence entre différentes marques de voitures.
Dans une telle société il pourrait y avoir beaucoup de tribunaux et même beaucoup de systèmes légaux. Chaque paire d’agences de protection convient à l’avance quel tribunal elles invoqueront en cas de conflit. Ainsi les lois en vertu desquelles sera traité un cas particulier seront déterminées implicitement par l’accord anticipé entre les agences de protection des clients concernés. En principe, il pourrait y avoir un tribunal différent et un système de lois différent pour chaque paire d’agences de protection. Dans la pratique, beaucoup d’agences trouveront probablement commode de traiter avec les mêmes tribunaux, et beaucoup de tribunaux pourraient trouver commode d’adopter des législations identiques ou presque identiques, afin de simplifier les affaires avec leurs clients.
Avant de qualifier d’injuste ou de chaotique une société dans laquelle différentes personnes sont régies par différentes lois, rappelez-vous, poursuit Friedman, que dans notre société la loi en vertu de laquelle vous êtes jugés dépend du pays et même de la ville dans laquelle vous vous trouvez. Dans le cadre des arrangements décrits ici, elle dépend de votre agence de protection et de l’agence de la personne que vous accusez ou qui vous accuse.
Dans une société anarcho-capitaliste, la loi est donc un produit du marché. Un tribunal vit de la facturation des services d’arbitrage qu’il rend. Son succès dépendra de la réputation qu’il obtiendra du point de vue de l’honnêteté, de la fiabilité, de la promptitude et de l’attrait auprès des clients potentiels de l’ensemble des lois qu’il applique. Les clients immédiats sont les agences de protection. Mais une agence de protection elle-même vend un produit à ses clients. Dans ce produit entrera le ou les systèmes juridiques des tribunaux dont elle est cliente, et sous lesquels ses clients seront par conséquent jugés. Chaque agence de protection essayera d’entrer en affaires avec les tribunaux dont le système juridique plaira le plus à ses clients.
S’il advient que les clients des deux agences soient aussi acharnés les uns que les autres, peut-être deux tribunaux seront choisis, un de chaque sorte, et les procès assignés aléatoirement entre eux. De toute façon, la préférence juridique du client, son avis quant au type de loi auquel il entend se soumettre, aura été un facteur important pour déterminer le type de loi qui le régit. Cela ne peut complètement contribuer à le déterminer, puisque accusé et accusateur doivent avoir la même loi.
Les différences entre les tribunaux seraient probablement plus subtiles. Les gens constateraient que les décisions d’un tribunal sont plus promptes ou plus prévisibles que celles des autres, ou que les clients d’une agence de protection sont mieux protégés que ceux des autres. Les agences de protection, essayant d’établir leur propre réputation, rechercheraient les « meilleurs » tribunaux.
Plusieurs objections peuvent être formulées contre un tel marché libre de la justice. Le premier est que les tribunaux rendraient la justice en décidant en faveur de celui qui paie le plus. Ce serait suicidaire ; sans une réputation d’honnêteté, ils n’auraient aucun client – à la différence de nos tribunaux actuels.
Une autre objection est que c’est le travail des tribunaux et de la législation de découvrir les lois, et pas de les créer ; il ne peut pas y avoir en concurrence deux lois de la pesanteur, aussi pourquoi devrait-il y avoir en concurrence deux lois sur la propriété ? Mais il peut y avoir deux théories en concurrence au sujet de la loi de la pesanteur ou de la définition des droits de propriété. La découverte est une activité aussi productive que la création. S’il est évident de déterminer une législation correcte, ou quelles règles sociales découlent de la nature de l’homme, alors tous les tribunaux s’entendront, de même que tous les architectes s’accordent quant aux lois de la physique. Si ce n’est pas évident, le marché engendrera la recherche destinée à découvrir des législations correctes.
Une autre objection est que dans une société avec beaucoup de systèmes juridiques on ne s’y retrouverait plus. Si cela s’avère être un problème sérieux, les tribunaux auront une incitation économique à adopter une législation uniforme, exactement comme les papeteries ont une incitation à produire du papier avec des tailles normalisées. Une nouvelle législation sera présentée seulement quand l’innovateur croira que ses avantages sont supérieurs à ceux de l’uniformité.
L’objection la plus sérieuse à la législation de libre marché est que le plaignant et le défendeur peuvent ne pas se mettre d’accord sur un tribunal commun. Évidemment, un meurtrier préférerait un juge clément. Si le ttribunal était choisi réellement par les parties après que le crime s’est produit, cela pourrait constituer une difficulté insurmontable. Dans le cadre des arrangements que j’ai décrits, le tribunal est choisi à l’avance par les agences de protection. On aurait du mal à trouver à un instant donné un nombre de meurtriers suffisant pour faire vivre leur propre agence de protection, une qui serait affiliée à des tribunaux qui ne considèreraient pas le meurtre comme un crime. Et même si c’était le cas, aucune autre agence n’accepterait de tels tribunaux. L’agence des meurtriers accepterait un tribunal raisonnable ou bien serait engagée dans une guerre désespérée contre le reste de la société.
Jusqu’à ce qu’il soit réellement accusé d’un crime, chacun veut des lois qui le protègent contre le crime et le laissent interagir paisiblement et productivement avec autrui. Même les criminels sont ainsi. Peu de meurtriers souhaiteraient vivre sous une législation qui leur permettrait de tuer – et aussi d’être tué.
Un livre de synthèse : David Friedman, Vers une société sans Etat, 1971, 1973, 1989 : Ce livre appelle à une privatisation de toutes les fonctions gouvernementales, en fournissant de nombreux exemples, et explore ainsi les conséquences de la pensée libertarienne, telles que l’histoire de l’Islande, et explique les raisons personnelles de l’auteur visant à défendre la pensée libertarienne.
Des chapitres portent sur la privatisation de la loi et de la police, et sur la fourniture de biens publics (tels que la défense nationale ou les routes) en société libertarienne. L’approche de Friedman est typiquement anarcho-capitaliste. Il y énonce en particulier une « loi » selon laquelle tout ce que fait le gouvernement coûte au moins deux fois plus cher que ce que coûterait l’équivalent dans le privé. Il illustre cette loi par plusieurs exemples, tels que le service des Postes.
Ce qui est passionnant dans ce livre, c’est que l’auteur est toujours tourné vers le concret. Peu de grands principes ici mais une foule de réflexions sur ce que serait la vie réelle dans une société libertarienne. Aucune question difficile n’est esquivée, l’auteur n’hésite pas à faire part de ses interrogations et même parfois de ses doutes (sur la défense nationale par exemple), d’où un sentiment de grande honnêteté intellectuelle et une approche des problèmes des plus stimulante.
« Ne demandez pas ce que l’Etat peut faire pour vous. Demandez ce que les hommes de l’Etat sont en train de vous faire ».
Bibliographie sélective
David Friedman, 1971, Vers une société sans Etat (nouvelles éditions en 1973 et 1989)
David Friedman, 1977, « A Theory of the Size and Shape of Nations », Journal of Political Economy 85, dans lequel il expose les limites de l’accroissement de la taille d’une nation en raison du désir de l’État de maximiser ses recettes fiscales
David Friedman, 1980, « Many, Few, One – Social Harmony and the Shrunken Choice Set », American Economic Review, vol. 70, no. 1 (mars), pp 225-232
David Friedman, 1980, « In Defense of Thomas Aquinas and the Just Price », History of Political Economy, 12
David Friedman, 1994, « Law as a Private Good: A Response to Tyler Cowen on the Economics of Anarchy », Economics and Philosophy, vol 10, pp 319–27
David Friedman, 1996, Hidden Order: The Economics of Everyday Life
Fabio Massimo Nicosia, 1997, « David Friedman, realista giuridico libertario », In: Fabio Massimo Nicosia, dir., Il diritto di essere liberi. Per una teoria libertaria della secessione, della proprietà e dell’ordine giuridico, Treviglio, Leonardo Facco Editore, pp 88-97
David Friedman, 2000, Law’s Order – What Economics Has to Do with Law and Why It Matters, Princeton, Princeton University Press
David Friedman, 2006, « Private Creation and Enforcement of Law: A Historical Case », In: Edward P. Stringham, Dir., Anarchy and the Law. The Political Economy of Choice, Ch 36, Cheltenham UK: Edward Elgar
David Friedman, 2008, Future Imperfect: Technology and Freedom in an Uncertain World

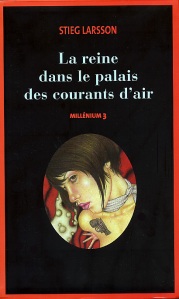

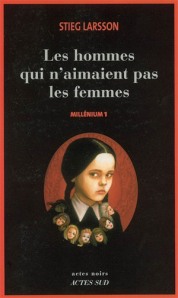 Voici un long moment que je n’ai donné signe de vie ici. Je vous prie, fidèles quoique clairsemés lecteurs, de m’en excuser. Olivier nous a conseillé,
Voici un long moment que je n’ai donné signe de vie ici. Je vous prie, fidèles quoique clairsemés lecteurs, de m’en excuser. Olivier nous a conseillé,