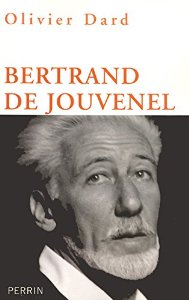 Voici quelques bonnes feuilles de la première biographie consacrée à Bertrand de Jouvenel et rédigée par Olivier Dard, professeur à l’université de Metz (Perrin, 2008). L’enfance particulière et privilégiée de Bertrand de Jouvenel, son adolescence mondaine, grâce au salon de sa mère et à son entregent, sa relation juvénile avec Colette, l’influence de ses deux mentors, Henry, son père, journaliste au Matin, et plus encore Robert, son oncle, rédacteur en chef de L’Œuvre, expliquent à notre sens largement les engagements et passions qui suivront Bertrand tout au long de son existence.
Voici quelques bonnes feuilles de la première biographie consacrée à Bertrand de Jouvenel et rédigée par Olivier Dard, professeur à l’université de Metz (Perrin, 2008). L’enfance particulière et privilégiée de Bertrand de Jouvenel, son adolescence mondaine, grâce au salon de sa mère et à son entregent, sa relation juvénile avec Colette, l’influence de ses deux mentors, Henry, son père, journaliste au Matin, et plus encore Robert, son oncle, rédacteur en chef de L’Œuvre, expliquent à notre sens largement les engagements et passions qui suivront Bertrand tout au long de son existence.
Au cœur du tout-Paris
Bertrand de Jouvenel voit le jour le 31 octobre 1903. Il est l’unique enfant d’un couple mondain et politique, né l’année précédente des conséquences de l’affaire Dreyfus. Sarah Claire Boas et Henry de Jouvenel ont fière allure : elle anime un salon, plaque tournante du Paris distingué et cultivé pendant vingt ans, tandis qu’il est un journaliste et homme politique plein d’avenir.
Claire est la fille d’Alfred Boas, famille lointainement originaire des Pays-Bas dont les racines les plus solides se trouvent en Alsace. L’industriel Alfred Boas, juif et franc-maçon, a été un bailleur de fonds pour la révision du procès Dreyfus. SA firme Boas-Rodrigues et Cie fabrique des lampes à acétylène utilisées dans l’industrie automobile naissante. D’où une aisance affichée entre l’hôtel particulier parisien et la villégiature de Montmorency, dotée d’un court de tennis et d’une bibliothèque abondante, deux souvenirs importants pour le jeune Bertrand.
Les relations entre la mère et son fils semblent avoir été délicates, puisqu’il note encore à 66 ans : « Ma mère, ma mère pensée obsédante (…) ? Mes goûts n’étaient pas les siens, j’ai manqué de compréhension et cela m’a hanté bien avant sa mort et depuis ». Sept ans plus tard, il est encore plus abrupt : « Il semble, chose épouvantable, horrible à dire, que je n’aie pas aimé ma mère. Elle m’avait aimé pourtant mais j’ai très peu de souvenirs d’enfance où elle figure. Elle est morte en 1967 à 89 ans. J’avais 64 ans. Et dans cette immensité de durée, ne s’était pas trouvé pour moi le temps de la comprendre. Cela me paraît maintenant inexplicable (…) Ma mère a tout fait pour moi mais je ne l’ai pas senti. » Pourtant, lorsque sa mère décède, le vide est profond : « Je n’appellerai pas Littré 59 04 pour mon salut quotidien (…) Mais combien me manque aujourd’hui ce devoir filial ».
Ses oncles du côté Boas, notamment Robert, officier de cavalerie qui a quitté l’armée après l’affaire Dreyfus pour se lancer dans les affaires (le métro Nord-Sud) entourent aussi l’enfance de Bertrand, qui ne voit alors son père que de loin en loin. Claire Boas est une femme active, aux centres d’intérêts variés. Femme de lettres, elle a écrit deux ouvrages sous le pseudonyme d’Ariel. Le premier est un livre de contes pour enfants préfacé par Anatole France ; le second, intitulé Quelques règles du jeu de la vie, est préfacé de Paul Valéry. Mondaine, Claire reçoit beaucoup à dîner et règne sur son salon du boulevard Saint-Germain. Son fils a insisté sur l’aura de sa mère qualifiée par ses soins d’ « instigatrice efficace » dont il s’est inspiré du comportement pour décrire « l’instigation » dans son essai sur la « Politique pure ». Certaines sources rendent hommage à son « ardeur à organiser ces réunions où Américains et Français, politiques et industriels se rencontraient », au point d’y gagner le sobriquet d’ « insistance publique ». Mais d’autres témoignages sont nettement moins bienveillants. Louise Weiss, liée par cousinage à la famille Boas, a ainsi laissé un tableau acide d’une de ces réceptions : « Le spectacle était d’une fantaisie frisant l’aberration. Les invités arrivaient en surnombre. Les maîtres d’hôtel ne savaient où fourrer leurs assiettes. Claire ne les connaissait ou ne les reconnaissait pas toujours. Tant pis. Ils lui baisaient la main, ravis, dans une surenchère de compliments. Quelquefois, Claire oubliait ses commensaux et n’apparaissait alors que dans l’après-midi, ondulant dans ses boas de plumes, les cheveux fleuris de violettes. Ses hôtes qui s’étaient mis à table sans elle, s’excusaient. En retour, elle s’extasiait sur la beauté des plus laids et l’intelligence des plus sots, principes fondamentaux de sa diplomatie qui l’allait guère plus loin ». Le jugement est excessif ; malgré ses côtés fantasques, Claire Boas entretient des liens solides dans le personnel diplomatique français, à commencer par Philippe Berthelot, secrétaire général du Quai d’Orsay à partir de septembre 1920. Ce dernier lui fait jouer un rôle d’hôtesse officieuse de la diplomatie française.
La question tchécoslovaque que sous-tend l’avenir et la destruction de l’Autriche-Hongrie, agite les milieux intellectuels (où un lobby pro-tchèque est animé par le géographe Ernest Denis depuis le début du 1915) mais aussi les salons parisiens. Celui de Claire accueille, dès 1915, Milan Stefanik, jeune astronome slovaque, engagé volontaire dans l’armée française. En février 1916, Claire facilite un entretien entre Masaryk et Aristide Briand, alors président du Conseil. Son soutien à la cause tchécoslovaque ne se dément pas et, en 1919, elle joue « le rôle d’ambassadrice (…) des volontés des deux ardents patriotes slovaques et tchèques, ses amis Milan Stefanik et Edouard Benes ». Cette atmosphère a profondément marqué le jeune Bertrand. Il n’a cessé de revenir sur l’importance de Stefanik et évoque par la suite la question tchécoslovaque sur un registre où l’affectif domine : « Tchéco… Slovaquie… La première fois que j’entendis ce vocable double, à consonance étrange, c’était pendant la guerre, à la fin de 1915, je crois. Une voix hésitante essayait ces deux mots, s’assurait s’ils rendaient, associés, un son ferme et d’heureux augure. Je regardais l’homme qui parlait. Son visage aux traits prononcés ressemblait, avec un ton blême, creusé par la petite vérole, au moulage de plâtre d’un César. J’avais devant moi le fondateur d’un Etat. Milan Stefanik m’entraîna – Je me souviens encore de la pression brusque et affectueuse de sa main sur mon épaule – vers la carte d’Europe affichée dans ma chambre. – Qu’y a-t-il là ? me demanda-t-il. – L’Empire austro-hongrois. Son doigt fit un tracé. – Ici, dit-il, il y aura la Tchécoslovaquie ». Le salon maternel « a contribué à développer » chez le jeune Bertrand « l’intérêt pour la chose publique et la politique », sur un mode exalté et sentimental bien plus que raisonné, à la différence de ce que lui inculquent son père et surtout son oncle, Robert de Jouvenel.
Claire Boas de Jouvenel est aussi la présidente fondatrice de différentes associations caritatives, parmi lesquelles l’Association de travail et d’assistance, l’Association et la Revue des Messages et surtout « La Bienvenue française ». Cette dernière, reconnue d’utilité publique par un décret du 18 mars 1922, se présente comme une « association créée pour favoriser les échanges intellectuels et moraux entre nations ». Claire Boas de Jouvenel en est le secrétaire général et réunit autour d’elle un conseil d’administration prestigieux : le maréchal Foch est président ; les vice-présidents sont, entre autres, le professeur de droit Joseph Barthélémy, célèbre constitutionnaliste et futur garde des Sceaux de l’Etat français, Henri Cachard, ancien président de la chambre de commerce américaine de Paris ; les fonctions de trésorier sont assurées par le baron Edouard de Rothschild. Parmi les membres les plus éminents, on rencontre des hommes politiques (dont le dirigeant radical Edouard Herriot), mais surtout des industriels (la patron-ingénieur et magnat de l’électricité Ernest Mercier) et des banquiers (Cahen-Fuzier, directeur de la Banque de l’Union parisienne). Le « comité des réceptions » est présidé par la duchesse d’Uzès. La finalité de La Bienvenue française est d’ « inciter nos Alliés et Amis Etrangers à venir en France, soit en Délégation représentant les grands groupements de leur pays, soit individuellement ». Pour ce faire, l’association s’est dotée de fichiers très complets, rassemblés au bureau central de Paris et permettant « aux étrangers recommandés par leur ambassade ou par les grandes institutions de leur pays d’y trouver les renseignements concernant toutes les branches de l’activité intellectuelle, sociale, artistique, scientifique, économique, etc. de la France. » Enfin, l’association entretient des contacts réguliers avec les institutions, publiques ou privées, référencées dans ces fichiers.
Le jeune Bertrand de Jouvenel baigne donc, dès son adolescence, dans des milieux élitaires et cosmopolites. Il s’ennuie souvent dans les atmosphères mondaines qu’affectionne sa mère, en particulier lorsqu’il doit l’accompagner dans ses sorties : « Ce qui faisait son bonheur, c’était la société, et, à la différence de tant d’autres mère qui craignent de faire connaître leur âge en se faisant accompagner d’un fils ou d’une fille, elle aimait m’y entraîner. (…) Les dimanches de ma jeunesse où je me laissais entraîner au golf, je ruminais mon regret de ne pas être assis dans le couloir obscur du boulevard Saint-Germain où les livres de mon père étaient rangés. » Il voyage également dans les principales stations d’Europe, de Vichy à Saint-Moritz. Cette socialisation privilégiée ne présente qu’une partie des atouts dont le jeune garçon dispose : la famille paternelle compte telle aussi dans le Paris de l’avant-guerre.
Les origines des Jouvenel restent confuses jusqu’au XVIIe siècle, époque à laquelle il est établi que la famille occupe un ancien monastère sis à Aubazines, en Corrèze. Au XVIIIe siècle, le titre de baron est accordé à l’une des branches de la famille, mais c’est à partir du XIXe siècle que le nom acquiert une certaine notoriété. L’arrière-grand-père de Bertrand, Léon de Jouvenel (1811-1886), monté à Paris pour y faire fortune, épouse la fille d’un des généraux de Napoléon Ier, Gourlez de la Motte. Notable orléaniste, Léon de Jouvenel achète en 1844 le château de Castel Novel près de Brive. En 1846, il est élu député de la Corrèze, puis réélu en 1852, 1857 et 1870. Son fils Raoul (1843-1910), le grand-père de Bertrand, est sous-préfet sous le Second Empire, puis préfet au lendemain de la guerre de 1870. Le triomphe des républicains et le retrait de Mac-Mahon marquent la fin de sa carrière. Catholique et monarchiste, cet « exilé de l’intérieur » se retire alors sur ses terres à Castel Novel, transformé en gentilhommière. Ses deux fils, Henry (1876-1935), le père de Bertrand, et Robert (1881-1935), ne partagent pas ses réticences à l’égard de la Troisième République.
Henry, instruit dans le giron familial, est monté à Paris en 1893 pour préparer son baccalauréat au collège Stanislas. L’établissement est alors dominé par la figure de Marc Sangnier, le fondateur du Sillon. Henry de Jouvenel y rencontre des personnalités qui comptèrent sa vie durant, à commencer par Anatole de Monzie (futur avocat et ministre) et Louis Gillet (futur historien de l’art et académicien) avec lesquels il se retrouve en 1894-5 en classe de rhétorique supérieure. […] Après le baccalauréat, Henry de Jouvenel entame une licence de philosophie en Sorbonne et fait, en 1896-7, un éphémère passage à l’Ecole libre des sciences politiques. De sensibilité de gauche, Henry de Jouvenel participe en 1896 aux manifestations devant le Sénat, qui vient de renverser le gouvernement de Léon Bourgeois, promoteur du solidarisme. Il est séduit par la figure de Joseph Paul-Boncour, socialiste indépendant et jeune avocat brillant. A la recherche de causes à défendre, il fonde avec Anatole de Monzie un hebdomadaire éphémère, La Défense des colonies. La lecture du « J’Accuse » de Zola (13 janvier 1898), alors qu’il est en garnison à Bellac, l’entraîne dans le camp des dreyfusards. Il rencontre par ce biais son futur beau-père, Alfred Boas, qui lui présente sa fille. Au début du XXe siècle, le destin d’Henry de Jouvenel bascule. Il accède aux fonctions de chef de cabinet du garde des Sceaux en 1902, puis de directeur de cabinet du ministre du commerce en 1906. Surtout, entré en 1905 au Matin, de Maurice Bunau-Varilla, l’un des plus influents quotidiens du temps, il s’y impose rapidement et en devient un des rédacteurs en chef.
Seul au milieu des femmes
Dans Un voyageur dans le siècle, ouvrage dédié à sa mère, Bertrand reprend les détails sur son enfance et son adolescence qui figurent déjà dans son Journal d’août 1943. Il grandit à Paris, au 2, rue de Saint-Simon, tout près du boulevard Saint-Germain. L’immeuble est très cossu et son entrée, imposante : boiseries sculptées, rampe d’escalier surmontée d’une tête de lion. L’appartement, de « style Michel Zévaco, résurrection du XVIe siècle en ce XIXe siècle finissant », est distribué en hautes pièces éclairées de vitraux en losange. Dans ce décor de « sérénité » et de lumière « de cathédrale », l’enfant aurait sans doute coulé des jours merveilleux sans le divorce de ses parents en 1906. Il n’a que trois ans lorsque son père quitte définitivement le foyer. Bertrand de Jouvenel n’est jamais revenu sur les raisons de cette séparation : « Je n’ai jamais cherché à élucider des vies privées. La chose publique toujours ! » En fait, Henry de Jouvenel vient d’entrer au Matin. Sa vie privée et ses nouvelles fonctions sont incompatibles, comme il s’en explique dans une lettre à Anatole de Monzie : « La reprendre (mon épouse), c’est quitter Le Matin pour lequel elle a le sentiment que je l’ai quittée ». Le jeune Bertrand est un enfant solitaire dont la principale compagnie est celle d’un domestique : « Je n’étais heureux que dans la cuisine ou la lingerie auprès de Jeanne l’Ardennaise. C’est une de ces femmes que j’ai le plus aimées. » […] Dans l’immense appartement, l’enfant cherche les traces de son père : dans un bureau aux persiennes closes, il contemple les livres de la bibliothèque restés sur place et se prend d’affection pour un grand fauteuil Henri II et un canapé qui l’ont accompagné au fil des déménagements. Ce père, Bertrand va parfois, accompagné de sa gouvernante, l’embrasser sur la terrasse des Tuileries. Plus tard, il lui rend visite chez lui, rue Cortambert, et y découvre son demi-frère Renaud, né en 1907. Le 19 décembre 1912, Henry de Jouvenel épouse la romancière Colette, directrice littéraire du Matin (elle est divorcée depuis 1910 d’Henri Gauthier-Villars, dit « Willy »). […]
Le tableau familial serait incomplet sans l’évocation de ses liens avec Colette, qu’il rencontre à l’âge de seize ans et demi. Au printemps 1920, les relations entre Claire Boas de Jouvenel et son ex-mari sont explosives : Claire continue d’utiliser le nom de Jouvenel dans ses activités mondaines et politiques, au grand dam d’Henry. Bertrand est envoyé en éclaireur boulevard Suchet. Il y découvre Colette lors d’une « première et tremblante visite », où il se dépeint comme « un enfant effrayé par une femme qui lui a été représentée comme redoutable » : « Elle m’intimidait terriblement, ne ressemblant à personne que j’eusse rencontré. » Il éprouve aussitôt une grande fascination pour cette femme, « petite, ramassée, puissante », dont le visage allie la « majesté » du front, « les triangles parfaits des narines », des « yeux beaux et allongés » et des lèvres « très finement dessinées et spirituelles » : « L’air naturel de Colette était extraordinairement imposant ». Colette, quant à elle, appelle Bertrand « mon fils » dans la dédicace de Chéri, avant de s’inspirer, pour écrire Le Blé en herbe publié en 1923, de lui-même pour le personnage de Phil, de son amie Paméla pour celui de Pam, sans oublier Madame Dalleray, « La Dame Blanche » qui « déniaisait le jeune homme. » De fait, le jeune garçon et la romancière, alors âgée de 47 ans, qui a, selon les termes de Bertrand, décidé de « former » son beau-fils, notamment sur le plan de son « éducation sentimentale », sont devenus rapidement amants. Jusqu’à son mariage avec Marcelle Prat en 1925, Bertrand, qui se décrit comme fidèle, vit dans l’ombre de Colette. […]
Une formation scolaire chaotique
Fruit de l’instabilité familiale, la formation scolaire du jeune Bertrand est erratique. Il grandit loin des autres enfants et « n’a aucun souvenir de groupe de son enfance. » Elevé par des gouvernantes britanniques ou allemandes, il garde un souvenir privilégié de Helen Cronin, une irlandaise qui s’est occupé de lui entre 8 et 10 ans. Avec elle, il acquiert une excellente maîtrise de l’anglais et découvre la littérature britannique et les chansons révolutionnaires irlandaises. Des précepteurs le prennent aussi en charge. […] Bertrand de Jouvenel n’a passé, en tout et pour tout, que deux fragments d’années dans des établissements scolaires – quelques mois en internat dans le collège de Normandie à Liancourt en 1915 et une année incomplète à l’école Pascal de Paris –, lorsqu’il fait en septembre 1918 son entrée en première au lycée Hoche de Versailles. […]
Robert de Jouvenel, l’oncle éducateur
On dispose de peu d’informations sur la vie personnelle de Robert, le frère cadet d’Henry. On sait cependant l’intérêt qu’a porté cet oncle à son neveu et l’influence qu’il a eue sur le jeune Bertrand, lui servant de « guide » jusqu’à sa mort brutale en 1924. Comme Henry, Robert de Jouvenel est politiquement engagé dans la mouvance radicale. Orateur phare de la Ligue de la République, il siège même un temps au comité exécutif du parti de la rue de Valois. Robert de Jouvenel est surtout une plume reconnue et acérée. Essayiste en vue lancé en 1914 par un titre volontairement provocateur, La République des camarades, il est aussi un journaliste réputé (L’Opinion, L’Eclair) dont le professionnalisme n’échappe pas à Gustave Téry, directeur-fondateur de L’Œuvre, qui en fait son rédacteur en chef. (…) On l’a comparé à Rivarol – ce qui le mettait hors de lui –, à Chamfort et à Prévost-Paradol, mais lui n’aurait pas rallié l’Empire. Il eût été dans l’opposition. En vérité, Jouvenel n’appartenait à aucun parti et il n’eût pas fait bon imposer des mots d’ordre. Ce vrai gentilhomme qui affectait un républicanisme, mettons, aéré, disait dans une prose succulente mais fluide ce qu’il avait à dire, ni plus, ni moins. Il est mort en 1925, assassiné par un chirurgien célèbre dans des conditions affreuses, mais il avait eu le temps de nous enseigner la désinvolture, que le scepticisme n’exclut pas la passion, qu’il n’est pas interdit de sourire en parlant de choses sérieuses et que l’emphase, l’étalage indiscret des grands sentiments est le fait des gens mal élevés. […] Educateur d’une génération, comment n’aurait-il pas influencé son neveu ? Bertrand de Jouvenel note ainsi dans ses Mémoires que, si « le goût de la politique a pris véritablement le dessus, cette orientation fut, dans une très large mesure, le fait de son oncle Robert de Jouvenel. » […]
Il a raconté dans Notre temps les rencontres qui se tenaient au siège de L’Œuvre et dressé sur son oncle un portrait chaleureux : « Le mardi soir, on trouvait Robert de Jouvenel à son bureau de L’Œuvre. La seule lumière que nous eussions, sa lampe de travail, n’éclairait que du papier bleu chargé d’une écriture lourde : article interrompu par notre arrivée, ou notes préparées pour la discussion. On voyait de lui seulement des mains charnues d’évêque batailleur, qui, dans la zone lumineuse, jetaient des jugements et puis revenaient s’accrocher aux entournures du gilet, cramponnées à l’étoffe consistante. Des faits, donnez-moi des faits, demandait-il. De l’autre côté de son bureau, nous étions dix ou quinze enfants raisonneurs, orgueilleux de formules recueillies à l’Ecole libre des sciences politiques ou à la faculté de droit. De temps à autre, un de nous lançait une théorie que chacun consolidait d’un exemple ou d’une citation. Son visage massif sortait alors de l’ombre, animé d’une puissance malicieuse. A grands coups allègres, il renversait notre théorie, et nous étions si bien entraînés à sa suite que nous montions à la charge comme s’il ne se fût pas agi de nous mettre nous-mêmes en déroute. Il se disait doctrinaire et s’excusait de n’apporter aucune doctrine. On a bien vu des républicains avant qu’il y eût une République ! Ils cherchaient avec foi. Ne valaient-ils pas mieux que ceux d’aujourd’hui qui conservent avec scepticisme ? Il n’appartenait ni au parti radical, ni au parti socialiste, mais enfermé dans un parti abstrait qu’il s’était taillé à lui seul, comme les cadets de jadis se taillaient un royaume ; il en prêtait les idées comme on prêtait des soldats. »
Olivier Dard, Bertrand de Jouvenel, Perrin, 2008, 526 pages.

 Voici, je le pense, un billet qui va vous surprendre. En effet, rien – me semble-t-il – ne pourrait vous laisser un seul instant supposer que je puisse être un fan du détective créé par Léo Malet. Et pourtant, c’est bien le cas. J’ai lu une grande partie des romans de l’auteur, et j’ai vu la quasi totalité des saisons de la série produite par Antenne 2 / France 2, depuis sa première apparition en 1991, dans laquelle Nestor est assez idéalement incarné par un Guy Marchand au flegme inaltérable.
Voici, je le pense, un billet qui va vous surprendre. En effet, rien – me semble-t-il – ne pourrait vous laisser un seul instant supposer que je puisse être un fan du détective créé par Léo Malet. Et pourtant, c’est bien le cas. J’ai lu une grande partie des romans de l’auteur, et j’ai vu la quasi totalité des saisons de la série produite par Antenne 2 / France 2, depuis sa première apparition en 1991, dans laquelle Nestor est assez idéalement incarné par un Guy Marchand au flegme inaltérable.