 Auteur : Bruno Jarrosson
Auteur : Bruno Jarrosson
Editeur : Dunod
Date de parution : 2017-01-11
EAN papier : 9782100760329
Acheter sur Amazon
Bruno Jarrosson est un consultant en stratégie, auteur de nombreux ouvrages sur ce sujet et plus généralement sur la gestion stratégique des organisations. Par ailleurs, il est l’auteur de deux pièces de théâtre. Ou peut-être de trois, tant cet opuscule ironique semble relever autant du grand-guignol que de la réalité, malheureusement. En quelques pages, Jarrosson nous lire avec un humour décapant une analyse infaillible sur ce qu’il faut appeler avec lui l’organisation scientifique du chômage, politique menée depuis quarante ans par tous les gouvernements successifs, et qui a donné des résultats si bons qu’ils sont quasi inespérés : la hausse bienheureuse et continue du chômage.
Les chiffres sont parlants. 1974 : 200 000 demandeurs d’emploi. 2016 : 3 550 000 chômeurs. Comment expliquer une telle réussite, si ce n’est en posant l’hypothèse que la France a tout fait pour augmenter le chômage et que ça a marché. Cela tombe bien car, comme ce livre le démontre, la France est en excellente voie pour faire encore beaucoup mieux !
Et pour une fois qu’une politique menée avec résolution atteint les buts qu’elle se donne, il convient de l’encourager, de l’étendre, voire même de donner des leçons aux autres pays. Notez que sur ce dernier aspect, les Français ne sont jamais en reste et excellent, depuis la nuit des temps, dans le fait de donner des leçons à la terre entière.
Les propos suivants s’appuient bien entendu sur l’ouvrage qui vient de paraitre, mais aussi sur cet excellent article de 2013.
L’Organisation scientifique du chômage
La politique de promotion du chômage est, en France, basée sur l’OSC. L’organisation scientifique du chômage. De quoi s’agit-il ? L’OSC consiste à décourager par tous les moyens légaux le contrat de travail. Si le marché du travail fait de la résistance, une armée de fonctionnaires déterminés va le mettre au pas. Les techniques utilisées depuis quarante ans se sont révélées si efficaces qu’on n’en a pas varié. En voici quelques-unes.
- Le coup de pouce. Il s’agit d’augmenter le salaire minimum plus vite que l’inflation. Ce qui a été fait puisque le pouvoir d’achat du SMIC a bien plus que doublé en trente ans. À chaque coup de pouce, des dizaines de milliers de personnes se trouvent exclues du marché du travail. La méthode est d’autant plus imparable qu’elle consiste à abaisser le niveau de vie au nom de l’augmentation du niveau de vie. On est pile-poil dans la novlangue façon Huxley. On comprend que les gouvernement aient usé et abusé d’une si merveilleuse méthode pour augmenter le chômage. Mais naturellement, celle-ci, qui ne touche que les plus bas salaires, se révèle vite insuffisante.
- Le lestage des charges sociales. L’idée est simple, il suffisait d’y penser : faire financer la protection sociale par le travail plutôt que par la consommation (la TVA) ou le capital productif (la TVA sociale). Les biens sont produits par la combinaison du travail et du capital puis ils sont consommés. On peut donc prélever le financement de la protection sociale sur le travail, sur le capital ou sur la consommation. Fort heureusement, c’est le premier choix qui a été fait. Il s’agit de punir le travail pour l’exclure de l’économie. Dans ce domaine-là, la France a été plus loin que la plupart des autres pays européens et en a recueilli les magnifiques résultats. Par exemple, en cas de forte croissance, le chômage baisse toujours moins en France qu’ailleurs. Bien entendu, ceci ne tient que si on a une administration qui sait effectivement et efficacement lutter contre le travail au noir. Les Italiens, par exemple, n’ont jamais pu résoudre ce problème. L’administration italienne devrait venir prendre des leçons de l’administration française sur l’organisation scientifique du chômage.
- Le financement des retraites. Même principe que pour les charges sociales : depuis trente ans on n’a cessé d’augmenter les cotisations employeurs et salariés.
- L’encouragement de l’oisiveté. Décourager le travail ne suffit pas. Encore faut-il encourager l’oisiveté. Il est donc fondamental de redistribuer à ceux qui ne travaillent pas l’argent que l’on a prélevé sur ceux qui s’obstinent à travailler. C’est ce qui a été fait.
- Faire peur aux employeurs. Il suffisait en effet d’y penser, s’il n’y a plus d’employeur, il n’y aura plus de salarié. Il suffit de judiciariser le contrat, et cela exclusivement contre l’employeur. Dans ce domaine, la créativité a été sans borne : indemnités de licenciement, requalification de l’intérim en CDI, réduction de la durée légale du travail (c’est en France qu’elle est la plus faible au monde, youhou), contrôles URSAFF fréquents et incompréhensibles, sans parler de l’Inspection du travail et de son sacro-saint Code. Il s’agit de bien faire comprendre à celui qui embauche qu’il devient automatiquement la cible privilégiée – et solvable – de l’administration, voire de la justice. Si dans le même temps on peut mettre en examen un patron connu et faire mousser l’affaire dans les médias, c’est encore mieux. Après tout, les patrons qui se retrouvent en délicatesse avec la justice n’ont que ce qu’ils méritent. Quelle idée aberrante, voire choquante, de vouloir créer de la richesse et de l’emploi ?
Au fil des ans, cette politique en faveur du chômage a été affinée et a rencontré un succès croissant. Ce qui nous laisse en toute franchise béats d’admiration en faveur de nos hommes et femmes politiques qui, en dépit des obstacles constants, des critiques ignorantes, des alternances fréquentes, de la croissance mondiale agaçante, ont su maintenir le cap d’une augmentation constante du chômage.
Hélas, une certaine modestie les empêche souvent de se prévaloir de leurs succès.
Un triomphe, dont seule notre modestie légendaire nous empêche de nous prévaloir
Nos hommes politiques sont trop modestes, c’est là leur moindre défaut. Ils n’osent pas assez souligner leurs succès dans la lutte pour le chômage et lorsqu’ils dressent un bilan, c’est en général pour créditer ces succès à d’autres qu’eux-mêmes. On doit saluer ici le fair play, pour ne pas dire la grandeur d’âme, caractéristique de l’esprit français. Chapeau bas, les artistes.
Cette modestie, plus déraisonnable encore qu’admirable, se manifeste de trois façons : la minimisation des chiffres d’une part ; le blues des ministres du Chômage d’autre part ; et enfin par le classique et néanmoins efficace « c’est pas moi c’est l’autre.
La minimisation des chiffres. Pourquoi faire sortir des statistiques des chômeurs ? Pourquoi, à chaque annonce d’une augmentation du chômage, cet un air modeste de gamin pris en faute, indiquant que ça ne va pas durer, que la courbe va bientôt se retourner ? Pourquoi afficher une telle prudence, un tel manque de confiance dans des politiques qui ont fait leur preuve ? Au fil des ans « l’inversion de la courbe du chômage » – toujours évoquée, jamais observée – est devenue la grande menace avec laquelle on éradique la confiance en l’avenir. Heureusement, elle ne vient jamais, ou alors ce n’est qu’un écran de fumée, et la politique pour le chômage reprend ses droits. Ouf.
Le blues des ministres. On comprend bien que nos gouvernants regrettent de n’avoir pas pu augmenter le chômage plus vite, qu’ils se laissent aller parfois sur ce sujet à une certaine tristesse. On voudrait toujours faire mieux à court terme. Mais dans la perspective du long terme, le succès est massif et incontestable. Certes il s’agit d’un travail d’équipe dont nul ne peut s’attribuer pour lui seul les lauriers. Il n’y a pas de champion de France de la création du chômage, mais un magnifique succès collectif et bi partisan.
Le « c’est pas moi c’est l’autre ». La loi sur les trente-cinq heures fut une des plus magnifiques étapes dans l’accélération tant attendue du chômage. On ne soulignera jamais assez la fascinante contribution des trente-cinq heures, à laquelle nous devons la suppression de centaines de milliers d’emplois. Chapeau bas. Augmenter le chômage en diminuant le temps de travail est une idée géniale de créativité, une innovation si étonnante qu’elle a mis du temps à émerger et que seule la France a eu le courage de mettre en œuvre avec résolution et constance. Comme quoi pour l’innovation et les macarons, il faut la durée. L’idée est géniale et innovante parce qu’elle est contre-intuitive et qu’elle fonctionne. Le ministre du Chômage de l’époque, Martine Aubry, tutoie désormais les plus grands noms de la pensée contemporaine, dans une sorte de Hollywood Walk of Fame du génie français.
Un raisonnement intuitif pourrait nous faire penser qu’en diminuant le temps de travail de chaque emploi, on augmente le nombre d’emplois. Gros risque. Mais nos gouvernants se méfient à juste titre des raisonnements directs et ont fait justement confiance à un raisonnement plus subtil. On ne la leur fait pas, ils ne sont pas des politiciens pour rien. En réduisant légalement le temps de travail, on augmente mécaniquement et massivement le coût du travail. Ce qui supprime de facto des centaines de milliers d’emplois. Et ouais. On ne peut qu’admirer nos gouvernants d’avoir pris un tel risque car si ça marche en théorie, il restait à démontrer que ça marche en pratique. C’est chose faite depuis. Et cerise sur le gâteau, on envoie aux investisseurs étrangers un message dissuasif sur la France. On peut regretter d’ailleurs que de ce point de vue-là, l’occasion ait été mal exploitée. Mais bon, on ne peut pas toujours tout réussir.
Alors pourquoi cette loi sur les trente-cinq heures, si bénéfique, n’a-t-elle pas de paternité claire ? À l’époque, en 1998, on l’attribuait à Martine Aubry, ministre du Travail très mobilisée par l’augmentation du chômage mais handicapée par la croissance. Et voilà que maintenant, dans un exercice de modestie certes admirable mais qui jette la confusion, madame Aubry ou son entourage laissent entendre que ce n’était peut-être pas son idée – mais celle de Dominique Strauss-Kahn, le fantôme du Sofitel déclassé dans un Novotel – que la loi n’a pu passer qu’avec l’appui ferme du Premier ministre Lionel Jospin – le spécialiste des premiers tours qui se prend le penne dans l’œil – que les effets sur le chômage ne seraient pas si clairs et devraient aussi à la politique de Jacques Chirac – le Corrézien presque SDF, si démuni qu’il doit être logé par un richissime levantin.
Voilà pour une fois le succès presque orphelin. Quel dommage, car cette posture morale qui force le respect brouille aussi le débat !
Comment aller plus loin, en finir avec l’emploi
Ce qui précède montre que la lutte contre l’emploi a atteint un certain degré de sophistication. Toutefois, même quand on atteint l’excellence, il ne faut pas renoncer à progresser. 3 280 000 chômeurs c’est bien, c’est même exceptionnel, mais cela laisse environ vingt-six millions de personnes au travail.
On peut aller plus loin, même au risque de l’impopularité. C’est après tout l’honneur du politique de savoir braver l’opinion publique pour promouvoir l’intérêt général. Nous en avons assez de preuves quotidiennes pour faire fonds sans réserve sur le courage et le refus de la démagogie qui anime nos gouvernants successifs.
Quelques idées donc pour aller plus loin, catalogue non exhaustif qui pourrait être enrichi par un exercice de créativité.
Passer aux trente-deux heures. Puisque les trente-cinq heures, ça a plutôt bien réussi pour augmenter le chômage, on pourrait amplifier ce succès en allant plus loin. Pourquoi ne pas aller aux trente-deux heures comme le propose depuis vingt ans Pierre Larrouturou ? Pourquoi ne pas reprendre et amplifier ce qui marche ?
Insulter les investisseurs étrangers. On doit à notre ministre dit du Redressement productif d’avoir lancé cette nouvelle méthode. Le ministre va chercher l’investisseur avec un fusil, l’invective fleurie à la bouche. Succès garanti. Bravo monsieur le productif ministre du Redressement productif, bel exemple de créativité au service d’une noble cause.
Supprimer la TVA. Pour augmenter le chômage, il est essentiel d’augmenter le coût du travail. On a certes jusqu’à maintenant fait brillamment financer la protection sociale par le contrat de travail. Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? On pourrait aussi faire financer l’État en transférant les recettes de l’État de l’impôt au contrat de travail. Ainsi la France pourrait effacer les désavantages comparatifs qui lui restent et que nous avons soulignés plus haut. Encore une fois, augmenter le chômage en France n’est pas facile, il y faut de l’énergie, de la constance mais aussi de grands moyens et des stratégies audacieuses.
Interdire les licenciements. Si on parvient à rendre le contrat de travail indissoluble comme le mariage catholique et romain, on condamne de fait l’employeur à entretenir des rentiers. Effet dissuasif garanti. Ce système qui a fait ses preuves dans le secteur public pourrait être étendu au secteur privé.
Verser des prestations chômage illimitées. Il convient enfin de décourager les chômeurs de reprendre un travail. Il se peut certes que certains préfèrent travailler que rester chômeur, mais au moins il serait sain de gérer le revenu et que ceux qui sont au chômage ne gagnent pas moins que ceux qui travaillent.
La recette pour baisser le chômage est aussi connue – par les multiples exemples internationaux et les préconisations des économistes compétents – que celle des éclairs au chocolat. Si aucun gouvernement ne l’a fait, c’est donc qu’aucun gouvernement n’a voulu le faire.
Puisque ce succès de la hausse continue du chômage a permis d’identifier les moyens d’augmenter le chômage, puisque la recette est désormais bien connue, pourquoi se contenter des demi-mesures ? demande Bruno Jarrosson. Le moment n’est-il pas venu de tirer avantage du lucide courage de ces gouvernements qui n’ont jamais voulu baisser le chômage ?
Riveté au constat réaliste des faits économiques, ce livre explore les voies et délices d’un chômage généralisé fondé sur la résolution sans faille de ceux qui nous gouvernent.
 Bruno Jarrosson est un philosophe et écrivain français né en 1955. Ingénieur Supélec, conseiller en stratégie, il enseigne la philosophie des sciences à Supélec et la théorie des organisations à l’Université Paris-Sorbonne. Co-fondateur et président de l’association « Humanités et entreprise », il est l’auteur de nombreux ouvrages, notamment Invitation à une philosophie du management (1991) ; Décider ou ne pas décider ? (1994) ; De la défaite du travail à la conquête du choix (1997) ; Pourquoi c’est si dur de changer (2007), Le temps des magiciens (2010) et dernièrement Les secrets du temps (2012).
Bruno Jarrosson est un philosophe et écrivain français né en 1955. Ingénieur Supélec, conseiller en stratégie, il enseigne la philosophie des sciences à Supélec et la théorie des organisations à l’Université Paris-Sorbonne. Co-fondateur et président de l’association « Humanités et entreprise », il est l’auteur de nombreux ouvrages, notamment Invitation à une philosophie du management (1991) ; Décider ou ne pas décider ? (1994) ; De la défaite du travail à la conquête du choix (1997) ; Pourquoi c’est si dur de changer (2007), Le temps des magiciens (2010) et dernièrement Les secrets du temps (2012).
Suivre sur Twitter : @BrunoJarrosson
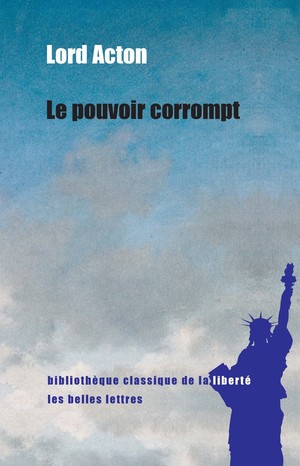 Lord Acton, Le Pouvoir corrompt
Lord Acton, Le Pouvoir corrompt


 Auteur :
Auteur : 




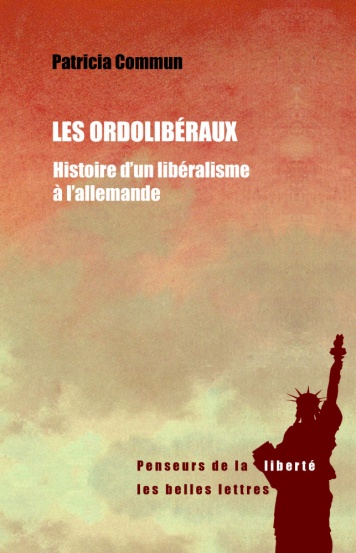 Patricia Commun,
Patricia Commun, 
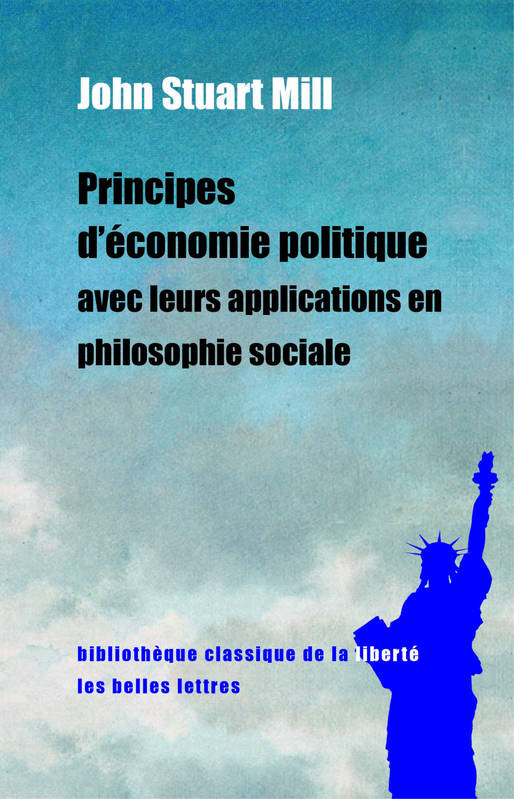
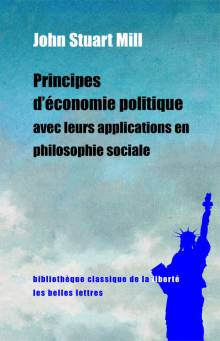 John Stuart Mill, Principes d’économie politique avec leurs applications en philosophie sociale. Extraits des Livres IV et V, Les Belles Lettres, collection Bibliothèque classique de la liberté, traduction par Jean-Gustave Courcelle-Séneuil et Hippolyte Dussard (1861) dans la version de la 2e édition, présentation par Alain Laurent. En librairie le 14 mars 2016.
John Stuart Mill, Principes d’économie politique avec leurs applications en philosophie sociale. Extraits des Livres IV et V, Les Belles Lettres, collection Bibliothèque classique de la liberté, traduction par Jean-Gustave Courcelle-Séneuil et Hippolyte Dussard (1861) dans la version de la 2e édition, présentation par Alain Laurent. En librairie le 14 mars 2016.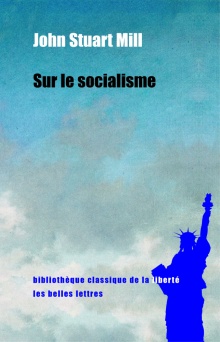 Le second ouvrage constitue une traduction inédite en français des Chapters on Socialism (1879) par Michel Lemosse. Le tout agrémenté d’une présentation par Alain Laurent.
Le second ouvrage constitue une traduction inédite en français des Chapters on Socialism (1879) par Michel Lemosse. Le tout agrémenté d’une présentation par Alain Laurent.